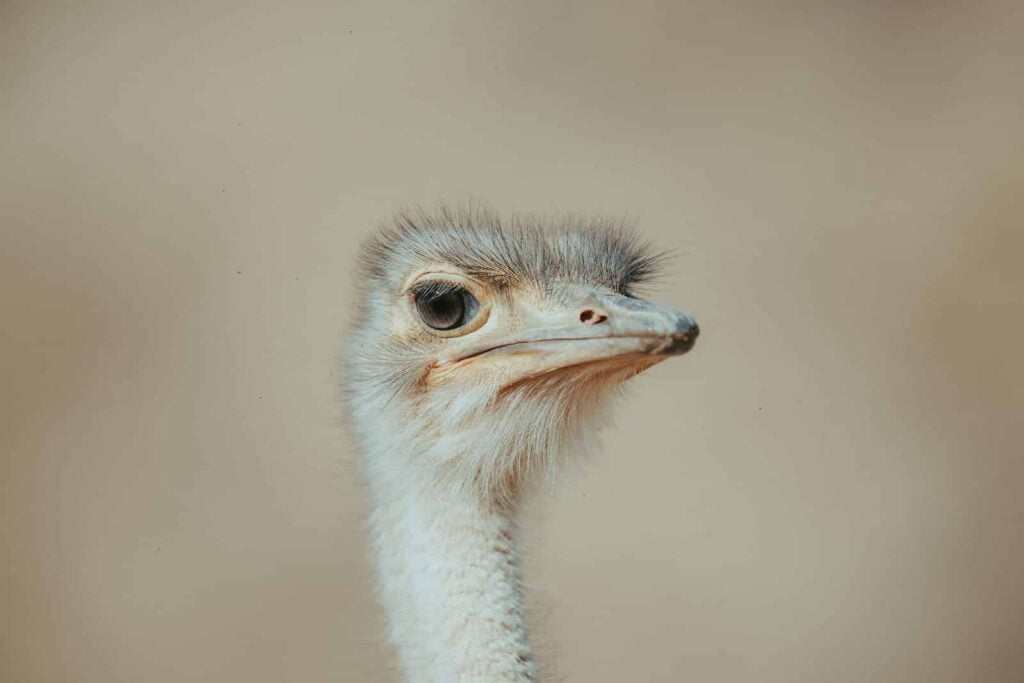« `html
Dans l’univers des financements structurés, la sous-participation bancaire opère dans l’ombre. Contrairement à la syndication directe où tous les prêteurs signent la documentation contractuelle, ce mécanisme permet à une banque de transférer tout ou partie du risque de son crédit à d’autres établissements, souvent à l’insu de l’emprunteur.
1. Définition et formes de sous-participation
La sous-participation se réalise sans formalité légale spécifique. Pour sa qualification juridique, un simple échange de lettres, un certificat de participation ou un protocole interbancaire suffit. Elle prend principalement deux formes.
Sous-participation en risque seul
Dans cette configuration (« unfunded sub-participation »), le sous-participant s’engage uniquement à prendre un pourcentage du risque. Le chef de file assure seul la trésorerie. Le sous-participant devient un débiteur conditionnel et perçoit des commissions en contrepartie.
L’article 5-2, alinéa 3 du règlement CRBF n° 91-01 du 16 janvier 1991 précise que chaque établissement impliqué « enregistre au hors bilan sa quote-part de risque final. »
Sous-participation en risque et en trésorerie
Ici (« funded sub-participation »), le sous-participant s’engage à décaisser des fonds correspondant à son pourcentage de participation. Il devient titulaire d’une créance conditionnelle de restitution.
Les banques concluent généralement des sous-participations « prorata » : le sous-participant fournit un pourcentage fixe lors de chaque avance et obtient un pourcentage équivalent sur les remboursements.
Variantes contractuelles
Les modalités d’intervention peuvent varier considérablement :
- Sous-participations « variable payment » : le sous-participant bénéficie d’un taux d’intérêt différent de celui versé par l’emprunteur.
- Sous-participations « last in – first out » : le premier remboursement est affecté en priorité à la part du sous-participant.
- Sous-participations « last out » : le sous-participant ne reçoit sa part qu’après remboursement du chef de file.
2. Effets relatifs du contrat de sous-participation
Inopposabilité à l’emprunteur
La sous-participation n’est pas translative mais constitutive de droits. Elle obéit au principe de la relativité des conventions (article 1165 du Code civil).
La Cour d’appel de Paris a clairement établi que « le caractère occulte d’un contrat de sous-participation a pour effet direct qu’aucun lien de droit n’est créé entre la banque sous-participante et les tiers, dont les emprunteurs, à qui la convention est inopposable » (CA Paris, 15e ch. B, 5 juill. 2002, M. Da Costa Antonio c/ SA Banque La Henin).
L’emprunteur ne peut se prévaloir de ce contrat pour se soustraire à ses obligations envers le chef de file. Réciproquement, le sous-participant ne peut exercer d’action directe contre l’emprunteur.
Absence de droit sur les sûretés
Le sous-participant ne bénéficie pas des sûretés garantissant le prêt octroyé par le chef de file. La jurisprudence est constante sur ce point (CA Paris, 3e ch., 7 juill. 1975, Bellat c/ BNP).
Cette impossibilité s’applique même aux sûretés consenties au sous-participant dans ses relations bilatérales avec l’emprunteur en dehors du syndicat. La Cour de cassation a confirmé qu’une « banque ne peut obtenir des cautions d’un débiteur en règlement judiciaire le paiement des dettes qui ont été contractées envers une autre banque chef de file d’un pool bancaire dont elle était membre » (Cass. com., 17 juin 1986, Société Générale c/ Consorts Billaud).
Incidence de la procédure collective du chef de file
Risque résiduel mais réel : en cas de redressement judiciaire du chef de file, les sous-participants seront considérés comme de simples créanciers chirographaires.
La loi du 8 août 1994 a certes amélioré la protection des créanciers d’établissements de crédit en difficulté, mais elle exclut généralement les fonds versés dans le cadre d’opérations syndiquées.
Seul le trust permet d’éviter ce risque. Les biens détenus « in trust » constituent une masse distincte du patrimoine du chef de file et échappent au concours avec ses créanciers. À condition toutefois qu’une comptabilité distincte soit tenue pour les sommes reçues en exécution du contrat de sous-participation.
3. Rapport entre banques dans la sous-participation
Droits et obligations du sous-participant
Le sous-participant a droit à la restitution du principal et au paiement des intérêts au prorata des sommes effectivement payées par l’emprunteur.
Il a l’obligation de contribuer aux risques de l’opération selon sa participation (CA Versailles, 12e ch. 2, 18 sept. 1997). Engagé dans les mêmes termes que le chef de file, il ne peut être dégagé avant l’échéance prévue.
En cas de redressement judiciaire du sous-participant, le chef de file peut déclarer sa créance dans la procédure. La Cour d’appel de Paris a jugé que « chaque membre est obligé de respecter ses engagements durant la période de fonctionnement du syndicat et, le cas échéant, d’apporter les moyens financiers convenus, faute de quoi le syndicat n’aurait aucune raison d’être » (CA Paris, 3e ch. C, 2 avr. 1996).
Obligations et responsabilités du chef de file
Le chef de file reste totalement engagé vis-à-vis de l’emprunteur. La sous-participation ne constitue jamais un abandon du contrat originaire.
Vis-à-vis du sous-participant, il est débiteur d’une obligation précontractuelle d’information. La Cour de cassation a jugé qu’un chef de file avait commis un dol en fournissant « des renseignements erronés en les présentant comme s’il les avait vérifiés, alors que cette obligation lui incombait » (Cass. com., 22 mai 2001).
Il est également débiteur d’obligations résultant de la gestion du crédit. L’étendue de ses pouvoirs dépend des stipulations contractuelles. En l’absence de précision, il est réputé avoir reçu un mandat tacite limité « à l’étendue de la proposition » faite au sous-participant (CA Paris, 15e ch. B, 19 févr. 1999).
Sa responsabilité peut être engagée pour négligence, faute lourde ou manquement à son obligation générale de bonne foi. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’un chef de file avait « l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et donc de veiller aux intérêts des membres du pool » (CA Paris, 15e ch. B, 26 nov. 1999).
Limitations aux actes de disposition
La jurisprudence est claire : le chef de file ne peut engager les banques sous-participantes que sur leur autorisation préalable et expresse, sauf pour les actes de gestion courante.
Tout acte de disposition pris sans cette autorisation sera inopposable au sous-participant. Sont visés notamment :
- Les abandons de créance (Cass. com., 27 mars 2001)
- Les protocoles de règlement amiable (Cass. com., 27 mars 2001)
- Les transactions prévoyant des paiements échelonnés (CA Paris, 15e ch. B, 30 nov. 2001)
- Les modifications des modalités, du montant ou de l’échéance du crédit (Cass. com., 17 déc. 2002)
Le chef de file peut justifier un dépassement de pouvoir en prouvant l’accord implicite du sous-participant, le caractère abusif du refus de ce dernier, ou le caractère raisonnable de ses décisions dans l’intérêt commun.
4. Enjeux pratiques pour les établissements bancaires
Avantages et risques pour le chef de file
Le chef de file conserve la relation client tout en partageant le risque. Il perçoit généralement une commission pour son rôle de gestionnaire du crédit.
Le principal risque réside dans sa responsabilité renforcée. Il doit maîtriser les informations transmises au stade précontractuel et exercer une gestion diligente du crédit.
Certaines conventions de sous-participation contiennent des clauses exonératoires de responsabilité, mais celles-ci sont inopérantes en cas de dol ou faute lourde.
Avantages et risques pour le sous-participant
Le sous-participant accède à des opérations sans relation directe avec l’emprunteur. Il peut ainsi contourner certaines restrictions géographiques ou sectorielles.
En contrepartie, il supporte deux risques majeurs :
- L’absence de droit direct contre l’emprunteur
- Sa qualité de créancier chirographaire en cas de défaillance du chef de file
Ce second risque, bien que résiduel, reste une réalité tangible dans un environnement bancaire mondialisé.
Situations nécessitant l’intervention d’un conseil juridique
La sous-participation reste un mécanisme sui generis dont la nature juridique est controversée. La diversité des qualifications proposées (réassurance, société en participation, mandat d’intérêt commun, convention de croupier) illustre cette complexité.
Un accompagnement juridique spécialisé devient indispensable pour :
- Rédiger une convention qui reflète précisément les intentions des parties
- Évaluer les risques spécifiques liés à la structure choisie
- Anticiper les conséquences d’une éventuelle défaillance du chef de file
- Définir les pouvoirs exacts du chef de file dans la gestion du crédit
- Organiser contractuellement la circulation de l’information entre les parties
Nos experts en droit bancaire vous accompagnent dans la structuration de ces opérations complexes. Ne prenez pas le risque de découvrir les subtilités juridiques de la sous-participation à l’occasion d’un contentieux. Contactez-nous pour sécuriser vos opérations en amont.
Sources
- Fasc. 506 : CRÉDITS SYNDIQUÉS – Sous-participation, JurisClasseur Droit bancaire et financier, Emmanuelle Bouretz (2003, mise à jour 2016)
- Fasc. 505 : CRÉDITS SYNDIQUÉS – Syndication directe, JurisClasseur Droit bancaire et financier, Emmanuelle Bouretz (2003, mise à jour 2019)
- CA Paris, 15e ch. B, 5 juill. 2002, M. Da Costa Antonio c/ SA Banque La Henin (Juris-Data n° 2002-194848)
- Cass. com., 22 mai 2001, SA Banque pour l’Industrie Française c/ SA Sté Omnibanque (RJDA 10/2001, n° 1013)
- Règlement CRBF n° 91-01 du 16 janvier 1991, article 5-2, alinéa 3
- Cass. com., 17 juin 1986, Société Générale c/ Consorts Billaud (Bull. civ. IV, n° 125)
- CA Paris, 15e ch. B, 26 nov. 1999, SOFIC c/ White SAS (Juris-Data n° 1999-105109)
« `