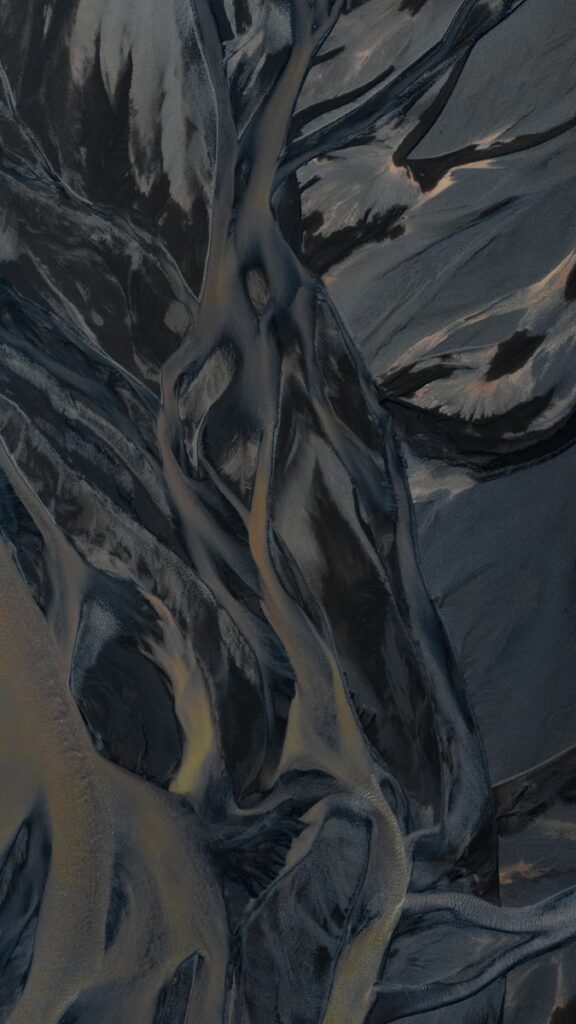Affronter des difficultés financières est une épreuve pour toute entreprise. Lorsque la situation devient critique et qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, de nombreuses questions se posent quant au sort des contrats en cours. Qu’advient-il de vos équipements financés par crédit-bail mobilier ? Pouvez-vous continuer à les utiliser ? Le crédit-bailleur peut-il les reprendre immédiatement ? L’interaction entre le droit des entreprises en difficulté et les règles du crédit-bail est complexe et ses conséquences peuvent être déterminantes pour l’avenir de votre activité ou le déroulement de la procédure. Cet article vise à démystifier les règles applicables au contrat de crédit-bail mobilier lorsque votre entreprise fait l’objet d’une procédure collective.
Le sort du contrat de crédit-bail lors de l’ouverture de la procédure
L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce marque le début d’une période encadrée par des règles spécifiques, dérogatoires au droit commun des contrats.
Le principe : pas de résiliation automatique
C’est une règle fondamentale posée par l’article L622-13 du Code de commerce : l’ouverture de la procédure n’entraîne pas, à elle seule, la résiliation automatique des contrats en cours. Ceci s’applique pleinement au contrat de crédit-bail mobilier. Peu importe si votre contrat contient une clause prévoyant sa résiliation immédiate en cas de procédure collective : cette clause est réputée non écrite et sans effet par la loi. Le contrat continue donc, en principe, d’exister après le jugement d’ouverture.
L’option de l’administrateur judiciaire : poursuivre ou arrêter le contrat
Le sort effectif du contrat dépendra d’une décision prise par l’administrateur judiciaire (ou par vous-même, assisté de l’administrateur, ou seul dans certains cas de procédure simplifiée). L’administrateur désigné par le tribunal a seul la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours qu’il estime nécessaires au maintien de l’activité. Il peut donc décider de poursuivre le contrat de crédit-bail si l’équipement concerné est essentiel pour l’entreprise, ou au contraire, décider de ne pas le continuer s’il n’est plus utile ou si l’entreprise ne peut en assumer la charge.
Les conditions de la poursuite du contrat
Si l’administrateur opte pour la continuation du contrat, cela a des conséquences importantes. Principalement, l’entreprise doit être en mesure de payer à leur échéance tous les loyers qui deviendront exigibles après le jugement d’ouverture. Ces loyers postérieurs sont considérés comme des créances « utiles » à la poursuite de l’activité et bénéficient d’un régime de paiement prioritaire par rapport aux dettes antérieures (selon l’article L622-17 du Code de commerce). L’administrateur doit s’assurer, avant d’exiger la continuation, qu’il disposera des fonds nécessaires pour honorer ces paiements futurs.
Le mécanisme de la mise en demeure et la résiliation
Le crédit-bailleur n’est pas laissé dans l’incertitude indéfiniment. Il peut adresser une mise en demeure à l’administrateur judiciaire, lui demandant de se prononcer sur la continuation du contrat. Si l’administrateur ne répond pas positivement (en confirmant sa volonté de continuer et sa capacité à payer) dans un délai d’un mois (sauf si le juge-commissaire accorde un délai différent, sans que le délai total puisse dépasser deux mois), le contrat de crédit-bail est alors automatiquement résilié. De même, si l’administrateur opte pour la continuation mais que les loyers postérieurs ne sont pas payés comme convenu, le contrat sera également résilié de plein droit.
Les conséquences de l’arrêt du contrat
Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat, ou s’il ne répond pas à la mise en demeure, le contrat est résilié. Le crédit-bailleur peut alors demander la restitution du matériel (voir ci-dessous). Il peut également avoir droit à des dommages-intérêts pour compenser le préjudice lié à cette rupture anticipée. Cependant, cette créance de dommages-intérêts est traitée comme une dette née avant le jugement d’ouverture et doit faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure.
La déclaration des créances du crédit-bailleur
Comme tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, le crédit-bailleur doit déclarer ses créances pour espérer être payé dans le cadre de la procédure.
L’obligation de déclarer les créances antérieures
Le crédit-bailleur doit déclarer auprès du mandataire judiciaire (désigné par le tribunal) le montant de toutes les sommes qui lui étaient dues avant la date du jugement d’ouverture. Cela concerne principalement les loyers échus et impayés à cette date. Si le contrat a été résilié avant l’ouverture de la procédure, l’indemnité de résiliation contractuelle doit également être déclarée. Cette déclaration doit être faite dans un délai légal strict (généralement deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC), sous peine de ne pas être admis au passif (article L622-24 du Code de commerce).
Une information spécifique pour les crédits-bailleurs
Une protection importante existe pour les crédits-bailleurs dont le contrat a fait l’objet de la publicité légale (inscription au registre du greffe). La loi oblige le mandataire judiciaire à avertir personnellement ces créanciers qu’ils doivent déclarer leur créance.
La sanction : la forclusion, sauf défaut d’information
Si un créancier ne déclare pas sa créance dans le délai imparti, il est dit « forclos » : sa créance est éteinte et il ne pourra plus en réclamer le paiement. Cependant, grâce à l’obligation d’information mentionnée ci-dessus, si le crédit-bailleur (dont le contrat était publié) n’a pas reçu cet avertissement personnel du mandataire judiciaire, la forclusion ne lui est pas opposable. C’est une garantie essentielle qui évite qu’un crédit-bailleur diligent perde ses droits par simple méconnaissance de l’ouverture de la procédure.
La restitution du bien au crédit-bailleur (revendication)
L’une des questions les plus sensibles en cas de procédure collective est le sort du matériel lui-même. Le crédit-bailleur, en tant que propriétaire, peut-il le récupérer ?
Le droit de propriété comme fondement
Oui, le droit de propriété du crédit-bailleur lui donne, en principe, le droit de demander la restitution de son bien si le contrat de crédit-bail est résilié.
L’importance cruciale de la publicité préalable
Comme vu précédemment, pour que ce droit de propriété soit opposable à la procédure collective (c’est-à-dire aux autres créanciers), il est indispensable que le contrat de crédit-bail ait fait l’objet de la publicité légale (inscription au registre du greffe) avant le jugement d’ouverture. Sans cette publicité, le bailleur risque de ne pas pouvoir faire valoir son droit contre la masse des créanciers.
La dispense d’action en revendication si le contrat est publié (loi post-1994)
Une avancée majeure de la législation (depuis la loi du 10 juin 1994, article L624-10 du Code de commerce) concerne les contrats de crédit-bail publiés. Pour ces contrats, le crédit-bailleur est dispensé d’exercer une « action en revendication » formelle devant le juge-commissaire pour faire reconnaître son droit de propriété. La publicité vaut reconnaissance de son droit vis-à-vis de la procédure. Attention, cela ne signifie pas qu’il récupère automatiquement le bien.
La procédure de demande de restitution
Même dispensé de l’action en revendication, si le contrat est résilié (par exemple, par décision de l’administrateur ou suite à une mise en demeure infructueuse), le crédit-bailleur doit demander la restitution du matériel. Cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’administrateur judiciaire (ou au liquidateur si liquidation). Si l’administrateur ne répond pas ou refuse la restitution, le crédit-bailleur peut alors saisir le juge-commissaire pour qu’il statue sur cette demande (article R624-13 du Code de commerce).
Le cas où l’action en revendication reste nécessaire
Si le contrat de crédit-bail n’a pas été publié avant le jugement d’ouverture, la situation est plus complexe pour le bailleur. Il n’est pas dispensé de l’action en revendication. Il doit alors engager cette action formelle auprès du juge-commissaire, dans un délai très strict de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L624-9 du Code de commerce), pour tenter de faire reconnaître son droit de propriété contre la procédure.
Conséquences de l’échec de la restitution/revendication
Si le crédit-bailleur ne respecte pas les conditions (défaut de publicité préalable, absence de demande de restitution ou d’action en revendication dans les délais si elle était nécessaire), il perd le droit de récupérer le matériel. Celui-ci reste dans l’actif de l’entreprise en difficulté et pourra être vendu au profit de l’ensemble des créanciers. Toutefois, il est important de noter que la perte du droit de reprendre le bien physique n’éteint pas nécessairement la créance monétaire du bailleur (indemnité de résiliation, par exemple), qui doit toujours être déclarée au passif.
L’impact de la procédure collective sur les options de fin de contrat
La procédure collective influence également les options qui s’offrent normalement en fin de contrat.
Dans le cadre d’un plan de continuation
Si l’entreprise est sauvée via un plan de continuation, le contrat de crédit-bail se poursuit. Le plan peut imposer des délais de paiement pour les dettes antérieures (loyers impayés avant le jugement). Concernant l’option d’achat en fin de contrat, l’article L626-18 du Code de commerce précise une règle importante : vous ne pourrez lever l’option et devenir propriétaire du bien que si l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat (loyers courants, arriérés inclus dans le plan, valeur résiduelle) est effectivement réglée. Les délais de paiement accordés par le plan prennent fin si vous levez l’option.
Dans le cadre d’un plan de cession
Si l’entreprise est cédée à un repreneur, le tribunal peut décider de transférer le contrat de crédit-bail au repreneur si le matériel est jugé nécessaire au maintien de l’activité cédée (article L642-7 du Code de commerce). Le repreneur doit alors exécuter le contrat aux conditions initiales (payer les loyers futurs). Pour l’option d’achat, une règle spécifique s’applique : le repreneur ne peut la lever qu’en payant les sommes restant dues (loyers futurs + arriérés du cédant + valeur résiduelle), mais ce paiement est plafonné à la valeur vénale du bien estimée au moment de la cession. C’est un point crucial qui peut être avantageux ou désavantageux pour le repreneur et le bailleur selon les cas.
La levée d’option pendant la procédure
Depuis une réforme de 2008 (articles L622-7 et L641-3 du Code de commerce), il existe une possibilité, sous conditions strictes et avec l’autorisation du juge-commissaire, de payer une partie des dettes antérieures spécifiquement pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail pendant la période d’observation ou même en liquidation, si cela est justifié par la poursuite de l’activité ou l’intérêt de la procédure (et si le prix de l’option est inférieur à la valeur du bien).
La confrontation du crédit-bail mobilier avec une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est un domaine technique où les enjeux sont élevés tant pour le locataire que pour le bailleur. Les règles visent un équilibre délicat entre la nécessité de préserver les chances de survie de l’entreprise, le respect des droits du propriétaire du bien, et l’égalité entre les créanciers.
Si votre entreprise traverse une période difficile et que vous détenez des équipements en crédit-bail, il est fortement recommandé de solliciter un conseil juridique spécialisé sans tarder. Notre cabinet peut vous accompagner pour naviguer dans cette situation complexe et défendre au mieux vos intérêts face aux différentes options et contraintes de la procédure collective.
Sources
- Code de commerce, Livre VI (Difficultés des entreprises) : articles L622-7, L622-13, L622-17, L622-21, L622-24, L624-9, L624-10, L626-18, L641-3, L642-7 et articles réglementaires associés (partie R).
- Code monétaire et financier : articles R. 313-3 et suivants (Publicité).