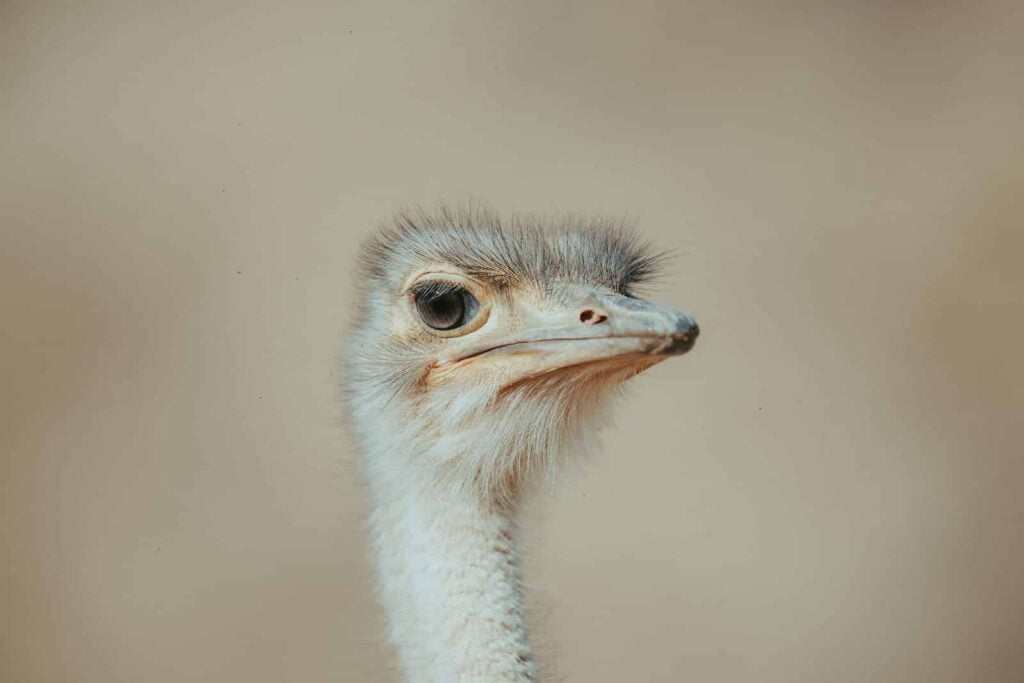Le montage associant prêt in fine et assurance-vie a longtemps été présenté comme une stratégie d’investissement idéale. D’un côté, un crédit dont on ne rembourse que les intérêts pendant la durée du prêt, de l’autre un placement censé générer suffisamment de rendement pour rembourser le capital à l’échéance. Sur le papier, l’opération semblait parfaite. Dans les faits, de nombreux investisseurs se sont retrouvés piégés par les contre-performances boursières, conduisant à un contentieux nourri depuis la crise financière de 2008.
I. Le fonctionnement et les promesses du montage
Le prêt in fine présente une caractéristique essentielle : l’emprunteur ne rembourse que les intérêts pendant toute la durée du crédit, le capital étant intégralement remboursé à l’échéance. Comme le souligne Dominique Legeais dans le JurisClasseur Commercial (Fasc. 346-1), ce type de prêt est souvent associé à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, généralement en unités de compte, nanti au profit de la banque prêteuse.
Le mécanisme semble ingénieux : les fonds empruntés sont placés sur l’assurance-vie, les intérêts du prêt sont payés mensuellement, et la valorisation espérée du contrat doit permettre de rembourser le capital à l’échéance. Ce montage est traditionnellement présenté sous un jour favorable par les conseillers bancaires, qui mettent en avant plusieurs avantages :
- L’effet de levier lié aux taux de crédit faibles par rapport aux rendements espérés
- La déductibilité des intérêts d’emprunt dans certains cas d’investissements locatifs
- Les avantages fiscaux de l’assurance-vie (abattements, fiscalité allégée après 8 ans)
« Dans l’esprit des souscripteurs, la valorisation des contrats à l’échéance doit permettre le remboursement du prêt in fine. Mais la crise a rendu ses prévisions souvent vaines, » note Legeais.
II. Les risques souvent occultés
Le principal angle mort de ce montage réside dans l’aléa boursier. Les unités de compte en assurance-vie ne bénéficient d’aucune garantie en capital et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers. La crise de 2008, puis les périodes de volatilité qui ont suivi, ont démontré que les performances pouvaient être très inférieures aux projections initiales.
Un aspect rarement explicité concerne l’accumulation des frais qui grèvent le rendement : frais d’entrée sur l’assurance-vie (jusqu’à 5%), frais de gestion annuels, frais d’arbitrage, sans oublier les frais bancaires liés au prêt et au nantissement. Ces coûts peuvent représenter plusieurs points de performance perdus chaque année.
La jurisprudence a progressivement reconnu l’indivisibilité entre les différents contrats formant le montage. Comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2014, cette indivisibilité peut avoir plusieurs conséquences juridiques importantes, notamment « la renonciation de l’une des parties à s’en prévaloir entraîne la disparition de l’autre » (RD bancaire et fin. 2014, comm. 202).
Un autre élément crucial est la distinction entre client averti et non averti. La Cour de cassation considère que « l’averti doit avoir la capacité d’appréhender la nature du produit, les risques et l’opportunité de l’opération » (Cass. com., 8 mars 2011). Pour les clients non avertis, la jurisprudence a progressivement renforcé les obligations des établissements financiers.
III. Responsabilités et solutions
Les établissements financiers sont soumis à un arsenal d’obligations, tant au titre du Code des assurances pour la distribution de l’assurance-vie que du Code monétaire et financier pour la prestation de services d’investissement.
L’article L. 132-27-1 du Code des assurances impose à l’assureur de « préciser les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur » et de fournir « les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé ». De même, l’article L. 533-12 du Code monétaire et financier exige que les informations présentent « un contenu exact, clair et non trompeur. »
En cas de litige, les tribunaux examinent désormais si le montage est complexe ou banal, si l’investisseur avait l’expérience de ce type de produit, et si ce dernier était adapté à ses exigences ou ses besoins. Comme l’a jugé la Cour de cassation le 27 mars 2014, le prestataire doit « attirer l’attention sur les caractéristiques du produit proposé, sur les aspects les moins favorables pouvant résulter de l’évolution des cours et sur le fait qu’il pouvait être exposé à une perte de capital » (Cass. 2e civ., n° 13-16.672).
Face à un montage devenu défavorable, plusieurs solutions s’offrent à l’investisseur :
- La renégociation avec l’établissement prêteur (allongement de la durée, baisse du taux)
- La recherche d’une responsabilité pour manquement au devoir d’information, de mise en garde ou de conseil
- La requalification du contrat en cas de non-respect des obligations formelles (mention du TEG)
- Dans certains cas, l’action en nullité pour dol ou erreur
Avant de s’engager dans un tel montage, la prudence commande de :
- Exiger des simulations de performance négative des marchés
- Comparer le coût total du crédit avec le rendement espéré après frais
- Vérifier l’adéquation du montage avec sa situation patrimoniale globale
- Obtenir des confirmations écrites sur les caractéristiques et risques du produit
Ce type de montage n’est pas intrinsèquement néfaste, mais nécessite une compréhension approfondie des mécanismes et des risques impliqués. L’obligation d’information de la banque doit être complétée par une vigilance accrue de l’investisseur.
Sources
- Legeais, D. (2015). Responsabilité de la banque et ingénierie financière. JurisClasseur Commercial, Fasc. 346-1.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-14.456
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13-16.672
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er octobre 2014, RD bancaire et fin. 2014, comm. 202
- Code des assurances, article L. 132-27-1
- Code monétaire et financier, article L. 533-12