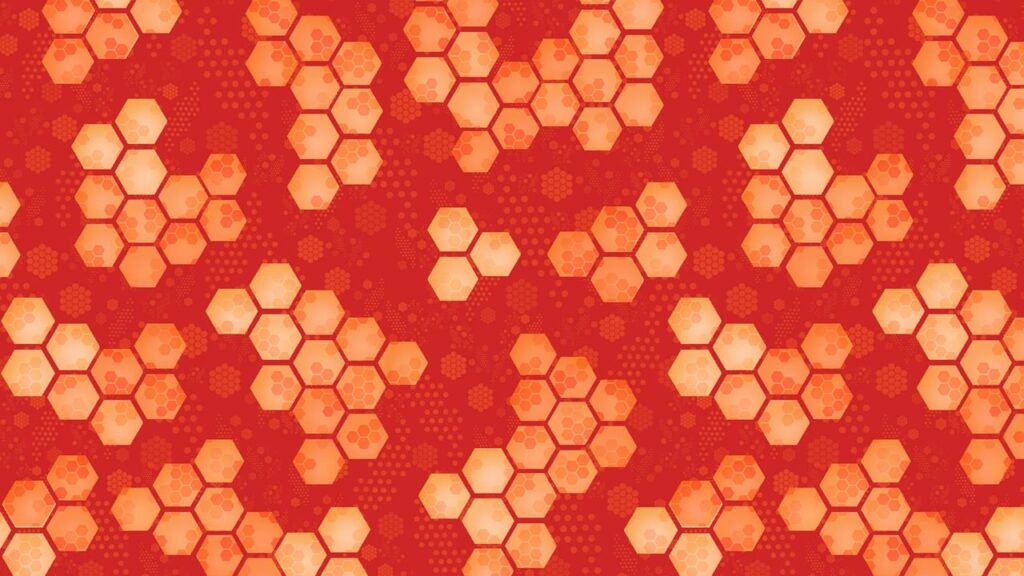L’idée de voir un commissaire de justice, anciennement huissier de justice, frapper à son domicile pour effectuer une saisie est une source d’angoisse. Cette crainte est d’autant plus vive pour une personne en situation financière précaire, voire une personne insolvable. Mais que se passe-t-il réellement lorsque le débiteur est considéré comme non solvable ? Un commissaire de justice peut-il légalement saisir les biens d’une personne sans ressources suffisantes ? La réponse est nuancée. Si la procédure reste possible, elle est strictement encadrée par la loi pour protéger la dignité du débiteur, garantir le respect de ses droits et lui assurer un minimum vital. Cet article détaille les règles applicables, vos droits et les recours possibles.
Rôle et pouvoirs du commissaire de justice (ex-huissier)
Depuis la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice est l’officier public et ministériel chargé de l’exécution des décisions de justice. Son intervention en matière de procédure de recouvrement de créances est souvent la dernière étape d’un processus qui débute par des tentatives de règlement amiable. Il n’agit jamais de sa propre initiative mais toujours dans un cadre légal précis, mandaté par un créancier qui cherche à récupérer les sommes qui lui sont dues. Son rôle, qui s’inscrit dans une mission de service public, est donc d’appliquer la loi et de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée, comme les saisies, pour garantir les droits du créancier.
La condition essentielle à toute saisie : le titre exécutoire
L’intervention du commissaire de justice pour une saisie est subordonnée à une condition non négociable : la possession d’un titre exécutoire. Il s’agit d’un acte juridique qui constate officiellement une créance certaine, liquide (dont le montant est déterminé) et exigible. Sans ce document, aucune mesure ne peut être engagée, et un huissier ne pourra pas saisir sans jugement ou titre équivalent. Les principaux titres exécutoires sont :
- Les décisions de justice devenues définitives (jugements, ordonnances, arrêts).
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (par exemple, un acte de prêt immobilier).
- Une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire.
- Les titres délivrés par l’administration fiscale ou d’autres organismes publics (avis à tiers détenteur).
- Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
Il est donc essentiel de comprendre qu’un commissaire de justice ne peut pas procéder à une saisie sur la base d’une simple facture impayée ou d’une lettre de relance, même envoyée en recommandé avec accusé de réception. Une mise en demeure ou l’intervention d’une société de recouvrement ne suffisent pas. Une décision de justice ou un acte ayant la même force est indispensable pour obtenir l’autorisation de saisir.
Les différentes formes de saisie et leurs spécificités
Selon la nature des biens du débiteur, le commissaire de justice peut recourir à différents types de saisie, chaque procédure ayant un cadre et des aspects spécifiques. Pour une vision exhaustive, il est utile de comprendre le cadre légal et les spécificités de chaque procédure de saisie.
- La saisie-vente (saisie mobilière) : Souvent initiée par un commandement de payer, elle concerne les biens meubles du débiteur (voiture, mobilier, matériel informatique) qui sont inventoriés puis vendus aux enchères pour rembourser le créancier.
- La saisie-attribution (saisie sur compte bancaire) : L’officier saisissant prélève directement l’argent disponible sur les comptes bancaires du débiteur. Cette procédure est très efficace mais strictement encadrée pour protéger un minimum vital.
- La saisie des rémunérations (saisie sur salaire) : Une partie du salaire, de la pension de retraite ou des allocations chômage est prélevée directement à la source par l’employeur ou l’organisme payeur, selon un barème légal.
- La saisie immobilière : C’est la procédure la plus lourde, qui vise à saisir un bien immobilier (maison, appartement) appartenant au débiteur propriétaire pour le vendre et apurer la dette.
Quels sont les biens et revenus insaisissables pour protéger le débiteur ?
La loi protège la dignité du débiteur en rendant insaisissables certains biens et revenus considérés comme essentiels pour sa vie et celle de sa famille. Même si une personne est non solvable, elle conserve le droit de garder ces éléments à l’abri des poursuites du créancier.
Le solde bancaire insaisissable (SBI) : un minimum vital protégé
En cas de saisie-attribution sur un compte bancaire, la banque a l’obligation de laisser à la disposition du débiteur un montant minimal, appelé Solde Bancaire Insaisissable (SBI). Le montant de ce SBI est équivalent à celui du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour une personne seule, soit 635,71 € (montant au 1er avril 2024). Cette somme est automatiquement laissée sur le compte pour permettre au débiteur de faire face à ses dépenses alimentaires et essentielles, quelle que soit l’origine des fonds présents sur le compte.
La liste légale du mobilier indispensable à la vie courante
Le législateur a dressé une liste précise des biens meubles qui ne peuvent être saisis, car ils sont jugés nécessaires à la vie quotidienne du débiteur et de sa famille. Cette liste, issue de la procédure civile, est définie à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et inclut notamment :
- Les vêtements et la literie.
- La table et les chaises pour les repas.
- Les objets de ménage pour la conservation et la préparation des aliments.
- Les appareils de chauffage.
- Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Pour une analyse complète, consultez notre guide sur la liste détaillée des biens insaisissables et les protections accordées au débiteur.
Les revenus et allocations à caractère social
De par leur nature, certaines prestations sociales sont totalement ou partiellement insaisissables. Leur objectif est d’assurer un filet de sécurité pour les personnes les plus fragiles. Parmi les revenus protégés, on trouve :
- Le Revenu de Solidarité Active (RSA).
- Les prestations familiales.
- L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée.
- Les allocations logement (APL, ALF, ALS).
Le cas particulier de l’insaisissabilité du patrimoine professionnel
Pour protéger l’outil de travail des entrepreneurs individuels et de toute entreprise, la loi a instauré une séparation entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine personnel. La résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit insaisissable pour ses dettes professionnelles. De même, les biens utiles à son activité professionnelle ne peuvent être saisis que par les créanciers dont la dette est née dans le cadre de cette même activité. Ce principe vise à éviter qu’une difficulté professionnelle n’entraîne la perte de tous les biens personnels de l’entrepreneur.
Réforme de la saisie des rémunérations : la déjudiciarisation expliquée
Une réforme majeure, issue de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, modifie en profondeur la procédure de saisie des rémunérations. Jusqu’à présent gérée par le juge, cette procédure sera entièrement déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice au plus tard le 1er juillet 2025. Cette réforme est une étape importante qui vise à simplifier et accélérer le recouvrement pour le créancier. Pour le débiteur, cela signifie que son interlocuteur principal ne sera plus un magistrat mais directement le commissaire de justice. Un registre numérique des saisies sera mis en place pour centraliser les informations. Le juge de l’exécution conservera un rôle de contrôle et restera compétent pour trancher les éventuelles contestations.
Quels sont les recours du débiteur face à une procédure de saisie ?
Face à une saisie par un huissier, même en situation de non-solvabilité, le débiteur n’est pas démuni. Plusieurs voies de recours et de protection lui sont ouvertes pour faire valoir ses droits et trouver une solution adaptée à la situation financière du débiteur.
Contester la saisie devant le juge de l’exécution (JEX)
Le débiteur saisi a le droit de contester une saisie qu’il estime injustifiée ou disproportionnée. Cette contestation doit être portée devant le JEX, qui est le magistrat compétent pour tous les litiges relatifs à l’exécution forcée. Les motifs de contestation peuvent être variés : irrégularité dans la procédure, saisie portant sur un bien insaisissable, montant de la dette erroné, ou encore absence de titre exécutoire valable. Le délai pour agir est généralement d’un mois à compter du jour de la dénonciation de la saisie au débiteur.
La procédure de surendettement : une protection efficace
Pour une personne physique de bonne foi confrontée à une situation financière sans issue, la procédure de surendettement est une protection essentielle. Le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement de la Banque de France est une démarche gratuite. Si le dossier est déclaré recevable, une des conséquences immédiates est la suspension automatique de toutes les procédures de saisie en cours et l’interdiction d’en engager de nouvelles pour une durée maximale de deux ans. Cette mesure offre un répit au débiteur, le temps que la commission élabore un plan de redressement ou, dans les cas les plus critiques, une procédure de rétablissement personnel. Pour en savoir plus, découvrez tout savoir sur la procédure de traitement du surendettement.
Négocier un plan de remboursement amiable
Avant d’en arriver aux mesures les plus contraignantes, une négociation directe avec le créancier ou le commissaire de justice reste toujours une option. Proposer un échéancier de paiement réaliste pour régler sa dette, même pour de petites sommes, peut démontrer votre bonne foi et permettre d’obtenir un accord amiable. Cet arrangement permet de suspendre les poursuites et d’éviter les frais supplémentaires liés à une saisie. Il est conseillé de formaliser cet accord par écrit pour en conserver une preuve.
Le délai de prescription d’une dette : une protection pour le débiteur
La prescription est un mécanisme juridique qui éteint le droit d’un créancier à poursuivre le recouvrement de sa dette après un certain délai. C’est une protection importante, car le débiteur ne peut être poursuivi indéfiniment. Les délais varient selon le contexte, la nature de la dette et du titre exécutoire.
Une distinction fondamentale doit être faite :
- Pour un titre exécutoire judiciaire (un jugement) : Le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter la décision de justice, comme le prévoit l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
- Pour les autres dettes (y compris celles dans un acte notarié) : C’est le délai de prescription de la créance elle-même qui s’applique. Par exemple, une dette de consommation se prescrit par 2 ans (article L. 218-2 du code de la consommation), une créance commerciale par 5 ans.
Ainsi, un créancier ne peut pas attendre indéfiniment pour agir. Si le délai de prescription est écoulé, le débiteur pourra soulever ce moyen de défense pour faire échec à la saisie, même si la dette n’a jamais été payée.
Ce qu’il faut retenir
En définitive, un commissaire de justice peut légalement engager une procédure de saisie contre une personne non solvable, mais son action est loin d’être illimitée. La loi a mis en place de nombreux garde-fous pour protéger le débiteur et préserver sa dignité. Voici les points essentiels à mémoriser :
- Titre exécutoire obligatoire : Pas de saisie sans un jugement ou un acte équivalent.
- Saisie possible mais encadrée : L’insolvabilité ne bloque pas la procédure si le débiteur possède des biens saisissables.
- Protection des biens essentiels : Le Solde Bancaire Insaisissable (SBI), le mobilier de première nécessité et la plupart des aides sociales sont protégés.
- Réformes en cours : La procédure de saisie des rémunérations va être profondément modifiée, avec un transfert de compétence aux commissaires de justice.
- Multiples recours pour le débiteur : La contestation devant le JEX, le dossier de surendettement et l’invocation de la prescription sont des défenses efficaces.
La question de la saisie est complexe et les enjeux financiers et personnels sont importants. L’accompagnement par un professionnel du droit est donc souvent indispensable. Si vous êtes confronté à une saisie, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat compétent pour son expertise, analyser votre situation, vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter et défendre vos droits. Notre cabinet, intervenant notamment à Paris et en régions, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches délicates.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 111-1 et suivants (Principes généraux)
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 112-1 à L. 112-4 (Biens saisissables et insaisissables)
- Code du travail, articles L. 3252-1 et suivants (Saisie des rémunérations)
- Code de la consommation, articles L. 711-1 et suivants (Procédure de surendettement)
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027