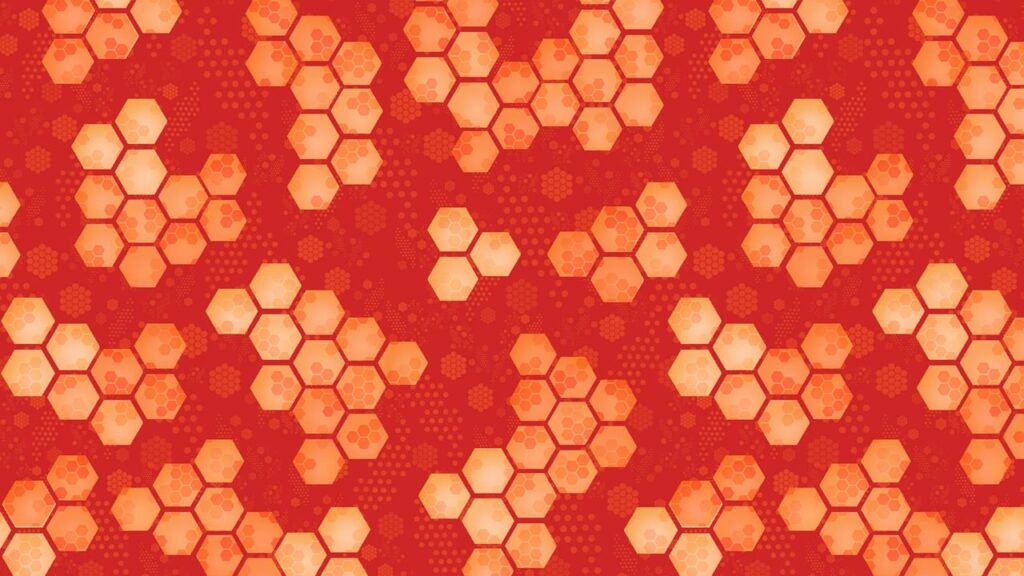La saisie-contrefaçon constitue une procédure probatoire unique en droit français. Son exécution, pour préserver sa validité, requiert une attention particulière, et l’accompagnement par un avocat expert en voies d’exécution peut s’avérer déterminant. Entre respect strict des termes de l’ordonnance et règles procédurales, chaque étape compte.
Les intervenants dans la procédure
Le rôle central de l’huissier de justice
L’huissier tient une place déterminante dans l’exécution de la saisie-contrefaçon. Lui seul peut instrumenter, en vertu de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Cette règle ne souffre aucune exception comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2009 (Com. 3 mars 2009, n° 08-11.236).
L’huissier doit être clairement identifié dans le procès-verbal de saisie. Une simple signature lisible suffit selon le TGI de Paris (30 janvier 1998). Pourtant, l’indication de la seule société civile professionnelle sans mentionner l’huissier instrumentaire entraîne la nullité du procès-verbal (Civ. 1re, 31 octobre 2012).
Son procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux (Com. 4 janvier 1984), conservant sa valeur probante même s’il n’est pas rédigé personnellement par l’huissier du fait de la technicité de la description (Nancy, 12 mars 1991).
L’assistance d’experts
L’huissier peut s’entourer d’experts pour l’épauler dans les aspects techniques de la saisie. Ces experts n’ont pas l’obligation d’être inscrits sur une liste d’experts judiciaires (Paris, 11 mars 2005). Leur recours doit néanmoins être autorisé par l’ordonnance (TGI Paris, 28 mai 1980).
Un principe fondamental s’impose : l’indépendance de l’expert. La Cour de cassation lie cette exigence à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Com. 28 avril 2004, n° 02-20.330). Un expert membre de l’Agence pour la protection des programmes ne peut intervenir si l’APP est partie à l’instance (Civ. 1re, 6 juillet 2000, n° 97-21.404).
Les experts doivent se limiter à une assistance technique (Paris, 5 novembre 2002). Ils ne peuvent emporter des disques durs à des fins d’analyse (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), ce qui bafouerait le principe du contradictoire.
Les conseils en propriété industrielle, souvent sollicités comme experts, bénéficient d’une présomption d’indépendance garantie par leurs règles déontologiques (Com. 8 mars 2005).
Les autres intervenants
La force publique peut prêter main-forte en cas de résistance du saisi. Cette assistance est possible même si l’ordonnance ne le précise pas, en vertu de la formule exécutoire (TGI Paris, 29 mai 1987).
L’huissier peut s’adjoindre les services d’un serrurier pour l’ouverture des locaux ou des meubles, ou être accompagné de techniciens pour effectuer des mesures ou démonter un système (Paris, 14 mars 1991).
Le requérant ou ses préposés ne peuvent assister aux opérations de saisie (Com. 8 juillet 2008, n° 07-15.075), même si l’ordonnance l’autorise (Paris, 17 mars 2017). Leur présence risquerait d’orienter les constatations et porterait atteinte au secret des affaires.
Les modalités pratiques de la saisie
Signification préalable de l’ordonnance
L’huissier doit remettre au saisi une copie de l’ordonnance sur requête avant de débuter les opérations de saisie (CPI, art. R. 521-3, R. 615-2-1, R. 623-51-1, R. 722-3). Cette copie doit comprendre la requête annexée (TGI Paris, 12 février 2010).
Cette obligation découle du respect du principe du contradictoire. Selon la Cour de cassation, « le respect du principe de la contradiction qui fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l’ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne » (Civ. 2e, 10 février 2011, n° 10-13.894).
Une simple lecture ou exhibition de l’ordonnance ne suffit pas (Paris, 31 mars 1977; TGI Paris, 11 janvier 1995). Le défaut de remise cause grief au saisi et justifie la nullité de la procédure (Paris, 5 juillet 2019).
Horaires et délais d’intervention
La saisie s’effectue entre 6 heures et 21 heures, conformément aux dispositions générales relatives à l’exécution (C. pr. civ., art. 664), sauf précision contraire dans l’ordonnance.
Un délai raisonnable doit s’écouler entre la signification et le début des opérations. Ce délai s’apprécie au cas par cas : quinze minutes ont suffi dans plusieurs affaires (TGI Paris, 19 mai 2017), parfois même dix minutes (Paris, 8 février 2013) ou quatre minutes (Rennes, 14 mars 2017).
En revanche, un délai d’une minute a été jugé insuffisant dans certains cas (Bordeaux, 5 mai 2014), mais accepté dans d’autres lorsque le saisi avait invité l’huissier à débuter les opérations (Paris, 12 avril 2016).
Respect du périmètre des mesures autorisées
L’huissier doit suivre strictement les termes de l’ordonnance. Toute extension de sa mission peut entraîner la nullité de la procédure.
Il ne peut intervenir qu’auprès de la personne désignée par l’ordonnance (TGI Paris, 21 janvier 1994), dans les seuls locaux visés (Paris, 29 octobre 1984) et uniquement pour la contrefaçon suspectée se rapportant aux titres en vertu desquels la mesure intervient (TGI Paris, 28 novembre 1986).
La jurisprudence s’en tient à une interprétation stricte de l’ordonnance (Paris, 23 septembre 1998). L’huissier ne peut pas étendre son investigation à d’autres marques que celles mentionnées dans l’ordonnance (Com. 3 juillet 2019, n° 16-28.543).
Le déroulement des opérations
Comportement du saisi
Le saisi doit apporter son concours à la justice. L’article 10 du Code civil dispose que « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » et que celui qui s’y soustrait « peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile ».
Il ne peut faire obstacle à la procédure, par exemple en coupant l’électricité pour empêcher la mise en marche d’un appareil (TGI Paris, 16 janvier 1989).
Des pièces remises spontanément par le saisi peuvent être annexées au procès-verbal, même si elles ne figurent pas sur la liste de celles que l’huissier pouvait appréhender (TGI Paris, 27 janvier 2009).
Questionnement et constatations
L’huissier peut poser toutes questions utiles pour l’accomplissement de sa mission (Paris, 15 janvier 1997) et recueillir les explications du saisi ou de ses salariés (TGI Paris, 7 mai 1997).
Ces questionnements ne doivent pas dégénérer en interrogatoire. Le saisi conserve le droit de garder le silence.
L’huissier ne peut utiliser des stratagèmes comme se faire passer pour un client (Paris, 25 janvier 2013) ou ouvrir un compte client pour acquérir un produit (Civ. 1re, 20 mars 2014, n° 12-18.518).
Durée des opérations
Les opérations peuvent s’étendre sur plusieurs jours si nécessaire (TGI Paris, 16 janvier 1989; Paris, 30 mai 2001). La jurisprudence l’admet expressément.
Une fois la saisie accomplie, l’huissier ne peut revenir sur les lieux pour compléter ses investigations (Paris, 28 février 2001). La clôture du procès-verbal met fin à la mission de l’huissier.
Le procès-verbal de saisie
Contenu et formalisme
Le procès-verbal doit respecter les dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile. Il doit mentionner la date, l’identité du requérant, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier, et l’identité du destinataire.
Le défaut d’identification du requérant entraîne la nullité du procès-verbal (Paris, 27 février 1989). De même, l’indication de la SCP sans l’identité de l’huissier instrumentaire peut être sanctionnée (Com. 20 octobre 1998, n° 95-15.804).
Les personnes accompagnant l’huissier doivent être mentionnées, même si cette précision peut être donnée ultérieurement (Paris, 1er février 2006).
Remise au saisi
L’huissier doit remettre au saisi une copie du procès-verbal. Cette remise est habituellement immédiate, mais peut intervenir ultérieurement, par exemple trois jours après la clôture (Paris, 14 mars 1991).
Le procès-verbal n’a pas à être signé par le saisi (Paris, 29 janvier 1991). La jurisprudence est partagée quant à la sanction du défaut de remise, considéré tantôt comme un vice de forme (TGI Paris, 12 septembre 1990), tantôt comme une nullité de fond (TGI Lyon, 27 mai 1971).
Valeur probante
Le procès-verbal confère un caractère authentique aux constatations de l’huissier. Il fait foi jusqu’à inscription de faux, même si l’huissier est assisté d’un expert (TGI Paris, 22 novembre 1996).
Cette valeur probante ne s’étend pas aux éléments apportés par l’expert que l’huissier aurait simplement transcrits (Paris, 1er juillet 1977). L’absence de description précise diminue la force probante du procès-verbal (TGI Paris, 7 décembre 1990).
Les photographies, films ou photocopies annexés au procès-verbal ont une forte valeur probante (Paris, 28 mai 1985), à condition qu’ils portent le sceau de l’huissier. Ces éléments sont cruciaux pour les suites de la saisie-contrefaçon et l’engagement d’une action au fond.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle : articles L.332-1 à L.332-4, L.521-4, L.615-5, L.623-27-1, L.716-4-7, L.722-4, R.521-3, R.615-2-1, R.623-51-1, R.722-3
- Code de procédure civile : articles 10, 114, 454, 456, 496, 497, 648, 664, 680
- Cour de cassation, chambre commerciale : 3 mars 2009 (n° 08-11.236), 4 janvier 1984, 28 avril 2004 (n° 02-20.330), 8 juillet 2008 (n° 07-15.075), 20 octobre 1998 (n° 95-15.804), 3 juillet 2019 (n° 16-28.543)
- Cour de cassation, 1ère chambre civile : 31 octobre 2012, 6 juillet 2000 (n° 97-21.404), 20 mars 2014 (n° 12-18.518)
- Cour de cassation, 2ème chambre civile : 10 février 2011 (n° 10-13.894)
- Cour d’appel de Paris : 11 mars 2005, 17 mars 2017, 31 mars 1977, 5 juillet 2019, 29 octobre 1984, 23 septembre 1998, 15 janvier 1997, 25 janvier 2013, 30 mai 2001, 28 février 2001, 1er février 2006, 29 janvier 1991, 1er juillet 1977, 28 mai 1985
- Tribunal de grande instance de Paris : 30 janvier 1998, 28 mai 1980, 12 février 2010, 11 janvier 1995, 21 janvier 1994, 28 novembre 1986, 16 janvier 1989, 27 janvier 2009, 7 mai 1997, 22 novembre 1996, 7 décembre 1990
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence : 3 septembre 2009
- Cour d’appel de Nancy : 12 mars 1991
- Cour d’appel de Bordeaux : 5 mai 2014
- Cour d’appel de Rennes : 14 mars 2017