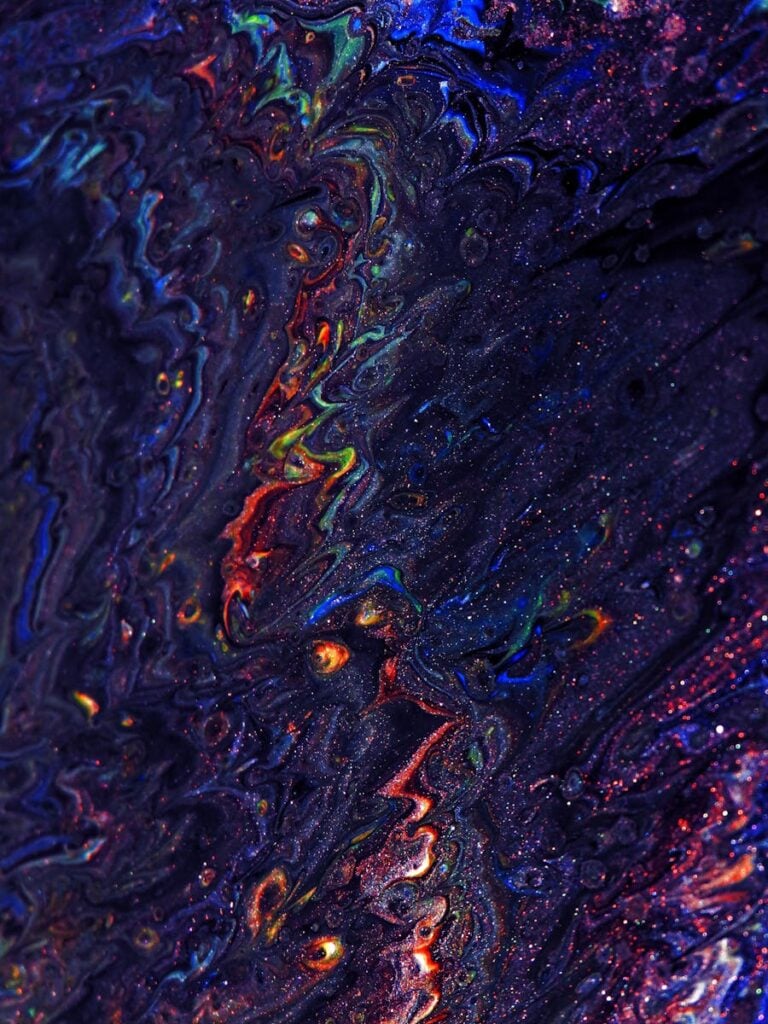Dans les méandres du contentieux judiciaire, un mécanisme hybride émerge : le contrat judiciaire. Ni totalement conventionnel, ni pleinement judiciaire, il puise sa force dans la volonté des parties tout en bénéficiant de l’onction du juge. Souvent méconnu, ce dispositif permet aux plaideurs d’élaborer ensemble une solution à leur litige, sous le regard bienveillant du magistrat.
Deux conditions cumulatives définissent le contrat judiciaire : un contrat valablement formé entre les parties, puis l’intervention du juge qui le consacre. Avant toute chose, ce mécanisme plonge ses racines dans la liberté contractuelle.
Section 1 : Le consentement des parties dans le contrat judiciaire
Le contrat judiciaire se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La volonté des parties constitue son fondement essentiel.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le contrat judiciaire n’existe qu’à condition que les parties se soient engagées dans les mêmes termes. Un arrêt du 25 juin 2008 précise que le contrat judiciaire exige « un accord complet et préalable des parties sur l’ensemble des éléments du contrat » (Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-10.511).
Ce consentement doit être intègre et non vicié, comme l’exige le droit commun des contrats. Un échange de conclusions identiques par les parties peut cristalliser cet accord, qui devient contrat judiciaire lorsqu’il est constaté par le juge (Civ. 3e, 29 mars 1995, n° 93-12.023).
Le consentement peut parfois être tacite (Soc. 26 avril 1966), mais jamais équivoque (Civ. 1re, 3 juin 1964). Les juges doivent tenir compte des réserves exprimées par les parties (Soc. 3 mars 1988, n° 85-42.355).
Point crucial : le contrat judiciaire n’est possible que dans les matières dont les parties ont la libre disposition (Civ. 2e, 15 juillet 1981, n° 80-12.643). Il doit respecter l’ordre public, comme le souligne un arrêt du 10 juillet 1895.
Section 2 : La capacité des parties de contracter
La capacité est la deuxième condition fondamentale posée par l’article 1128 du Code civil. Celle-ci est présumée en vertu de l’article 1145 du même code.
Dans le contrat judiciaire, cette capacité doit s’apprécier sous un double éclairage :
- La capacité contractuelle classique
- La capacité processuelle des parties
Le professeur Muller définit le contrat judiciaire comme « un acte processuel de nature conventionnelle révélant la faculté pour les parties de disposer de leur droit d’agir » (Muller, Le contrat judiciaire en droit privé, thèse, Paris I, 1995).
Cette capacité trouve cependant ses limites. Le contrat judiciaire ne peut exister lorsque les parties n’ont pas le pouvoir de mettre fin à l’instance par leur volonté, notamment quand l’intervention du juge est imposée par la loi.
L’office du juge limite également la portée du contrat judiciaire, particulièrement quand il s’agit d’organisation et de fonctionnement de la justice. Mais cette limitation concerne davantage l’objet du contrat que la capacité des parties.
Section 3 : Le contenu licite et certain du contrat judiciaire
Le contenu du contrat judiciaire présente une particularité : sa dimension judiciaire.
Il peut porter sur la résolution du litige ou sur l’aménagement de la procédure. Il reflète la diversité des accords processuels. Le professeur Cadiet distingue deux grandes catégories :
- Les « conventions de disposition processuelle » (accord sur les points de droit soumis au juge)
- Les « conventions d’administration processuelle » (demande conjointe de renvoi d’audience)
Cette classification permet de mieux comprendre l’office du juge. Quand l’accord porte sur le droit d’action, il s’impose au juge car les parties disposent librement de ce droit. Quand il vise simplement l’aménagement procédural, le juge doit y consentir car cela touche à l’organisation du service public de la justice.
Le contrat judiciaire a pour finalité de donner à une solution conventionnelle la force d’un acte authentique. En d’autres termes, les parties cherchent à obtenir par voie conventionnelle un acte doté de force exécutoire.
L’articulation entre exigences contractuelles et spécificités judiciaires
Le contrat judiciaire se situe au carrefour du droit des contrats et du droit processuel. Il épouse les contours du droit commun des contrats tout en intégrant les particularités du contexte judiciaire.
Certains arrêts illustrent la primauté du fondement contractuel. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « la disposition du jugement se bornant à donner acte aux époux de leur accord est dépourvue de toute valeur juridique indépendamment de cet accord préalable » (Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-10.511).
L’intervention du juge n’est donc pas créatrice de droits. Elle ne fait que constater l’existence de l’accord et lui conférer une authenticité qui le renforcera. Le conventionnel prime le judiciaire.
Sans autorité de chose jugée, le contrat judiciaire n’a que l’autorité de la chose convenue. Il ne peut être remis en cause que par les voies de nullité contractuelle, notamment celles fondées sur les vices du consentement (Civ. 2e, 20 octobre 1982, n° 81-14.296).
Vous envisagez une démarche transactionnelle dans un litige en cours ? Vous souhaitez que votre accord bénéficie de l’onction judiciaire pour plus de sécurité ? Notre cabinet vous accompagne dans la rédaction et la présentation au juge de votre contrat judiciaire, pour que votre solution négociée acquière toute sa force juridique.
Sources
- Civ. 1re, 25 juin 2008, n° 07-10.511, RTD civ. 2008, p. 662, obs. J. Hauser
- Civ. 3e, 29 mars 1995, n° 93-12.023
- Soc. 3 mars 1988, n° 85-42.355
- Civ. 2e, 15 juillet 1981, n° 80-12.643, Gaz. Pal. 1982. 1. 12, note Viatte
- Civ. 1re, 3 juin 1964, Bull. civ. I, n° 295
- Articles 1128, 1145, 1102 et 1103 du Code civil
- Deharo G., « Contrat judiciaire », Répertoire de procédure civile, septembre 2017, Dalloz
- Muller Y., « Le contrat judiciaire en droit privé », thèse, Paris I, 1995
- Cadiet L., « Les jeux du contrat et du procès : esquisses », Mélanges Farjat, 1999, éd. Frison-Roche