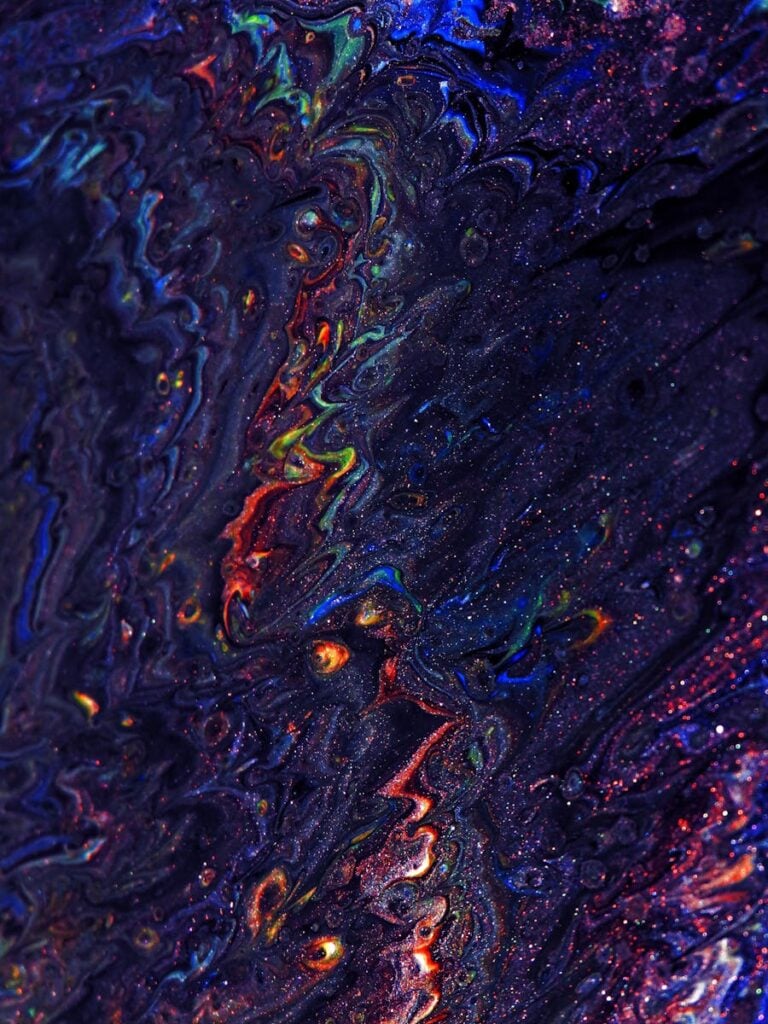La notion de contrat judiciaire se situe à la croisée du droit des contrats et du droit processuel. Cette hybridité soulève des questions complexes quant à l’intervention du juge. Quelle est sa nature? Quelles en sont les limites?
Le document « Contrat judiciaire » de Gaëlle Deharo, professeur à l’ESCE International Business School, nous apporte un éclairage précieux. L’auteur y définit le contrat judiciaire comme « un accord de volontés des parties dont l’existence est constatée par le juge » (n°11). Cette définition apparemment simple cache une réalité juridique plus nuancée.
Section 1 : Contrat judiciaire et actes processuels unilatéraux
Distinguons d’emblée le contrat judiciaire des actes processuels unilatéraux comme l’acquiescement ou le désistement.
L’acquiescement est l’acte par lequel un plaideur reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire. Le désistement est l’acte par lequel une partie renonce à son action. Ces deux mécanismes constituent des actes juridiques unilatéraux dont la coexistence ne conduit pas nécessairement à la formation d’un contrat.
La jurisprudence a tranché cette question. Dans son arrêt du 14 décembre 1992, la Cour de cassation distingue clairement l’acquiescement du contrat judiciaire (Civ. 2e, 14 déc. 1992, n° 91-15.231). Elle confirme cette position dans un arrêt du 18 novembre 1999 (Civ. 2e, 18 nov. 1999, n° 97-15.921).
La différence est subtile mais essentielle: alors que le contrat judiciaire suppose un accord préalable entre les parties, l’acquiescement est un acte unilatéral n’engageant que son auteur.
Section 2 : Contrat judiciaire et jugement d’expédient
Autre distinction importante: le contrat judiciaire diffère du jugement d’expédient.
Le jugement d’expédient est une décision rendue suite à un procès simulé. Les parties feignent un litige pour obtenir une décision du juge. Cet artifice permet aux parties d’obtenir un acte avec l’autorité de la chose jugée.
Comme l’explique Gaëlle Deharo, « s’il y a bien un accord des parties, celui-ci est caché au juge qui statuera comme dans le cas d’un véritable conflit, excluant ainsi la qualification de contrat judiciaire » (n°56).
La particularité du jugement d’expédient réside dans sa force juridique. Contrairement au contrat judiciaire, il constitue une véritable décision juridictionnelle dotée de l’autorité de la chose jugée. Cette qualification ouvre aux parties les voies de recours classiques contre les décisions juridictionnelles.
Un critère décisif distingue ces deux mécanismes: dans le jugement d’expédient, le juge construit sa propre motivation, ignorant l’accord secret des parties. Dans le contrat judiciaire, il se contente de constater l’accord sans y ajouter d’éléments.
Section 3 : Contrat judiciaire et jugement de donné acte
Le contrat judiciaire est souvent rattaché à la catégorie des jugements de donné acte.
Le jugement de donné acte est un acte par lequel le juge constate l’accord des parties sans y ajouter d’éléments personnels. Sa fonction se limite à constater l’accord et lui conférer force exécutoire.
Selon Héron et Le Bars (Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015), « le contrat judiciaire est une sorte de donné acte » (n°324). Cependant, la réciproque n’est pas vraie: tout jugement de donné acte n’est pas un contrat judiciaire. Le donné acte peut constater une simple déclaration unilatérale sans accord préalable.
Particularité notable: le jugement de donné acte, lorsqu’il constitue un contrat judiciaire, est dépourvu de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible d’appel (Civ. 1re, 28 nov. 1973, D. 1974).
Les conséquences pratiques sont importantes. Comme le souligne Roger Perrot, « la décision n’est pas créatrice de droit » (RTD civ. 1997. 744). Elle n’a pas l’autorité de la chose jugée et ne peut être attaquée par les voies de recours ouvertes contre les jugements.
Section 4 : Contrat judiciaire et homologation
L’homologation est l’approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes. Elle confère à l’acte la force exécutoire d’une décision de justice.
L’homologation soulève des questions quant à sa nature. Certains textes font référence à la nature gracieuse de l’homologation, notamment l’article 131-12 du code de procédure civile concernant l’homologation de l’accord de médiation judiciaire.
Cette référence à la matière gracieuse est critiquée par la doctrine. Serge Guinchard parle d’une « inadvertance » et d’une référence faite « à tort » (L’ambition d’une justice civile rénovée, D. 1999, Chron. 65).
La jurisprudence a néanmoins précisé que le contrôle du juge en matière d’homologation est minimal. Dans son arrêt du 26 mai 2011, la Cour de cassation indique que ce contrôle « ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs » (Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 06-19.527).
Concrètement, si le juge refuse l’homologation, l’acte conserve sa nature contractuelle et continue d’obliger les parties. S’il l’accorde, l’acte acquiert la force exécutoire permettant son exécution forcée.
La distinction entre le contrat judiciaire homologué et le simple contrat judiciaire réside principalement dans les effets pratiques: l’homologation confère au contrat la force exécutoire sans modifier sa nature fondamentalement contractuelle.
Quelles voies de recours pour le contrat judiciaire?
Cette question illustre parfaitement l’hybridité du contrat judiciaire.
La jurisprudence est claire: « les contrats judiciaires ne sont pas de véritables jugements » (Civ. 2e, 11 mars 1999, n° 96-21.331). Ils ne sont donc pas susceptibles d’appel.
Le contrat judiciaire relève du régime des conventions. Il ne peut être remis en cause que par l’exercice des voies de nullité principales, notamment celles fondées sur les vices du consentement (Civ. 1re, 13 juin 1961 ; Civ. 2e, 20 oct. 1982).
Cette solution s’applique même lorsque le contrat judiciaire prend la forme d’une homologation. Comme le souligne la doctrine, « l’homologation ne convertit pas la transaction en une décision judiciaire » (Chainais, Ferrand et Guinchard, Procédure civile, 33e éd., 2016).
Le recours à un avocat est indispensable pour naviguer dans ces eaux juridiques troubles. Les nuances entre ces différents mécanismes peuvent avoir des conséquences considérables sur les voies de recours disponibles et in fine sur la protection des droits des parties.
Un avocat expérimenté saura identifier la qualification exacte de l’acte et déterminer la stratégie procédurale adaptée. Il pourra également anticiper les conséquences de chaque qualification sur les voies de recours disponibles et conseiller son client en conséquence.
Sources
- Gaëlle DEHARO, « Contrat judiciaire », Répertoire de procédure civile, Dalloz, septembre 2017
- Civ. 2e, 14 déc. 1992, n° 91-15.231, Bull. civ. II, n° 313
- Civ. 2e, 18 nov. 1999, n° 97-15.921, RTD civ. 2000. 157, obs. R. Perrot
- Civ. 1re, 28 nov. 1973, D. 1974. IR 41
- HÉRON et LE BARS, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, LGDJ, n° 324
- PERROT, Le donné acte : notion et portée, RTD civ. 1997. 744
- GUINCHARD, L’ambition d’une justice civile rénovée, D. 1999. Chron. 65
- Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 06-19.527
- Civ. 2e, 11 mars 1999, n° 96-21.331
- CHAINAIS, FERRAND et GUINCHARD, Procédure civile, 33e éd., 2016, Dalloz, n° 1056