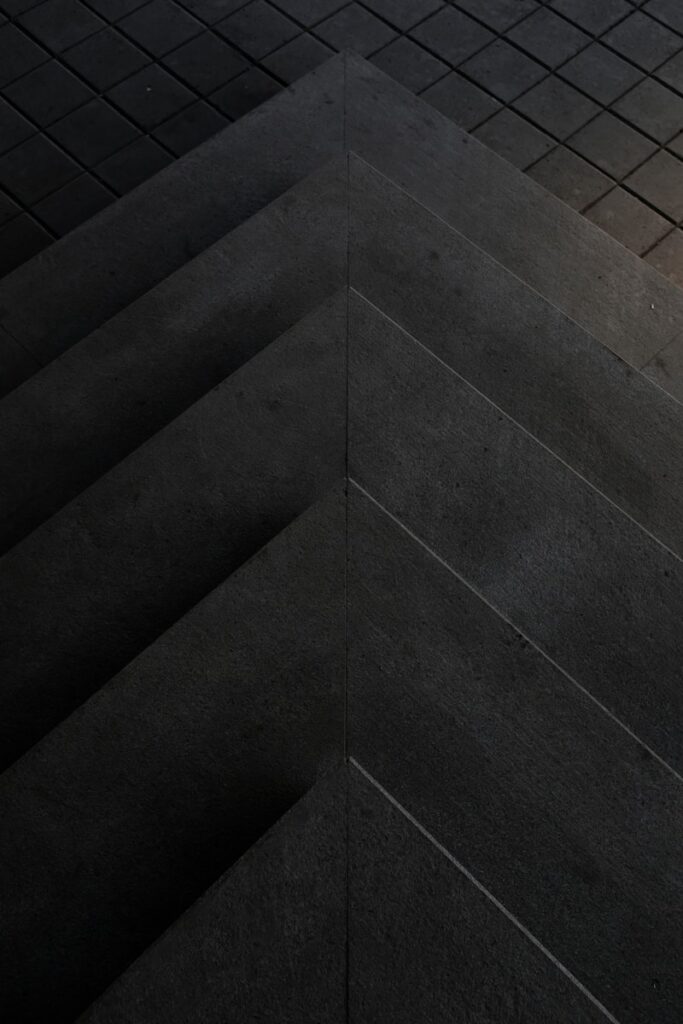L’encadrement des taux d’intérêt constitue un enjeu majeur pour protéger emprunteurs et entreprises contre des pratiques abusives. En France, le dispositif anti-usure permet de plafonner les taux d’intérêt et de sanctionner les prêteurs qui dépassent ces limites. Cette réglementation, souvent méconnue, mérite pourtant toute notre attention tant ses implications pratiques sont importantes.
Qu’est-ce que l’usure en droit français ?
L’usure se définit juridiquement comme le fait de pratiquer un taux d’intérêt supérieur au taux plafond autorisé par la loi. Selon le professeur Carbonnier, l’usure est « l’intérêt excessif, stipulé du débiteur d’un capital ». Ce délit consiste à exiger une rémunération disproportionnée par rapport au service de crédit rendu.
La notion d’usure a connu une longue évolution historique. Dans l’Antiquité romaine, le taux d’intérêt était déjà limité à 8,33%. Au Moyen Âge, la religion chrétienne interdisait totalement le prêt à intérêt, considérant que « l’intérêt est le salaire du temps, et le temps n’appartient qu’à Dieu ». Ce n’est qu’à partir de la Révolution française que le principe du prêt à intérêt fut rétabli.
La réglementation actuelle trouve son origine dans la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, qui a donné une définition générique du taux effectif global (TEG). Cette législation a été codifiée principalement dans le code de la consommation, aux articles L. 314-6 et suivants. Le dispositif a connu plusieurs évolutions, notamment avec la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l’initiative économique, qui a partiellement déplafonné certains taux. Pour une approche exhaustive de l’ensemble des règles, y compris les sanctions associées, consultez notre dossier complet sur le prêt usuraire.
Le domaine d’application de la réglementation sur l’usure
Les opérations soumises à la réglementation
La réglementation sur l’usure s’applique à une large gamme d’opérations de crédit, allant bien au-delà du simple prêt d’argent régi par l’article 1905 du code civil.
Sont notamment concernés :
- Les prêts conventionnels
- Les avances bancaires et découverts en compte
- Les ouvertures de crédit (à concurrence des fonds utilisés)
- L’escompte
- L’affacturage
- La cession de créances professionnelles
- Les conventions d’atermoiement
- Les ventes à tempérament
L’article L. 314-6, alinéa 2, du code de la consommation précise que « les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels ». Cette disposition englobe toutes les variétés de vente à crédit, sauf celles à titre gratuit.
La jurisprudence laisse aux tribunaux un pouvoir de requalification des opérations de crédit déguisées. Comme l’a affirmé la Cour de cassation à plusieurs reprises, peu importe la qualification formelle retenue par les parties, les juges du fond ont la faculté de restituer à la convention sa véritable nature.
Les exceptions au dispositif anti-usure
Certaines conventions échappent à la réglementation sur l’usure, soit en raison de leur objet, soit en raison de la qualité de l’emprunteur.
Sont exclus en raison de leur objet :
- Les opérations de crédit-bail
- Les contrats aléatoires (prêts dont le remboursement est aléatoire)
- Les prêts successifs (qui constituent des opérations distinctes)
- Les émissions de titres de créances
Par ailleurs, depuis la loi sur l’initiative économique du 1er août 2003, complétée par celle du 2 août 2005, ne sont plus soumis aux règles sur l’usure :
- Les prêts accordés aux personnes morales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
- Les prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels
Cette exclusion vise à faciliter l’accès au crédit, notamment pour les entreprises en création ou en difficulté financière. Elle repose sur l’idée que le plafonnement des taux constituerait un frein à l’accès au crédit pour ces acteurs économiques.
Une exception demeure toutefois pour les découverts en compte. L’article L. 313-5-1 du code de la consommation maintient l’encadrement des taux pour cette forme de crédit, même pour les professionnels, afin d’éviter que les établissements de crédit ne profitent des besoins urgents de trésorerie.
L’application dans l’espace
La réglementation sur l’usure soulève des questions particulières en droit international. Le principe général est que les règles relatives à l’usure s’appliquent en droit interne mais également en droit international si la loi française régit le contrat.
La difficulté tient au fait que cette réglementation relève à la fois du droit pénal et du droit civil. En matière pénale, selon l’article 113-2 du code pénal, la loi française s’applique dès lors qu’un des faits constitutifs de l’infraction a eu lieu sur le territoire national. Pour les aspects civils, c’est la loi d’autonomie qui a vocation à s’appliquer, sous réserve des règles du règlement Rome I concernant les contrats conclus avec les consommateurs.
La question de l’ordre public international peut également se poser. Certains auteurs considèrent que la sanction des rémunérations excessives pourrait constituer une règle d’ordre public international français, susceptible d’écarter la loi étrangère compétente qui contreviendrait à notre conception de l’usure.
Le calcul du taux usuraire
Le principe du taux effectif global (TEG)
Le taux effectif global constitue l’outil central de la détection de l’usure. Contrairement au taux nominal, il prend en compte non seulement les intérêts, mais aussi l’ensemble des frais, commissions et rémunérations liés à l’opération de crédit.
Selon l’article L. 314-6 du code de la consommation, un prêt est usuraire lorsque le TEG dépasse de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.
La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête pour déterminer ces taux moyens. Le ministre de l’Économie publie ensuite au Journal officiel les seuils d’usure correspondants pour le trimestre suivant.
Il existe actuellement 11 catégories de prêts de référence, définies par l’arrêté du 24 août 2006 modifié par l’arrêté du 26 septembre 2016. Ces catégories diffèrent selon le type d’emprunteur (consommateur, professionnel, personne morale) et les caractéristiques du crédit (montant, durée, nature).
Le TEG s’apprécie « au moment où le crédit est consenti », c’est-à-dire lors de l’échange des consentements et non lors de la remise des fonds, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2000.
Les éléments constitutifs du TEG
L’article L. 314-1, alinéa 1er, du code de la consommation précise que « sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ».
Sont notamment inclus dans le calcul du TEG :
- Les intérêts proprement dits, calculés sur la base de l’année civile (365 ou 366 jours) et non sur l’année bancaire (360 jours), comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 1995.
- Les frais de dossier, de constitution de sûreté ou d’acte notarié, lorsqu’ils constituent une charge réelle pour l’emprunteur et sont nécessaires pour l’octroi du prêt.
- Les primes d’assurance, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est une condition d’octroi du prêt. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans plusieurs arrêts, notamment celui du 8 novembre 2007.
- Les commissions bancaires liées au crédit, comme la commission du plus fort découvert, celle de dépassement ou celle de prorogation.
- Les frais de préfinancement, comme l’a récemment confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 14 décembre 2016.
En revanche, sont exclus du TEG :
- Les services accessoires, comme la commission de tenue de compte qui rémunère un service distinct du crédit.
- Les frais d’acte notarié pour l’achat d’un bien immobilier, qui ne sont pas directement liés au crédit.
- Les primes d’assurance facultative, qui ne conditionnent pas l’octroi du prêt.
- La clause pénale sanctionnant l’inexécution du contrat, qui n’est pas un élément du coût du crédit mais une sanction.
Par exception, pour les opérations d’escompte ou de découvert d’un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté (actuellement 400 € pour le découvert et 800 € pour l’escompte), un minimum forfaitaire peut être perçu sans être pris en compte dans le TEG.
Le mode de calcul du TEG
Le calcul du TEG varie selon la nature du crédit. Le principe général est celui d’un calcul proportionnel, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 1985.
Pour les crédits destinés à financer une activité professionnelle, l’article R. 314-2 du code de la consommation précise que le TEG est « un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ». Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire.
Pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, le TEG prend la forme du « taux annuel effectif global » (TAEG), introduit par les décrets du 10 juin 2002 transposant une directive européenne. Le TAEG est calculé « à terme échu, selon la méthode d’équivalence ». Cette méthode tient compte de la capitalisation des intérêts et assure l’égalité entre les sommes prêtées et les remboursements effectués par l’emprunteur.
Des règles particulières s’appliquent pour certaines formes de crédit :
- Pour les prêts amortissables, le TEG doit tenir compte du caractère échelonné des remboursements, conformément à l’article L. 314-2 du code de la consommation.
- Pour les découverts en compte, on applique la méthode des nombres, en multipliant chaque solde débiteur par sa durée en jours.
- Pour l’escompte, le taux de période s’entend du rapport entre les intérêts et frais divers et le montant de l’effet escompté, pour une période minimale de dix jours.
La réforme du crédit à la consommation opérée par la loi du 1er juillet 2010 a également introduit la notion de « taux débiteur », défini comme « le taux exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle ». Ce taux, distinct du TEG/TAEG, doit également figurer dans l’offre de crédit.
Les éléments entrant dans le coût total du crédit pour le calcul du TAEG comprennent les frais de dossier, les frais liés aux intermédiaires, les coûts d’assurance obligatoire, les frais d’ouverture et de tenue de compte. En revanche, sont exclus les frais liés à l’acquisition des immeubles (taxes, frais notariés) et les frais résultant du non-respect des obligations contractuelles.
Comment faire face à un soupçon de taux usuraire ?
Face à un crédit potentiellement usuraire, une analyse précise du TEG s’impose. Cette vérification nécessite une expertise juridique et financière approfondie. Des erreurs fréquentes dans le calcul du TEG peuvent conduire à des taux en réalité usuraires.
Notre cabinet peut vous assister dans cette analyse technique pour déterminer si votre crédit présente un caractère usuraire. Nous disposons des compétences spécifiques pour recalculer avec précision le TEG réel de votre contrat et vérifier sa conformité avec les seuils légaux. N’hésitez pas à nous contacter pour un examen personnalisé de vos contrats de crédit.
Sources
- Code de la consommation, articles L. 314-1 à L. 314-9 et R. 314-1 à R. 314-17
- Code monétaire et financier, article L. 313-1
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure
- Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l’initiative économique
- Arrêté du 24 août 2006 modifié par l’arrêté du 26 septembre 2016