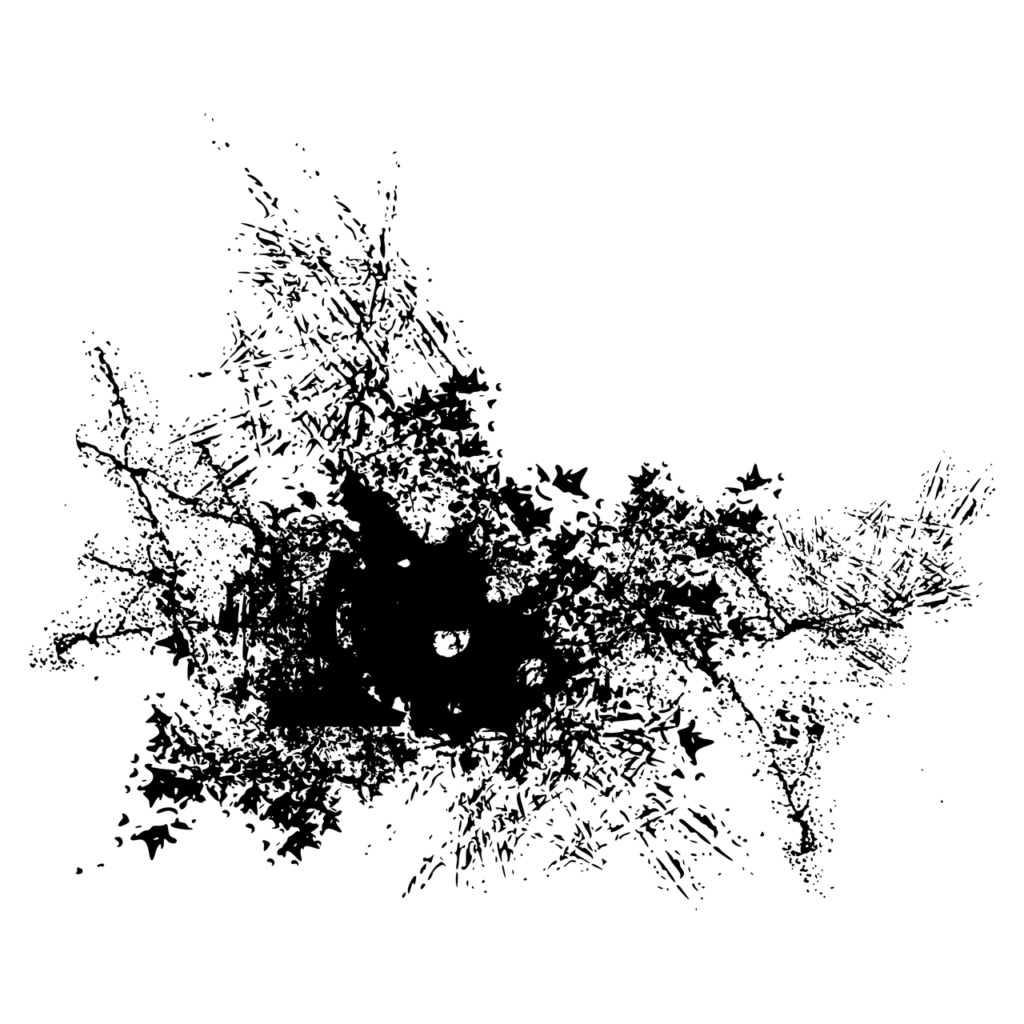Lorsqu’une entreprise entre en procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), les règles générales comme la déclaration de créance ou l’arrêt des poursuites s’appliquent à tous ses créanciers antérieurs. Cependant, la loi reconnaît que certaines situations sont particulières et méritent un traitement spécifique. C’est notamment le cas si vous êtes un vendeur de marchandises impayé, le bailleur des locaux de l’entreprise, ou si vous détenez une garantie classique comme une hypothèque, un gage ou un nantissement.
Comprendre ces règles spécifiques est fondamental, car elles peuvent considérablement modifier vos droits et vos chances de récupérer votre dû. Cet article explore donc ces situations particulières et clarifie également un point essentiel : qu’advient-il de l’échéance de vos créances lorsque votre débiteur est en difficulté ?
Vous avez vendu des marchandises qui n’ont pas été payées ?
La situation du vendeur impayé varie grandement selon que les biens ont été livrés ou non, et surtout selon qu’une clause de réserve de propriété a été prévue ou non.
Situation générale : la vente sans réserve de propriété
Si vous avez vendu des marchandises sans prévoir de clause de réserve de propriété (c’est-à-dire sans préciser que vous restez propriétaire jusqu’au paiement complet), la situation est souvent défavorable une fois les biens livrés.
- Si les marchandises ont été livrées à l’acheteur avant le jugement d’ouverture : Vous perdez malheureusement l’essentiel de vos protections habituelles. L’article L. 624-11 du Code de commerce indique que le privilège du vendeur de meubles (qui vous donnait une priorité sur le prix de vente de ces meubles) ne peut plus être exercé. De même, vous ne pouvez plus demander la résolution (l’annulation) de la vente pour non-paiement. Votre seule option est de déclarer votre créance comme un créancier ordinaire (chirographaire).
- Si les marchandises sont encore en cours de transport au moment du jugement d’ouverture : Vous avez encore une carte à jouer. Tant que les biens ne sont pas physiquement arrivés dans les locaux de l’acheteur (ou chez un commissionnaire agissant pour son compte), vous pouvez les « revendiquer », c’est-à-dire exercer une sorte de droit de stoppage pour empêcher la livraison finale et récupérer vos biens. C’est ce que permet l’article L. 624-13 du Code de commerce.
- Si les marchandises n’ont pas encore été expédiées : Vous êtes en position de force. L’article L. 624-14 du Code de commerce, en lien avec le Code civil, vous reconnaît un droit de rétention. Vous pouvez refuser de livrer les marchandises tant que le prix n’est pas payé, même si l’acheteur est en procédure collective. L’administrateur ou le liquidateur devra payer le prix pour obtenir la livraison.
L’atout maître : la clause de réserve de propriété
Pour pallier la situation précaire du vendeur après livraison, la clause de réserve de propriété est devenue un outil quasi indispensable. Si vous avez pris la précaution d’insérer dans votre contrat de vente (ou vos conditions générales de vente acceptées par l’acheteur) une clause stipulant que vous restez propriétaire des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, vos droits sont considérablement renforcés.
- L’action en revendication : Vous n’êtes plus un simple créancier, mais un propriétaire. Vous pouvez donc réclamer la restitution de VOS biens. Cette action en revendication doit être exercée dans un délai strict de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, comme le prévoit l’article L. 624-9. La condition principale est que les biens existent toujours « en nature » chez le débiteur (non revendus, non transformés de manière irréversible). L’article L. 624-16 vise spécifiquement cette revendication pour les biens vendus avec réserve de propriété.
- La revendication du prix de revente : Si le débiteur a revendu vos biens (alors qu’il n’en était pas encore propriétaire), l’article L. 624-18 vous offre une possibilité intéressante : vous pouvez, sous certaines conditions, revendiquer directement le prix de revente qui est encore dû par le sous-acquéreur au débiteur. C’est un mécanisme complexe mais potentiellement très utile.
La réserve de propriété est une protection puissante, mais sa validité et son opposabilité dépendent de conditions strictes (clause écrite, acceptée par l’acheteur au plus tard à la livraison…).
Vous êtes bailleur d’un immeuble (local commercial, bureaux…) ?
L’ouverture d’une procédure collective à l’égard de votre locataire impacte également vos droits de bailleur, notamment le privilège spécial qui garantit le paiement de vos loyers sur les meubles garnissant les lieux loués.
Votre privilège sur les meubles est limité
En temps normal, ce privilège peut garantir une large partie des loyers dus. Mais en cas de procédure collective, l’article L. 622-16 du Code de commerce vient restreindre son étendue. Votre privilège ne garantit plus que les deux dernières années de loyers impayés avant la date du jugement d’ouverture. Les loyers plus anciens deviennent de simples créances chirographaires.
Le sort du privilège dépend de l’avenir du bail
L’article L. 622-16 distingue ensuite selon que le bail est poursuivi ou résilié après le jugement d’ouverture :
- Si le bail est résilié (par décision de l’administrateur/liquidateur ou du juge) : En plus des deux années antérieures, votre privilège garantit également les loyers et charges de « l’année courante » (calculée souvent à partir de la date anniversaire du bail jusqu’à la résiliation) ainsi que les éventuels dommages et intérêts qui pourraient vous être accordés par le tribunal (par exemple, pour dégradations).
- Si le bail est continué : Pour les loyers à échoir après le jugement d’ouverture, la situation est différente. Vous ne bénéficiez du privilège que si les autres garanties qui vous avaient été données (dépôt de garantie, caution…) ne sont pas maintenues ou sont jugées insuffisantes. Si les garanties sont suffisantes, le privilège ne s’applique pas aux loyers futurs (qui seront, en principe, payés normalement car nés après le jugement).
Il est à noter que le bailleur, même privilégié, n’a pas de droit de rétention sur les meubles et ne peut en demander l’attribution.
Vous détenez une hypothèque, un gage ou un nantissement ?
Si votre créance est garantie par une sûreté réelle « classique » inscrite sur un bien du débiteur (hypothèque sur un immeuble, nantissement sur un fonds de commerce, gage sur du matériel…), la procédure collective vient également perturber vos prérogatives.
Interdiction de réaliser votre garantie pendant la période d’observation
Avant de détailler l’interdiction de réaliser votre garantie, il est essentiel de rappeler l’importance de la vérification des créances et les conséquences de la déclaration, notamment l’arrêt du cours des intérêts et l’interdiction de nouvelles inscriptions. En phase de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’objectif prioritaire est souvent de permettre la poursuite de l’activité et d’aboutir à un plan de redressement. Pour cela, il faut préserver les actifs de l’entreprise. Par conséquent :
- Vous ne pouvez pas engager de procédure de saisie sur le bien grevé (interdiction des poursuites individuelles).
- Le pacte commissoire est paralysé : Même si votre contrat de garantie prévoyait que vous deviendriez automatiquement propriétaire du bien en cas de non-paiement, cette clause est sans effet après le jugement d’ouverture, comme l’indique l’article L. 622-7, I du Code de commerce. Le transfert de propriété ne peut pas avoir lieu.
- L’attribution judiciaire est impossible : Vous ne pouvez pas non plus demander au juge de vous attribuer la propriété du bien gagé ou nanti en paiement de votre créance.
Votre garantie est donc « gelée » pendant cette phase, mais elle conserve son existence et son rang pour l’avenir.
Le sort des sûretés en cas de liquidation judiciaire
Si l’entreprise entre en liquidation judiciaire, la perspective change : l’objectif est de vendre les actifs pour payer les créanciers. Vos droits de créancier garanti sont alors partiellement restaurés :
- Réalisation possible par le liquidateur : Le liquidateur va procéder à la vente du bien sur lequel porte votre garantie (souvent par vente aux enchères publiques, mais parfois de gré à gré avec autorisation du juge-commissaire). Vous serez alors payé sur le prix de vente, en fonction de votre rang par rapport aux autres créanciers inscrits ou privilégiés.
- Attribution judiciaire possible (gage/nantissement) : Pour les créanciers titulaires d’un gage (sur meuble corporel) ou d’un nantissement (sur meuble incorporel, sauf fonds de commerce), l’article L. 642-20-1 du Code de commerce permet de demander au juge-commissaire de leur attribuer le bien en paiement de leur créance (sous réserve d’une expertise pour en fixer la valeur). C’est une alternative à la vente.
- Pacte commissoire toujours interdit : La réalisation automatique par transfert de propriété via un pacte commissoire reste interdite, même en liquidation.
Le paiement provisionnel : une avance sur le prix de vente ?
Au-delà des points abordés ici, pour une compréhension complète des droits des créanciers, il est également pertinent d’explorer le sort des créances nées après le jugement d’ouverture et les recours possibles contre les tiers garants. Quoi qu’il en soit, que ce soit en sauvegarde/redressement ou en liquidation, si le bien sur lequel porte votre sûreté est vendu par les organes de la procédure, la loi vous offre une possibilité intéressante : demander au juge-commissaire un paiement provisionnel, c’est-à-dire une avance sur le prix de vente, sans attendre la répartition finale entre tous les créanciers (articles L. 622-8 et L. 643-3 du Code de commerce).
Les conditions sont strictes : il faut que votre créance soit déclarée, que votre rang de privilège vous permette raisonnablement d’espérer être payé sur le prix, et parfois (surtout en sauvegarde/redressement) fournir une garantie bancaire pour assurer le remboursement si, finalement, vous aviez perçu trop. C’est une faculté à examiner au cas par cas.
Qu’advient-il de l’échéance de vos créances ?
L’ouverture de la procédure collective a un impact direct sur l’exigibilité de vos créances, mais cet impact diffère radicalement selon le type de procédure.
En sauvegarde et redressement judiciaire : Maintien du terme
La règle, posée par l’article L. 622-29 du Code de commerce, est conçue pour favoriser le redressement : le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances qui n’étaient pas encore échues. Si vous aviez accordé un prêt remboursable dans 3 ans, ou si votre facture n’était payable qu’à 60 jours et que ce délai n’est pas expiré au jour du jugement, votre créance conserve son terme initial. Elle ne devient pas immédiatement exigible du seul fait de l’ouverture de la procédure.
Cette règle est d’ordre public, toute clause contraire dans vos contrats (prévoyant une exigibilité anticipée en cas de procédure collective) est réputée non écrite. La créance sera payée soit à son échéance normale (si elle est postérieure au jugement et privilégiée), soit selon les modalités prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement.
En liquidation judiciaire : Déchéance du terme
À l’inverse, lorsque l’entreprise entre en liquidation judiciaire (sauf si un maintien temporaire d’activité est autorisé en vue d’une cession), l’objectif n’est plus le redressement mais la réalisation rapide des actifs pour payer les créanciers. L’article L. 643-1 du Code de commerce rétablit donc la règle traditionnelle : la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme.
Cela signifie que toutes les dettes du débiteur, même celles qui n’étaient pas encore arrivées à échéance, deviennent immédiatement exigibles. Le liquidateur doit les prendre en compte dans leur intégralité (éventuellement après déduction des intérêts non courus pour certains prêts) pour établir le passif à payer dans la mesure du possible avec le produit de la vente des actifs.
La situation des créanciers face à une entreprise en difficulté est donc loin d’être uniforme. Selon que vous soyez vendeur, bailleur, ou titulaire d’une sûreté, et selon la nature de la procédure ouverte, vos droits et les limitations qui s’y appliquent varient considérablement. Une analyse juridique fine de votre situation contractuelle et des garanties que vous détenez est indispensable pour élaborer la stratégie la plus adaptée à la défense de vos intérêts spécifiques. N’hésitez pas à consulter notre cabinet pour évaluer précisément votre position et les actions à entreprendre.
Sources
- Code de commerce, notamment articles L. 141-6, L. 622-7, L. 622-8, L. 622-16, L. 622-29, L. 624-11 à L. 624-18, L. 641-3, L. 642-20-1, L. 643-1, L. 643-3.
- Code civil, article 2332 (privilège du bailleur et du vendeur de meubles).
Parfait, voici la proposition pour le troisième article, en respectant le plan et les directives du guide de rédaction.