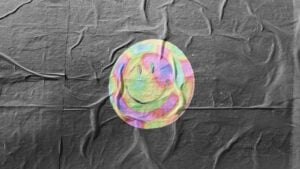Vous avez déterminé que votre litige commercial relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce. C’est une étape essentielle. Mais une autre question, tout aussi fondamentale, se pose immédiatement : devant quel tribunal de commerce devez-vous porter votre affaire ? Celui de votre ville ? Celui où se situe le siège de votre adversaire ? Ou peut-être un autre encore ? Bienvenue dans le monde de la compétence « territoriale », ou géographique.
Après avoir compris quel type de tribunal peut juger (la compétence matérielle, abordée dans nos articles précédents), il faut identifier lequel, géographiquement, est désigné par la loi ou le contrat pour trancher le différend. Cette compétence territoriale, régie principalement par le Code de procédure civile, obéit à des règles précises qu’il vaut mieux connaître. Engager une procédure devant un tribunal géographiquement incompétent peut entraîner des exceptions de procédure, des retards et des coûts supplémentaires. Cet article vous propose un guide pratique pour naviguer ces règles : le principe de base, les options qui s’offrent parfois à vous, et l’impact souvent décisif des clauses contractuelles.
La règle de base : le tribunal du défendeur (« Actor sequitur forum rei »)
Le point de départ de toute réflexion sur la compétence territoriale est un principe ancien, hérité du droit romain et consacré par l’article 42 du Code de procédure civile : Actor sequitur forum rei. Littéralement, « le demandeur suit le for (le tribunal) du défendeur ». En termes simples, cela signifie que la juridiction territorialement compétente est, sauf exception, celle du lieu où demeure la personne que vous attaquez en justice (le défendeur).
Pourquoi cette règle ? Elle vise principalement à faciliter la défense. On considère qu’il est plus juste et plus pratique pour le défendeur de se défendre devant « son » tribunal, celui de sa localité, plutôt que d’être contraint de se déplacer, parfois loin, pour répondre à une action en justice.
Comment déterminer ce « lieu où demeure le défendeur » ? Le Code de procédure civile (article 43) précise :
- Si le défendeur est une personne physique (par exemple, un entrepreneur individuel commerçant) : Le lieu où il demeure s’entend de son domicile (au sens civil du terme, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement, où il a le centre de ses intérêts personnels et professionnels) ou, si le domicile n’est pas connu ou n’existe pas, de sa résidence (le lieu où il habite effectivement).
- Si le défendeur est une personne morale (le cas le plus fréquent en matière commerciale : une société type SARL, SAS, SA…) : Le lieu où elle demeure est celui où elle est établie, ce qui correspond en principe à son siège social.
Le siège social est donc le critère de rattachement territorial principal pour une société. Mais attention, la notion de siège social peut elle-même être source de discussion. On distingue le siège social statutaire (celui qui est inscrit dans les statuts de la société et déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés) du siège social réel (le lieu où se trouve effectivement la direction administrative et financière, où les décisions sont prises). En principe, c’est le siège statutaire qui fait foi. Toutefois, si ce siège statutaire est purement fictif (une simple boîte aux lettres, par exemple) et que la direction réelle de l’entreprise se situe ailleurs, les tiers (comme vous, si vous attaquez cette société) peuvent choisir d’ignorer le siège statutaire et d’assigner la société devant le tribunal du lieu de son siège réel. La société, elle, ne peut normalement pas opposer son siège réel aux tiers pour échapper à la compétence du tribunal de son siège statutaire.
L’exception « des gares principales » : assigner au lieu d’un établissement secondaire
La règle du siège social trouve une exception notable, issue d’une vieille jurisprudence concernant les compagnies de chemin de fer (d’où son nom pittoresque de « jurisprudence des gares principales »). Aujourd’hui, cette exception permet, sous conditions, d’assigner une société non pas au tribunal de son siège social, mais à celui dans le ressort duquel se trouve l’un de ses établissements secondaires (agence, succursale…).
L’idée est simple : si vous avez traité exclusivement avec une agence locale d’une grande entreprise dont le siège est à l’autre bout de la France, il peut être plus logique et pratique de porter le litige devant le tribunal local. Mais cette possibilité est encadrée :
- L’établissement doit avoir une autonomie suffisante : Il ne suffit pas d’avoir une simple boutique ou un entrepôt. L’établissement (agence, succursale) doit avoir une certaine permanence, une organisation propre et, surtout, le pouvoir de traiter avec les tiers et d’engager la société. Par exemple, une agence bancaire qui ouvre des comptes et accorde des crédits localement remplit cette condition. Un simple bureau de représentation sans pouvoir décisionnel ne suffirait pas.
- Le litige doit avoir un lien direct avec l’activité de cet établissement : Vous ne pouvez pas utiliser n’importe quelle succursale comme point d’entrée. Il faut que le contrat ait été négocié ou exécuté par cet établissement, ou que la faute à l’origine du litige ait été commise dans le ressort de cet établissement. Par exemple, si vous avez un problème avec un produit acheté dans une agence spécifique d’une enseigne nationale, vous pourrez probablement assigner devant le tribunal du lieu de cette agence.
Cette « jurisprudence des gares principales » est une option pour le demandeur ; il conserve toujours la possibilité d’assigner au siège social s’il le préfère.
Les options offertes au demandeur (Art. 46 CPC)
Au-delà de la règle de base (tribunal du défendeur) et de l’exception des « gares principales », l’article 46 du Code de procédure civile offre au demandeur des options de compétence supplémentaires dans certaines matières, lui permettant de choisir un autre tribunal que celui du domicile ou du siège du défendeur.
En matière de contrat
Si votre litige découle d’un contrat commercial, vous pouvez choisir d’assigner votre adversaire :
- Soit devant le tribunal du lieu de son domicile/siège social (règle de base).
- Soit, au choix, devant :
- La juridiction du lieu de la livraison effective de la chose (si le contrat portait sur la livraison d’un bien). Attention, « effective » signifie le lieu où la livraison devait réellement avoir lieu selon le contrat, même si elle n’a finalement pas eu lieu.
- Ou la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service (si le contrat portait sur un service). Par exemple, le lieu où des travaux ont été réalisés, le lieu où un consultant a effectué sa mission, ou même le lieu où un service en ligne est principalement utilisé par le client.
Cette option est précieuse car elle permet souvent de saisir un tribunal plus proche du lieu où les faits pertinents se sont déroulés.
En matière de délit ou quasi-délit (responsabilité)
Si votre action vise à engager la responsabilité de votre adversaire pour une faute ayant causé un dommage (par exemple, concurrence déloyale, rupture brutale de relations commerciales établies, publicité mensongère…), vous avez également une option :
- Soit le tribunal du lieu du domicile/siège social du défendeur (règle de base).
- Soit, au choix, devant :
- La juridiction du lieu du fait dommageable, c’est-à-dire l’endroit où la faute a été commise.
- Ou la juridiction du lieu où le dommage a été subi. La jurisprudence considère souvent que le dommage économique subi par une entreprise se matérialise à son siège social. Par exemple, en cas de rupture brutale de relations commerciales, l’entreprise victime pourra souvent assigner l’auteur de la rupture devant le tribunal de son propre siège social, car c’est là qu’elle ressent les conséquences financières de la rupture.
En cas de pluralité de défendeurs
Si votre action vise plusieurs défendeurs (par exemple, une société et son dirigeant, ou plusieurs co-contractants), l’article 42 vous offre une facilité : vous pouvez choisir d’assigner tous les défendeurs devant le tribunal du lieu où demeure l’un quelconque d’entre eux. Cela évite d’avoir à multiplier les procédures devant des tribunaux différents. Attention, cette option suppose que l’action contre le défendeur « attractif » soit sérieuse et non pas un simple prétexte pour choisir un tribunal arrangeant.
Attention aux clauses de compétence dans vos contrats !
Dans le monde des affaires, il est très fréquent que les contrats contiennent des « clauses attributives de compétence territoriale ». Il s’agit de stipulations par lesquelles les parties désignent à l’avance le tribunal qui sera exclusivement compétent pour trancher tout litige qui pourrait naître de leur relation contractuelle. Ces clauses sont un outil de prévisibilité important, mais leur validité et leur portée sont strictement encadrées en droit français interne.
Validité très limitée en droit interne : l’article 48 du Code de procédure civile
L’article 48 du Code de procédure civile pose un principe très clair : toute clause qui déroge aux règles légales de compétence territoriale est réputée non écrite (c’est-à-dire nulle et sans effet). Il existe cependant une exception majeure à cette interdiction : la clause est valable si deux conditions cumulatives sont remplies :
- Elle doit avoir été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant. Cela signifie que si l’une des parties n’est pas commerçante (un particulier, une profession libérale, une association civile…), la clause est automatiquement nulle et inopposable à cette partie non-commerçante. Même entre deux sociétés commerciales, si l’une d’elles contracte pour des besoins étrangers à son commerce (ce qui est rare mais possible), la clause pourrait être écartée.
- Elle doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La jurisprudence interprète cette condition de manière stricte. La clause ne doit pas être noyée dans des conditions générales illisibles, imprimée en caractères minuscules ou dans une couleur pâle. Elle doit attirer l’attention (par exemple, par un titre clair, une typographie distincte, un emplacement logique). De plus, il faut pouvoir prouver que la partie à qui on l’oppose en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la conclusion du contrat (la simple mention sur une facture reçue après coup est généralement insuffisante, sauf relations d’affaires très établies où cette pratique est constante et non contestée).
En résumé : entre commerçants, une clause désignant un tribunal spécifique est possible, mais elle doit être particulièrement visible et clairement acceptée. Dans tous les autres cas (contrat avec un non-commerçant), elle est nulle.
Les limites à l’application de la clause (même valide)
Même lorsqu’une clause attributive de compétence est valablement conclue entre commerçants, elle peut se heurter à certaines limites :
- Procédures collectives (difficultés des entreprises) : Les règles désignant le tribunal compétent pour ouvrir et suivre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (généralement celui du siège social du débiteur) sont considérées comme d’ordre public. Une clause contractuelle désignant un autre tribunal ne peut pas y faire échec.
- Procédures de référé (urgence) : Lorsqu’une mesure urgente est nécessaire (référé), la jurisprudence admet que l’on puisse saisir le juge des référés territorialement compétent selon les règles légales (lieu du défendeur, lieu d’exécution de la mesure…), même si une clause attributive de compétence désignait un autre tribunal pour le fond du litige. L’urgence prime sur la clause pour les mesures provisoires.
Le cas particulier des contrats internationaux
Il est important de noter que les règles sont beaucoup plus souples pour les contrats internationaux (contrats présentant des liens avec plusieurs pays). Dans ce contexte, les clauses attributives de compétence (désignant un tribunal français ou étranger) sont en principe valides, même si les parties ne sont pas toutes commerçantes. La liberté contractuelle prime ici, car ces clauses sont vues comme un élément essentiel de la sécurité juridique dans le commerce international. Il existe cependant des limites, notamment lorsque la clause tente de faire échec à une compétence exclusive impérative des tribunaux français (par exemple, pour un litige portant sur un immeuble situé en France).
Choisir le bon tribunal de commerce géographiquement est crucial pour éviter des exceptions d’incompétence. Vérifier vos contrats et connaître les règles applicables peut vous faire gagner du temps et de l’argent. L’analyse des options de compétence et de la validité des clauses contractuelles nécessite souvent une expertise juridique. Notre cabinet peut vous assister dans cette démarche et vous représenter devant la juridiction compétente. Contactez-nous pour discuter de votre dossier.
Sources
- Code de procédure civile, notamment les articles 42, 43, 46 et 48.
- Code de commerce, notamment l’article R. 600-1 (compétence territoriale pour les difficultés des entreprises).
- Jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’interprétation de ces articles (ex: « gares principales », conditions de validité de l’article 48, options de l’article 46).