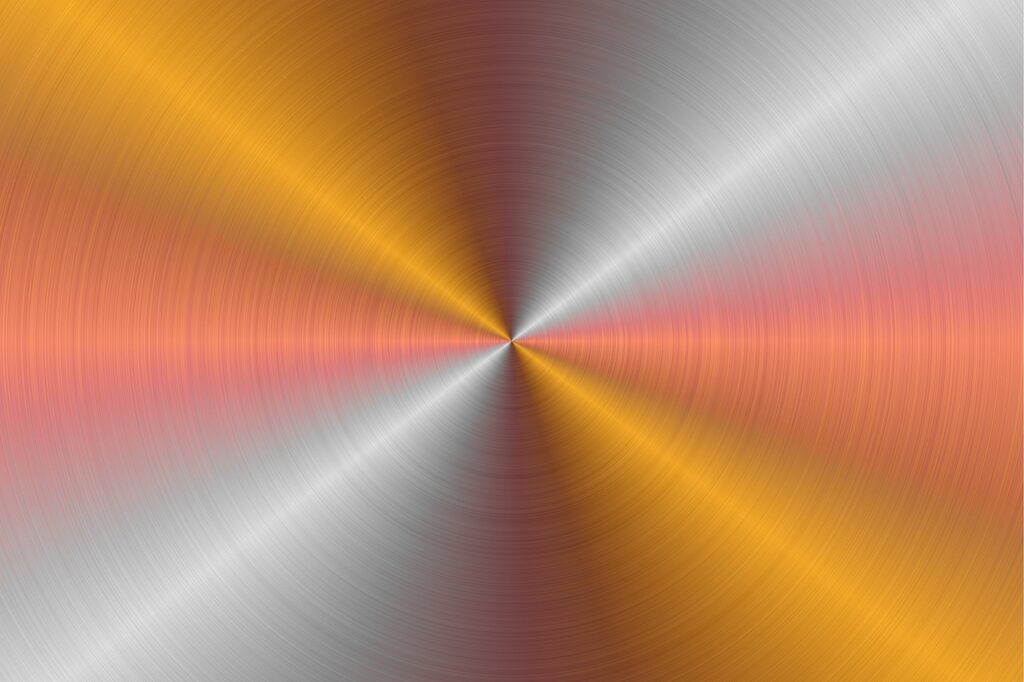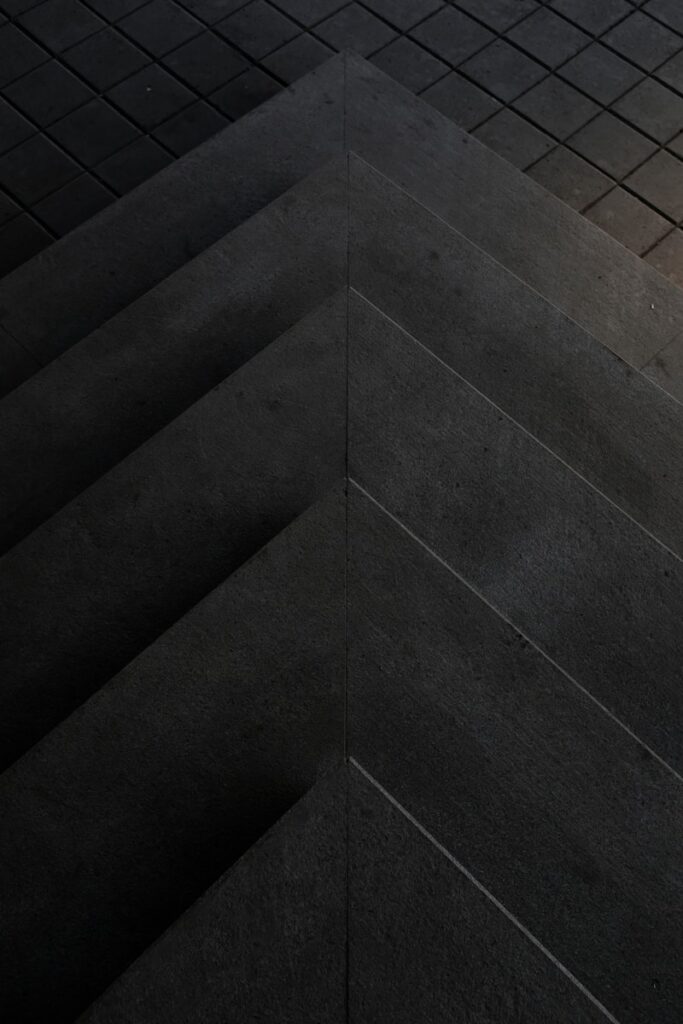Le commerce ambulant occupe une place importante dans le paysage économique français. Ces activités commerciales exercées hors d’un local fixe obéissent à un cadre réglementaire précis. Marchands ambulants et forains, souvent confondus, répondent pourtant à des définitions juridiques distinctes et sont soumis à des obligations spécifiques.
La distinction juridique entre marchands ambulants et forains
Le code de commerce opère une distinction fondamentale entre les marchands ambulants et les forains.
Définition légale du marchand ambulant
Le marchand ambulant est défini à l’article L. 123-29 du code de commerce comme une personne qui exerce une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement. Ce statut s’applique aux personnes physiques ou morales.
La particularité essentielle du marchand ambulant réside dans l’existence d’un domicile ou d’une résidence fixe. Ce domicile doit être établi depuis au moins six mois en France ou dans un État membre de l’Union européenne.
Le code retient ici la notion classique de domicile définie à l’article 102 du code civil, à savoir le lieu du principal établissement. Pour la résidence fixe, les textes précisent qu’il s’agit d’un séjour d’au moins six mois comme propriétaire ou locataire d’un local meublé appartenant au locataire.
Un simple séjour en hôtel ou l’occupation d’un entrepôt de marchandises ne constituent pas une résidence fixe au sens juridique.
Définition légale du forain
Le forain est défini par opposition au marchand ambulant. L’article L. 123-29, alinéa 2 du code de commerce le caractérise comme une personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne.
Le décret du 31 juillet 1970 complète cette définition en précisant qu’il s’agit d’une personne qui n’a pas d’établissement principal au sens de l’article 102 du code civil et qui ne séjourne pas dans un État de l’Union européenne depuis au moins six mois comme propriétaire ou locataire d’un logement meublé lui appartenant.
Critères de distinction essentiels
La frontière juridique entre marchand ambulant et forain repose donc sur un critère principal : la stabilité géographique. Ce critère détermine les obligations administratives applicables.
Pour le marchand ambulant, l’existence d’un domicile fixe simplifie les démarches administratives. Pour le forain, l’absence de domicile fixe entraîne des obligations supplémentaires, telles que l’obligation de choisir une commune de rattachement et de posséder un titre de circulation.
Les activités concernées par le statut de marchand ambulant
La réglementation délimite précisément les activités relevant du statut de marchand ambulant ou forain.
Activités commerciales et artisanales ambulantes
Selon l’article L. 123-29 du code de commerce, seules les activités commerciales ou artisanales ambulantes sont concernées. Cette formulation permet d’englober plusieurs catégories de professionnels :
- Les commerçants régulièrement immatriculés au registre du commerce et des sociétés
- Les artisans inscrits au répertoire des métiers
- Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante
L’activité doit comporter deux éléments constitutifs :
- La réalisation d’actes de commerce ou d’activités artisanales
- Le caractère onéreux de l’activité exercée
Les activités peuvent être exercées à titre principal, accessoire ou occasionnel. La législation ne requiert pas que l’activité ambulante constitue la source principale de revenus du professionnel.
L’exercice de ces activités implique fréquemment l’occupation du domaine public, nécessitant l’obtention de permis de stationnement ou permissions de voirie délivrés par les maires.
Activités exclues du statut
Certaines activités, bien qu’exercées en dehors d’un établissement fixe, ne relèvent pas du statut de marchand ambulant. L’article R. 123-208-1 du code de commerce précise ces exclusions :
- Les activités agricoles
- Les activités libérales
- Les tournées de vente à titre accessoire dans des communes limitrophes à partir d’établissements fixes
- Les professions soumises à une réglementation particulière comme les agents commerciaux, vendeurs-colporteurs de presse, exploitants de taxis, transporteurs de marchandises ou personnes
Ces exclusions s’expliquent par l’existence de régimes juridiques spécifiques pour ces activités.
Cas particulier des auto-entrepreneurs
Depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante sont soumis aux mêmes obligations que les commerçants ou artisans traditionnels.
Ils doivent ainsi obtenir une carte professionnelle même s’ils sont dispensés d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette assimilation vise à garantir un contrôle efficace de ces activités et à éviter les risques de concurrence déloyale.
L’évolution du cadre juridique applicable
La réglementation des activités ambulantes a connu plusieurs évolutions significatives.
Historique des principales réglementations
Pendant longtemps, l’activité non sédentaire a fait l’objet de textes particuliers en dehors du code de commerce :
- La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes
- Le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 fixant les modalités d’application
- De nombreux arrêtés et circulaires complétant ce dispositif
Ces textes répondaient à une volonté historique de contrôle administratif des activités non sédentaires, perçues parfois avec méfiance par les pouvoirs publics.
Impact de la loi de modernisation de l’économie de 2008
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a profondément remanié le cadre juridique du commerce ambulant. Elle a intégré dans le code de commerce les dispositions relatives à l’exercice d’une activité ambulante (articles L. 123-29 à L. 123-31).
Cette réforme a simplifié et modernisé les procédures administratives. Elle a notamment :
- Redéfini les critères de qualification des marchands ambulants et forains
- Transféré la compétence pour la délivrance des cartes professionnelles aux chambres consulaires
- Harmonisé le traitement des auto-entrepreneurs avec celui des commerçants traditionnels
Cohabitation du code de commerce et des textes spécifiques
L’originalité du régime actuel réside dans la coexistence de deux sources législatives complémentaires :
- Le code de commerce contient les règles applicables à « la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante », relevant des chambres consulaires
- Les textes particuliers posent les règles relatives aux titres de circulation pour les forains, relevant du ministère de l’Intérieur
Cette dualité s’explique par la volonté du législateur de distinguer la régulation économique de l’activité ambulante du contrôle administratif des personnes sans domicile fixe.
L’influence du droit européen sur le commerce ambulant
Le droit européen a exercé une influence considérable sur la réglementation française du commerce ambulant.
Liberté d’établissement et libre prestation de services
Les principes fondamentaux du droit européen, notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de services (articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), s’appliquent pleinement aux activités ambulantes.
La directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur a renforcé ces principes en limitant les restrictions que peuvent imposer les États membres.
La réglementation française a dû s’adapter pour respecter ces principes tout en maintenant un niveau adéquat de contrôle administratif.
Jurisprudence de la CJUE sur les activités ambulantes
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de l’application du droit européen aux activités ambulantes :
- Dans l’arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993, la Cour a considéré que les modalités de vente ne constituent pas des entraves à la libre circulation des marchandises
- Dans l’arrêt du 26 mai 2005 (aff. C-20/03), elle a jugé qu’une autorisation administrative pour l’exercice d’une activité ambulante est une simple modalité de vente compatible avec le droit communautaire
Ces décisions ont permis de préserver l’essentiel du système français de régulation.
Adaptations du droit français aux exigences européennes
Le législateur français a procédé à plusieurs adaptations pour se conformer aux exigences européennes :
- Assimilation complète des ressortissants communautaires aux citoyens français pour l’application du statut de marchand ambulant
- Simplification des procédures administratives avec la mise en place du principe du guichet unique via les centres de formalités des entreprises
- Réduction des contraintes administratives excessives pour faciliter la libre circulation des services
Ces adaptations ont contribué à moderniser le régime juridique tout en préservant ses objectifs de contrôle et de protection.
Le cadre juridique des marchands ambulants et forains offre un équilibre entre liberté du commerce et contrôle administratif nécessaire. La connaissance précise de ce statut permet d’exercer sereinement votre activité ambulante et de maîtriser l’ensemble de vos obligations juridiques et administratives. Pour une analyse de votre situation particulière ou un accompagnement dans vos démarches, notre cabinet se tient à votre disposition pour une assistance juridique personnalisée en droit commercial.
Sources
- Code de commerce, art. L. 123-29 et suivants
- Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
- Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970
- Arrêté du 21 janvier 2010 fixant les modalités d’application du code de commerce relatives aux activités commerciales et artisanales ambulantes