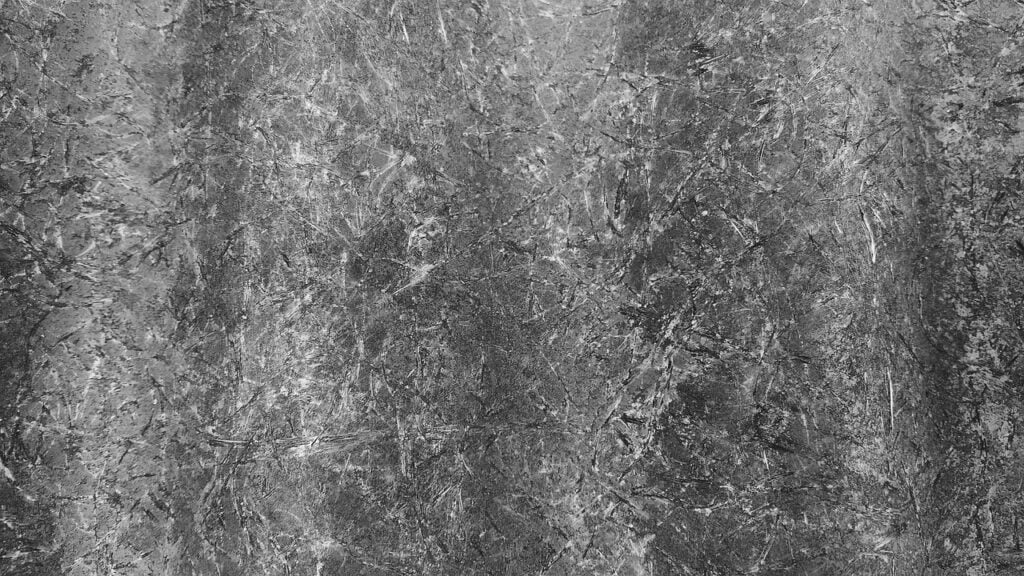L’enseigne est bien plus qu’un simple panneau au-dessus d’une vitrine. C’est souvent le premier contact visuel entre une entreprise et ses clients potentiels, un repère essentiel dans le paysage urbain ou commercial. Elle participe activement à l’identité et à la notoriété d’un commerce, d’un artisan ou même d’une profession libérale. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache un ensemble de règles juridiques qu’il convient de maîtriser. À ne pas confondre avec le nom commercial, qui identifie l’entreprise elle-même, l’enseigne désigne spécifiquement le lieu d’exploitation.
Comprendre le cadre légal de l’enseigne en France est indispensable pour tout entrepreneur. Cet article a pour objectif de vous éclairer sur les points fondamentaux : comment définir juridiquement une enseigne ? Quelles sont les règles à respecter pour son choix et son installation ? Comment les droits sur une enseigne s’acquièrent-ils et comment la protéger efficacement ? Quels sont, enfin, les aspects fiscaux à anticiper ? Aborder ces questions vous permettra de sécuriser cet élément clé de votre visibilité.
Qu’est-ce qu’une enseigne en droit français ?
La loi donne une définition précise. Selon l’article L. 581-3 du code de l’environnement, issu de la loi fondatrice du 29 décembre 1979, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Cette définition met l’accent sur le lien direct entre le signe et le lieu d’activité. Historiquement apparue pour permettre aux clients de localiser et distinguer les échoppes dès le Moyen Âge, l’enseigne conserve cette fonction première de signalisation géographique.
Il faut la distinguer de la préenseigne. La même loi définit la préenseigne comme toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. La différence est donc matérielle : l’enseigne est sur le lieu même de l’activité, tandis que la préenseigne est déportée pour signaler l’approche de ce lieu. La jurisprudence précise que l’immeuble supportant l’enseigne désigne la façade ou la devanture où l’activité se déroule, et non l’ensemble du bâtiment ou du terrain. Toutefois, un dispositif scellé au sol ou installé sur le terrain même où s’exerce l’activité (même en périphérie) est bien qualifié d’enseigne.
Les enseignes peuvent prendre diverses formes. Elles sont le plus souvent extérieures et visibles depuis la voie publique, mais peuvent aussi être intérieures, notamment dans les centres commerciaux ou grands magasins pour identifier des rayons spécifiques ou des boutiques indépendantes. Avec les évolutions technologiques, les enseignes lumineuses sont devenues courantes et font l’objet de réglementations spécifiques, notamment concernant leur extinction nocturne et leur consommation énergétique, dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse et de sobriété.
Enfin, il ne faut pas confondre l’enseigne commerciale avec la plaque professionnelle. Bien que la législation environnementale les englobe parfois sous le terme générique d’enseigne, l’usage et les réglementations déontologiques distinguent clairement les plaques des professions libérales (avocats, médecins, etc.) ou des officiers ministériels. Celles-ci sont soumises à des normes de discrétion et de contenu strictes pour éviter toute confusion avec des pratiques commerciales.
Choisir et installer son enseigne : les règles à respecter
La liberté d’expression s’applique au choix d’une enseigne, permettant d’opter pour son nom, une dénomination de fantaisie, un symbole ou un graphisme abstrait. Cependant, cette liberté est encadrée par de nombreuses règles, qu’elles soient techniques, environnementales ou liées au respect des droits d’autrui.
Les contraintes techniques et réglementaires
La principale source de réglementation est le Code de l’environnement, qui vise à protéger le cadre de vie et à limiter la pollution visuelle. S’il existe des zones où la publicité est strictement interdite (monuments historiques, sites classés, etc.), les enseignes y bénéficient généralement d’un régime plus souple en raison de leur nécessité pratique. Néanmoins, leur installation dans ces zones ou sur des immeubles protégés requiert une autorisation préalable du maire, souvent après avis de l’Architecte des Bâtiments de France ou de la commission départementale compétente.
Des règles précises, définies par décret (notamment le décret n° 82-211 du 24 février 1982, largement modifié depuis, notamment par les décrets de 2012 et 2013 suite à la loi Grenelle 2 ), encadrent les dimensions, les emplacements, et les distances à respecter. Les enseignes lumineuses sont particulièrement visées, avec des restrictions sur les horaires d’extinction (généralement entre 1h et 6h du matin, sauf exceptions), la surface, la consommation énergétique. Les enseignes laser nécessitent même une autorisation préfectorale.
Les préenseignes, quant à elles, sont soumises au régime plus strict de la publicité. Des dérogations existent cependant pour signaler certaines activités jugées utiles (services d’urgence, vente de produits du terroir par des entreprises locales, activités en retrait de la voie publique), mais leur nombre est strictement limité (généralement deux ou quatre maximum). La notion de « produit du terroir » est d’ailleurs interprétée restrictivement, exigeant un lien géographique fort.
La sécurité routière impose également des contraintes. Le Code de la route interdit les enseignes qui pourraient créer une confusion avec la signalisation routière ou gêner la visibilité des conducteurs.
Il existe une obligation légale de maintenir les enseignes en bon état d’entretien. Tout manquement est sanctionné par une amende. Plus important encore, lorsqu’une activité cesse, l’enseigne correspondante doit être enlevée dans un délai de trois mois, sauf si elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque reconnu.
Sur le plan linguistique, contrairement à d’autres supports, il n’y a pas d’obligation légale générale d’utiliser le français pour les enseignes. Des propositions de loi ont été faites pour imposer une traduction, mais n’ont pas abouti à ce jour.
Le non-respect de ces réglementations techniques et environnementales expose à des sanctions. Il s’agit principalement d’amendes administratives ou pénales, dont le montant peut être significatif (jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale pour l’absence d’extinction nocturne par exemple ), et applicables pour chaque enseigne non conforme. Le juge peut également ordonner la suppression ou la mise en conformité sous astreinte.
Le choix du signe et les droits des tiers
Au-delà des aspects techniques, le choix du signe lui-même doit impérativement tenir compte des droits antérieurs détenus par des tiers. Utiliser une enseigne qui porte atteinte à ces droits peut engager votre responsabilité.
Il est formellement interdit d’utiliser le nom patronymique ou le pseudonyme d’une autre personne sans son autorisation expresse. La protection s’étend même à l’utilisation du nom d’une rue si celle-ci correspond au patronyme d’une personnalité et que l’usage commercial peut porter préjudice aux descendants. Le pseudonyme jouit d’une protection similaire dès lors qu’il est original et connu.
Un conflit fréquent survient avec les marques déposées. Une entreprise ne peut adopter une enseigne identique ou similaire à une marque enregistrée par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, si cet enregistrement est antérieur à l’usage de l’enseigne. L’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception pour celui qui utilise de bonne foi son propre nom patronymique, mais le titulaire de la marque peut demander en justice que cet usage soit limité ou encadré pour éviter la confusion. Attention également aux marques collectives, comme la croix verte ou le caducée des pharmaciens, dont l’usage comme enseigne est réservé aux membres autorisés et soumis à un règlement d’usage.
Les appellations d’origine (AOC/AOP) et indications géographiques (IGP) sont également protégées. Il est interdit d’utiliser une dénomination géographique protégée ou une mention l’évoquant dans une enseigne si cela est susceptible de tromper le public sur l’origine ou de détourner ou affaiblir la notoriété de l’appellation. Par exemple, utiliser « Le Champagne » pour un restaurant en Normandie a été jugé illicite. Là encore, une exception peut exister pour l’usage de son propre nom patronymique s’il est homonyme d’une indication géographique, à condition que cela n’induise pas le public en erreur.
Enfin, l’utilisation de signes officiels (drapeaux nationaux, emblèmes d’États ou d’organisations internationales comme la Croix-Rouge ou les symboles olympiques) est strictement réglementée. Leur emploi comme enseigne est généralement interdit s’il est de nature à tromper sur l’origine ou le statut officiel de l’établissement. Un usage purement décoratif et non trompeur (par exemple, un drapeau pour un restaurant de cuisine étrangère) pourrait être envisageable.
Les stipulations contractuelles impactant l’enseigne
Le choix et l’usage de l’enseigne peuvent aussi être encadrés par des contrats.
Dans les réseaux de distribution sélective ou de franchise, il est courant que le fournisseur ou le franchiseur impose des normes concernant l’enseigne du distributeur ou du franchisé, afin de maintenir la cohérence et l’image de marque du réseau. Ces clauses sont licites au regard du droit de la concurrence, à condition de ne pas être appliquées de manière injustifiée ou disproportionnée.
Une situation plus délicate concerne les baux commerciaux. Certains bailleurs tentent d’insérer une « clause d’enseigne » obligeant le locataire à exploiter sous une enseigne déterminée pendant toute la durée du bail. Cependant, la Cour de cassation considère généralement ces clauses comme nulles, car elles portent atteinte à la liberté de déspécialisation (possibilité pour le locataire de changer ou d’ajouter une activité) qui est une disposition d’ordre public prévue par le statut des baux commerciaux (notamment l’article L. 145-15 du Code de commerce). Même si l’enseigne imposée n’est pas directement liée à une activité précise (par exemple, une enseigne de franchise), la clause peut être annulée car elle restreint indirectement la liberté du locataire.
Les réglementations spécifiques à certaines activités
Au-delà des règles générales, certaines professions ou secteurs d’activité sont soumis à des contraintes additionnelles concernant leur enseigne, souvent pour protéger les consommateurs ou garantir la déontologie.
Pour les activités commerciales et artisanales, on peut citer :
- Agences de voyage : Obligation théorique de mentionner le type d’autorisation administrative (licence, etc.) dans l’enseigne, bien que peu respectée en pratique.
- Artisans : L’usage des termes « artisan », « artisanal » ou dérivés dans l’enseigne est réservé aux personnes dûment qualifiées et inscrites au répertoire des métiers. L’utilisation d' »artisanal » peut même être soumise à un cahier des charges spécifique. Les infractions sont pénalement sanctionnées.
- Boulangeries : L’appellation « boulanger » ou « boulangerie » est protégée par la loi. Elle est réservée aux professionnels qui assurent eux-mêmes l’intégralité du processus de fabrication du pain (pétrissage, fermentation, façonnage, cuisson) sur le lieu de vente.
- Boissons alcooliques : La publicité est restreinte, mais autorisée sous forme d’enseignes pour les boissons dont la vente est licite.
- Débits de tabacs : L’enseigne est l’un des rares supports publicitaires autorisés, mais elle doit être conforme à des caractéristiques strictes définies par arrêté, notamment l’usage de la « carotte » et la mention « tabac ».
- Établissements de crédit : Interdiction d’utiliser des termes ou enseignes créant une confusion sur le statut agréé de l’établissement ou sa catégorie (banque, société financière, etc.).
- Groupements d’Intérêt Économique (GIE) : Le sigle « GIE » ou toute expression similaire est réservé aux groupements régulièrement constitués sous cette forme.
- Pompes funèbres : Interdiction d’utiliser des termes prêtant à confusion avec les services municipaux ou les délégataires officiels.
- Magasins d’usine / Dépôts d’usine : Utilisation réglementée de ces dénominations.
- Soldes : Le mot « solde » ou ses dérivés ne peuvent figurer dans une enseigne que si l’activité correspond bien à la définition légale des soldes.
Pour les professions libérales, la règle générale est la discrétion et l’absence de caractère publicitaire.
- Avocats : Le règlement intérieur unifié limite les mentions autorisées sur les plaques (nom, titres universitaires, distinctions, éventuelles mentions de domaines d’intervention reconnus) et impose des dimensions raisonnables.
- Médecins et autres professions médicales/paramédicales : Les codes de déontologie encadrent strictement le contenu des plaques (nom, qualifications reconnues, horaires, situation conventionnelle) et leur présentation doit rester discrète.
- Pharmaciens : Interdiction de solliciter la clientèle par des procédés contraires à la dignité. La signalisation extérieure est limitée à la dénomination de l’officine, la croix verte (lumineuse ou non) et le caducée pharmaceutique officiel. Le nom d’un groupement peut être mentionné, mais ne doit pas prévaloir sur l’identité de l’officine.
Comment s’acquièrent les droits sur une enseigne ?
Contrairement à une marque qui naît de son enregistrement, le droit sur une enseigne s’acquiert différemment.
Le principe fondamental est celui de l’acquisition par le premier usage public et continu. C’est le fait d’utiliser l’enseigne de manière visible et constante pour identifier son établissement qui crée le droit privatif. La question du point de départ exact de cet usage a pu faire débat : suffit-il d’apposer l’enseigne sur un local en travaux, ou faut-il attendre l’ouverture effective à la clientèle? Une approche prudente retient que l’usage doit être effectif et non équivoque, manifestant clairement l’intention d’exploiter sous ce signe. Inversement, le défaut prolongé d’usage peut entraîner la perte du droit, l’enseigne retombant alors dans le domaine public.
Si l’usage prime, la déclaration de l’enseigne lors de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est une obligation légale pour les commerçants et artisans qui en utilisent une. Toute modification ultérieure doit aussi être déclarée. Cependant, cette inscription a un rôle purement déclaratif et ne constitue pas en soi l’acte créateur du droit. Son principal effet est de rendre l’enseigne opposable aux tiers de bonne foi ; sans inscription, un tiers pourrait ignorer légitimement l’existence de l’enseigne, sauf s’il en avait personnellement connaissance par ailleurs.
Pour qu’un droit privatif naisse de l’usage, l’enseigne doit posséder un caractère distinctif. Un terme purement générique ou descriptif de l’activité (par exemple, « Boulangerie », « Chaussures ») ne peut pas être approprié exclusivement. Un concurrent pourrait utiliser le même terme générique sans commettre de faute. La distinctivité peut être intrinsèque (un nom de fantaisie, un logo original) ou acquise par l’usage intensif et la notoriété. Une enseigne initialement banale peut devenir distinctive si le public l’associe fortement à un établissement particulier, comme l’a reconnu la jurisprudence dans l’affaire opposant Décathlon à Go Sport à propos d’une présentation simple (nom en blanc sur fond bleu).
Le cas des noms de domaine Internet est particulier. Ils peuvent être considérés comme des enseignes « électroniques », servant à localiser et attirer les clients vers un site marchand. Cependant, leur régime d’acquisition diffère : il repose sur l’enregistrement auprès d’organismes de nommage (comme l’AFNIC pour le .fr) selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Cette règle a généré des conflits, notamment le cybersquatting. Aujourd’hui, si l’enregistrement reste la clé, le demandeur doit s’assurer qu’il ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers (marques, dénominations sociales, mais aussi enseignes préexistantes). L’AFNIC et les tribunaux peuvent intervenir pour résoudre ces conflits.
La transmission de l’enseigne
Élément incorporel du fonds de commerce, du fonds artisanal ou agricole, l’enseigne se transmet généralement avec lui.
Lors de la vente du fonds, l’enseigne est comprise dans la cession, sauf si une clause du contrat de vente prévoit expressément le contraire. Le vendeur peut ainsi se réserver l’enseigne, par exemple si elle correspond à son nom patronymique. Toutefois, cette réserve ne doit pas vider la cession de sa substance en privant l’acquéreur de la clientèle attachée à l’enseigne. Pour un fonds artisanal, où l’aspect personnel est plus marqué, la conservation de l’enseigne nominative par le vendeur est plus facilement concevable.
Il est essentiel de distinguer la transmission de l’enseigne de la vente de l’immeuble sur lequel elle est apposée. L’enseigne appartient au titulaire du fonds et non au propriétaire des murs. L’acquéreur de l’immeuble ne peut prétendre à aucun droit sur l’enseigne relative à l’activité qui y était exercée. Les enseignes anciennes, parfois intégrées architecturalement, peuvent subsister si elles ont un intérêt historique ou artistique, mais les droits commerciaux attachés ne sont pas transmis avec la pierre.
L’enseigne peut également faire l’objet d’une mise à disposition contractuelle, sans transfert de propriété. C’est un élément central du contrat de franchise, où le franchiseur concède au franchisé le droit d’utiliser son enseigne, symbole du savoir-faire et de la notoriété du réseau. Cette mise à disposition, souvent couplée à une licence de marque, est soumise aux obligations d’information précontractuelle de la loi Doubin (article L. 330-3 du Code de commerce) si elle s’accompagne d’une exclusivité ou quasi-exclusivité. Le franchisé doit d’ailleurs indiquer clairement sa qualité d’entreprise indépendante.
De même, les centrales et groupements d’achat mettent souvent une enseigne commune à disposition de leurs adhérents commerçants indépendants. Les conditions d’utilisation sont définies dans le contrat d’affiliation, qui peut également être soumis à l’article L. 330-3 du Code de commerce. Le groupement a alors une obligation de protéger l’enseigne commune contre les usurpations qui nuiraient aux membres. La cession de l’activité d’un adhérent peut être soumise à un pacte de préférence concernant l’enseigne.
Comment protéger son enseigne ?
Protéger son enseigne contre les imitations ou les usurpations est un enjeu majeur. Le droit français offre plusieurs mécanismes, mais le principal repose sur la responsabilité civile.
Le moyen principal : l’action en concurrence déloyale
L’enseigne n’étant pas un titre de propriété industrielle comme la marque, elle ne bénéficie pas de l’action spécifique en contrefaçon. Sa protection s’organise principalement via l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382). Pour obtenir gain de cause, le titulaire de l’enseigne première doit prouver trois éléments :
- Une faute commise par le concurrent : typiquement, l’utilisation d’une enseigne identique ou similaire.
- Un préjudice subi : perte de clientèle, dilution de l’image, atteinte à la notoriété.
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice : c’est ici qu’intervient le risque de confusion dans l’esprit du public. Si la clientèle risque de confondre les deux établissements en raison de la similarité des enseignes, la faute est généralement établie.
L’originalité ou la distinctivité de l’enseigne première n’est pas une condition absolue pour agir, mais elle facilite grandement la démonstration de la faute et du risque de confusion. Une enseigne banale sera plus difficile à défendre qu’une enseigne originale. Le risque de confusion est apprécié concrètement par les juges, en tenant compte de la ressemblance visuelle et phonétique des signes, de l’identité ou de la similarité des activités, de la clientèle visée et de la zone géographique concernée.
Les limites de la protection
La protection accordée à l’enseigne par l’action en concurrence déloyale n’est pas absolue et connaît plusieurs limites importantes.
La première est le principe de spécialité. La protection est, en principe, limitée au secteur d’activité réellement exercé sous l’enseigne. Il n’y a pas de risque de confusion, et donc pas de concurrence déloyale, si les activités sont totalement différentes (par exemple, une enseigne « Le Soleil » pour une boulangerie et la même pour une agence immobilière). Cependant, ce principe est apprécié de manière assez large : la protection s’étend aux activités similaires ou connexes, où une confusion est possible (par exemple, un restaurant et un cabaret ).
La deuxième limite est le cadre territorial. L’enseigne servant à localiser un établissement, sa protection est naturellement liée à sa zone de chalandise, c’est-à-dire la zone géographique où elle est connue de la clientèle. Le titulaire d’un « Café de la Gare » à Marseille ne peut, en principe, interdire l’usage de la même enseigne à Lille. La protection est « relative, limitée par l’intérêt sérieux et réel du négociant ». Bien sûr, cette zone varie énormément selon l’activité : très locale pour un petit commerce de proximité, elle peut être régionale, nationale voire internationale pour des grands magasins, des chaînes hôtelières, des restaurants renommés ou des entreprises avec une forte présence en ligne.
Ces deux limites (spécialité et territoire) peuvent être atténuées ou dépassées en cas de notoriété de l’enseigne. Une enseigne notoirement connue bénéficie d’une protection renforcée. D’une part, sa distinctivité est présumée plus forte. D’autre part, sa protection peut s’étendre au-delà de sa spécialité d’origine, sur le terrain du parasitisme : utiliser une enseigne célèbre, même pour des activités non concurrentes, peut être sanctionné si cela vise à tirer indûment profit de sa réputation ou à lui porter préjudice. De même, la notoriété peut justifier une protection territoriale très large, voire nationale.
Un cas particulier est celui de l’homonymie patronymique. En principe, toute personne a le droit d’exercer son activité sous son propre nom. Si ce nom est déjà utilisé comme enseigne par un concurrent dans le même secteur et la même zone géographique, le premier utilisateur ne peut interdire au second d’utiliser son patronyme. Toutefois, pour éviter la confusion, le juge peut imposer au second arrivant des mesures de différenciation : ajout du prénom, modification du graphisme, mention distinctive (« Maison fondée en… »). Cette faculté est cependant réservée au nom patronymique et ne s’applique pas au pseudonyme.
Enfin, le fait d’avoir toléré pendant longtemps l’usage d’une enseigne similaire par un concurrent ne signifie pas un abandon du droit. La renonciation à un droit ne se présume pas. Cependant, cette tolérance prolongée pourra être prise en compte par le juge pour modérer le montant des dommages-intérêts accordés.
Protection contre d’autres signes distinctifs
L’enseigne peut également entrer en conflit avec d’autres signes, notamment les marques et les noms de domaine.
Marques : Si une marque est déposée postérieurement à l’usage d’une enseigne identique ou similaire, le titulaire de l’enseigne peut s’opposer à l’enregistrement de la marque ou demander sa nullité, mais à une condition stricte posée par l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle : l’enseigne doit être connue sur l’ensemble du territoire national. Cette condition est appréciée très rigoureusement par les tribunaux : une notoriété simplement locale ou régionale, même importante, ne suffit pas. Il faut prouver une diffusion publicitaire ou une reconnaissance à l’échelle nationale.
Noms de domaine : L’utilisation d’un nom de domaine Internet qui imite une enseigne préexistante peut constituer un acte de concurrence déloyale s’il existe un risque de confusion, notamment si les activités et la zone géographique (même virtuelle) se recoupent. La jurisprudence a ainsi sanctionné l’usage d’un nom de domaine très proche d’une enseigne concurrente locale lorsque le site était promu localement. Dans le cadre des réseaux de franchise, l’usage par un franchisé d’un nom de domaine incluant l’enseigne du réseau est délicat et peut être encadré contractuellement ou limité pour ne pas nuire au réseau ou violer les exclusivités territoriales. Une pratique également sanctionnée est celle de certains moteurs de recherche qui affichent des liens sponsorisés vers des sites contrefaisants ou concurrents lorsqu’un internaute recherche une enseigne ou une marque notoire.
Aspects fiscaux : la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Dernier point, mais non des moindres pour le budget d’une entreprise : les enseignes peuvent être soumises à une taxation locale. Depuis la loi de modernisation de l’économie de 2008, les anciennes taxes sur l’affichage ont été remplacées par une taxe unique : la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Cette taxe peut être instaurée par délibération des communes ou des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Elle frappe tous les supports publicitaires, enseignes et préenseignes visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique.
L’assiette de la taxe est la surface du dispositif (hors encadrement). Les tarifs maximaux sont fixés par la loi (article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales) et varient selon la nature du support (lumineux ou non, numérique ou non), sa surface et la population de la commune. Des exonérations sont prévues par la loi, notamment pour les enseignes relatives à l’activité principale exercée dans l’immeuble si la somme de leurs surfaces est inférieure à un certain seuil (par exemple, 7 m²), ainsi que pour certains supports spécifiques (pharmacies, monuments historiques, etc.). Les communes peuvent également décider d’exonérations ou de réfactions supplémentaires, notamment pour les enseignes de petite taille.
En cas de défaut de déclaration ou de paiement de la TLPE, l’entreprise s’expose à des sanctions : une procédure de taxation d’office et une amende administrative (contravention de 1ère classe pour défaut de déclaration ). Les anciennes mesures de lacération ou destruction des enseignes non taxées ont été supprimées.
Le choix, la gestion et la protection de votre enseigne soulèvent des questions juridiques complexes et peuvent avoir des implications importantes pour votre activité. Pour une analyse personnalisée de votre situation et sécuriser vos droits, notre cabinet se tient à votre disposition.
Sources
- Code de l’environnement (notamment art. L. 581-3 et suivants, R. 581-7, L. 581-14-4, L. 581-18, L. 581-19, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-43)
- Code de commerce (notamment art. L. 123-9, L. 141-5, L. 145-15, L. 145-47 à L. 145-55, L. 251-23, L. 310-3, L. 310-4, L. 330-3)
- Code de la propriété intellectuelle (notamment art. L. 711-3, L. 711-4, L. 712-3, L. 713-6)
- Code de la santé publique (notamment art. L. 3323-2, L. 3511-3, R. 5015-22, R. 5015-53)
- Code monétaire et financier (notamment art. L. 511-8, L. 512-13)
- Code rural et de la pêche maritime (notamment art. L. 311-3)
- Code de la consommation (notamment art. L. 121-80)
- Code de la route (notamment art. R. 418-2 à R. 418-9)
- Code général des collectivités territoriales (notamment art. L. 2223-31, L. 2333-7 à L. 2333-15, R. 2333-27)
- Code civil (notamment art. 1240)
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Loi Grenelle 2)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
- Décret n° 82-211 du 24 février 1982 (modifié)
- Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012
- Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
- Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)