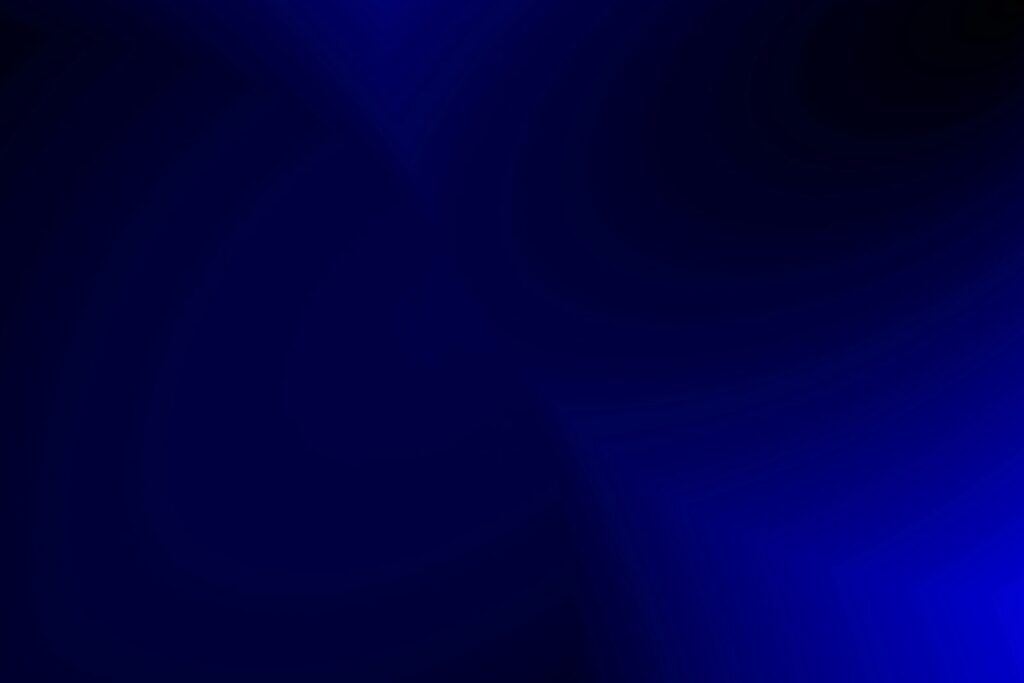Déterminer les contours exacts du « marché pertinent » est une étape fondamentale en droit de la concurrence et des principes de la concurrence déloyale. C’est dans ce cadre que l’on évalue si une pratique restreint le jeu concurrentiel ou si une entreprise détient une position dominante. L’exercice, déjà délicat dans l’économie traditionnelle, devient particulièrement complexe avec l’essor d’internet et du commerce électronique, où les frontières semblent parfois s’estomper.
Pour une entreprise opérant en ligne, comprendre comment les autorités de concurrence définissent son marché est essentiel, notamment pour la caractérisation de la position dominante. Cela permet d’évaluer la légalité de ses accords commerciaux, de ses stratégies tarifaires ou de ses projets de croissance externe. Une mauvaise appréciation peut conduire à des risques juridiques importants. Cet article vise à éclaircir les enjeux spécifiques liés à la délimitation des marchés pour l’accès à internet, le commerce électronique et la publicité en ligne, en s’appuyant sur l’approche des autorités françaises et européennes.
L’accès à internet : un ou plusieurs marchés ?
La fourniture d’accès à internet, brique essentielle de l’économie numérique, a vu coexister différentes technologies : ADSL, câble, fibre optique, et demain peut-être d’autres encore. Une question s’est longtemps posée : ces technologies sont-elles suffisamment interchangeables du point de vue du consommateur pour appartenir à un seul et même marché ?
Plusieurs éléments ont initialement pu faire débat. D’un côté, l’ADSL et le câble offraient des caractéristiques de plus en plus similaires : haut débit, connexion permanente, possibilité d’offres groupées (téléphonie, télévision, internet – les fameux « triple play »). Ces similarités poussaient à considérer qu’elles étaient substituables pour une grande partie des utilisateurs. D’un autre côté, la couverture géographique limitée du câble par rapport à l’ADSL, historiquement déployé sur le réseau téléphonique existant, pouvait justifier de les considérer comme des marchés distincts.
Les autorités de concurrence, comme la Commission européenne, l’ARCEP (le régulateur français des télécoms) et l’Autorité de la concurrence, ont longtemps fait preuve de prudence, laissant parfois la question ouverte dans leurs premières analyses. Cependant, avec l’évolution technologique et la convergence des offres, la tendance s’est affirmée. L’Autorité de la concurrence française a ainsi fini par considérer qu’il existait un marché unique de l’accès à internet à haut débit, englobant les différentes technologies comme l’ADSL et le câble.
Cette approche montre que, malgré la diversité technologique, c’est bien l’usage final – l’accès rapide et fiable à internet – et la perception du consommateur qui priment pour délimiter le marché. L’arrivée massive de la fibre optique, avec ses performances supérieures, pourrait à l’avenir relancer le débat, mais l’approche fonctionnelle devrait rester le guide principal. Pour une entreprise fournissant un accès internet, il est donc probable que sa concurrence s’évalue aujourd’hui sur un marché large du haut débit, toutes technologies confondues.
Le commerce électronique : canal de vente ou marché distinct ?
L’une des questions les plus fréquentes concerne la relation entre la vente en ligne et la vente en magasin physique. Faut-il considérer qu’internet est simplement un canal de distribution supplémentaire venant s’ajouter aux magasins, catalogues, etc., ou constitue-t-il un marché à part entière ? La réponse a des implications directes sur l’évaluation de la puissance de marché d’un acteur ou sur la portée de ses accords de distribution.
La distinction entre les transactions interentreprises (B2B – Business to Business) et celles destinées aux consommateurs finaux (B2C – Business to Consumer) apporte un premier niveau de nuance.
Dans le domaine du B2B, l’émergence des places de marché électroniques (marketplaces) a posé question. Ces plateformes, facilitant les transactions entre professionnels, sont-elles en concurrence directe avec les méthodes d’approvisionnement traditionnelles (contacts directs, fax, téléphone) ? Les premières analyses de la Commission européenne, par exemple dans l’affaire MyAircraft.com concernant l’aéronautique, suggéraient que les entreprises considéraient souvent ces bourses électroniques comme un outil parmi d’autres, faisant partie d’un marché plus large des transactions B2B. Cette vision semble pragmatique : une entreprise cherchant à s’approvisionner choisira le canal le plus efficace, qu’il soit en ligne ou non. Ainsi, sauf spécificités très marquées, une place de marché B2B est généralement vue comme concurrente des autres modes de transaction.
Pour la vente aux consommateurs (B2C), le débat a été plus nourri. Initialement, les différences pouvaient paraître importantes : expérience d’achat différente, délais de livraison, services associés, politique de prix parfois agressive en ligne. L’Autorité de la concurrence a d’ailleurs pu considérer, par le passé, que la distribution à distance (incluant internet) et la distribution en magasin n’étaient qu’imparfaitement substituables.
Cependant, l’évolution des comportements d’achat (recherche en ligne avant achat en magasin, « click and collect », etc.) et la présence croissante des enseignes traditionnelles sur internet ont brouillé les lignes. La pratique décisionnelle récente tend désormais à définir des marchés de produits (électroménager, livres, jouets, ameublement…) qui englobent à la fois les ventes en ligne et les ventes en magasin physique. Cela reflète la réalité vécue par le consommateur, qui arbitre de plus en plus entre ces différents canaux pour un même besoin. Pour un e-commerçant B2C, cela signifie que sa concurrence inclut non seulement les autres sites en ligne, mais aussi les magasins physiques vendant les mêmes types de produits.
Reste la question de la dimension géographique de ces marchés. Internet abolit-il les frontières ? En théorie, un site web est accessible de partout. En pratique, plusieurs facteurs tendent encore à maintenir une dimension géographique souvent nationale, voire plus locale pour certains biens ou services. Les barrières linguistiques sont évidentes. À cela s’ajoutent les différences de réglementation (protection du consommateur, taxes), les frais et délais de livraison, les habitudes de consommation, et parfois la nécessité de voir ou d’essayer le produit. Ainsi, même pour un produit vendu en ligne, le marché pertinent est souvent considéré comme national par les autorités. Par exemple, dans une affaire concernant des petites annonces automobiles en ligne, bien que les sites soient accessibles mondialement, le besoin pour l’acheteur potentiel de rencontrer le vendeur et d’inspecter le véhicule limitait en pratique l’intérêt aux annonces locales ou régionales.
La publicité en ligne : un marché spécifique ?
Le secteur de la publicité a été profondément transformé par le numérique, offrant de nouvelles possibilités de ciblage et de mesure. Les autorités de concurrence ont dû analyser si la publicité en ligne formait un marché unique ou s’il fallait distinguer différents segments.
Une première distinction nette est faite entre la publicité en ligne et la publicité hors ligne (presse, télévision, radio, affichage). En raison de leurs caractéristiques très différentes (ciblage, interactivité, mesure des performances, coûts), la substituabilité entre ces deux univers est considérée comme très limitée. Un annonceur cherchant à toucher une audience précise avec un message interactif ne trouvera pas d’équivalent satisfaisant dans les médias traditionnels.
Au sein même de la publicité en ligne, d’autres distinctions peuvent s’opérer. L’Autorité de la concurrence a notamment considéré que la publicité liée aux recherches (les liens sponsorisés apparaissant sur les moteurs comme Google) pouvait constituer un marché spécifique. Sa particularité réside dans le ciblage basé sur l’intention exprimée par l’internaute via ses mots-clés, ce qui la différencie fortement d’autres formes de publicité en ligne comme la publicité display (bannières) ou la publicité sur les réseaux sociaux, qui relèvent davantage d’une logique d’interruption ou de notoriété.
De même, la publicité de référencement dans les annuaires en ligne, reposant sur un modèle économique et un usage différents, a également été envisagée comme un marché distinct.
La définition exacte des marchés de la publicité en ligne reste un exercice complexe, influencé par l’évolution rapide des technologies et des usages (montée de la vidéo, publicité programmatique…). Les autorités adoptent souvent une approche prudente, analysant au cas par cas la substituabilité entre les différents formats et plateformes.
Quant à la dimension géographique, comme pour le commerce électronique, elle est généralement considérée comme nationale pour la publicité en ligne, principalement en raison des barrières linguistiques et culturelles qui segmentent naturellement les campagnes publicitaires.
En conclusion, la définition du marché pertinent dans l’univers numérique exige une analyse fine des usages, des technologies et des perceptions des acteurs économiques. Si une tendance à l’intégration des canaux online et offline se dessine pour la vente de nombreux produits, des spécificités fortes demeurent pour l’accès aux infrastructures ou pour certains segments publicitaires. L’évolution constante de cet environnement impose une vigilance particulière.
Définir correctement le marché pertinent est essentiel pour évaluer vos pratiques commerciales en ligne. Pour une analyse adaptée à votre activité, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Communication de la Commission relative à la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03)
- Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations
- Code de commerce, notamment Livre IV