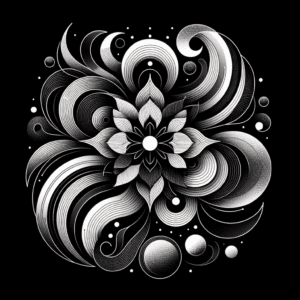La saisie conservatoire d’un navire est une procédure redoutable pour tout créancier cherchant à recouvrer sa créance. Elle permet d’immobiliser un actif de grande valeur, souvent l’outil de travail principal de son débiteur. Cependant, sa mise en œuvre est semée d’embûches, particulièrement lorsque la question de la propriété du navire se pose. En effet, le droit maritime est un carrefour complexe où se croisent le droit national et des conventions internationales, créant des régimes juridiques distincts et parfois contradictoires. Cet article se propose d’approfondir les aspects les plus techniques de la saisissabilité, en complément de notre guide complet sur la saisie conservatoire des navires. Naviguer dans ces eaux troubles sans une boussole juridique précise peut mener à des déconvenues coûteuses, que ce soit pour le créancier imprudent ou le propriétaire injustement saisi. L’assistance d’un avocat compétent en saisie de navire s’avère alors indispensable pour sécuriser ses droits.
Introduction à la saisissabilité du navire en saisie conservatoire
Le navire, bien que qualifié de bien meuble par le Code civil, bénéficie d’un statut juridique singulier qui le rapproche à certains égards d’un immeuble. Son immatriculation et la possibilité de l’hypothéquer témoignent de cette hybridité. Cette nature particulière justifie l’existence d’un régime de saisie spécifique, distinct du droit commun des voies d’exécution. Les enjeux économiques liés à son immobilisation expliquent également la complexité des règles applicables, que l’on peut retrouver dans notre guide sur les navires saisissables et insaisissables.
Particularités du navire et lien avec la créance
La possibilité de saisir un navire dépend fondamentalement du droit applicable, qui varie selon le pavillon du navire. Deux systèmes principaux coexistent : le droit français et la Convention de Bruxelles de 1952. Le droit français, fondé sur le droit de gage général de l’article 2284 du Code civil, permet à tout créancier de saisir un navire de son débiteur, à condition que sa créance paraisse fondée en son principe (article L. 5114-22 du Code des transports). Peu importe que la dette soit de nature maritime ou terrestre ; le lien entre la créance et le navire est indifférent.
À l’inverse, la Convention de Bruxelles de 1952, d’inspiration anglo-saxonne, adopte une approche réelle (in rem). Elle n’autorise la saisie que pour garantir une « créance maritime », dont la liste est exhaustivement définie à son article 1er. Dans ce cadre, la créance est attachée au navire lui-même, et non uniquement à la personne du débiteur. Cette distinction conceptuelle a des conséquences pratiques majeures, notamment sur la possibilité de saisir un navire qui n’appartient pas directement au débiteur.
Responsabilité du créancier saisissant en cas d’abus de saisie
L’immobilisation d’un navire est une mesure particulièrement dommageable. Un créancier qui en abuse engage sa responsabilité. L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution donne au juge le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts. En droit maritime, la responsabilité du saisissant n’est pas automatique ; elle suppose la démonstration d’une faute. La jurisprudence retient l’abus lorsque le créancier a agi avec une légèreté blâmable, une mauvaise foi évidente ou une intention de nuire.
Les tribunaux peuvent par exemple sanctionner une saisie disproportionnée par rapport au montant de la créance ou une saisie engagée sans vérifications élémentaires sur l’identité du propriétaire du navire. Le préjudice subi par l’armateur, incluant les pertes d’exploitation, les frais portuaires et l’atteinte à sa réputation, peut alors donner lieu à une indemnisation significative. Les demandes en réparation devant le juge de l’exécution suivent un formalisme précis qui nécessite une expertise juridique pour être menées à bien.
Saisissabilité d’un navire n’appartenant pas au débiteur
C’est l’une des questions les plus complexes en matière de saisie conservatoire. La possibilité de saisir le navire d’un tiers pour recouvrer la dette d’un autre est une dérogation majeure aux principes fondamentaux du droit des sûretés. Les solutions diffèrent radicalement entre le cadre international et le droit français.
Cadre international (Convention de Bruxelles de 1952 : navire auquel la créance se rapporte vs. autre navire du propriétaire)
L’article 3 de la Convention de 1952 est au cœur du dispositif. Il permet au créancier de saisir « soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte ». Cette disposition consacre la saisie du « sister ship » : le créancier peut poursuivre non seulement le navire à l’origine de sa créance, mais aussi les autres navires de la flotte du même propriétaire. Cette approche, qui s’attache à la personne du propriétaire au moment de la naissance de la dette, offre une garantie étendue au créancier.
Cadre français (droit de gage général et exceptions)
En droit français, le principe est inverse. En vertu du droit de gage général des créanciers (articles 2284 et 2285 du Code civil), seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis. Il est donc en principe impossible de saisir un navire qui n’est pas la propriété de la personne ou de l’entreprise redevable de la dette. Cette règle, fondée sur une conception personnelle de l’obligation, connaît cependant des exceptions. La principale exception concerne les créances assorties d’un privilège maritime. Ces privilèges, qui confèrent un droit de suite, permettent au créancier de suivre le navire en quelques mains qu’il passe et donc de le saisir même s’il n’appartient plus au débiteur initial.
Cas des navires affrétés (coque-nue, à temps, au voyage) et dettes de l’affréteur
La situation se complique lorsque le navire est exploité par un affréteur qui n’en est pas propriétaire. Peut-on saisir le navire pour une dette de l’affréteur ? La Convention de 1952 y répond en partie. Son article 3, paragraphe 4, autorise expressément la saisie d’un navire affrété « coque-nue » pour une créance maritime relative à ce navire, lorsque l’affréteur en répond seul. La même disposition précise que cette règle « s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime », ce que la jurisprudence a interprété comme incluant l’affrètement à temps et au voyage, à condition que la créance soit liée à l’exploitation du navire. En droit français, en revanche, la saisie pour une dette de l’affréteur reste en principe impossible, sauf si le créancier peut invoquer un privilège maritime sur le navire ou démontrer que le propriétaire apparent (le fréteur) a créé une confusion légitime l’ayant laissé croire qu’il contractait avec le véritable exploitant.
Importance de l’identité du propriétaire et la théorie de l’apparence
La vérification de l’identité du propriétaire du navire est une diligence fondamentale pour le créancier. Saisir un navire en se trompant de propriétaire expose à une action en mainlevée immédiate et à une condamnation pour saisie abusive. La théorie de l’apparence, qui protège celui qui a contracté avec une personne qu’il pouvait légitimement croire être le véritable propriétaire, est appliquée avec une grande prudence par les tribunaux. Une simple consultation des registres d’immatriculation suffit généralement à connaître le propriétaire officiel. L’apparence ne pourra être invoquée que si le propriétaire réel a, par son comportement, contribué à créer une situation trompeuse et a induit le créancier en erreur. En pratique, cette théorie trouve rarement à s’appliquer lorsque des vérifications de base auraient permis de lever l’ambiguïté.
Saisissabilité d’un autre navire que celui auquel la créance se rapporte
La faculté pour un créancier de saisir un « sister ship », c’est-à-dire un navire appartenant au débiteur mais sans lien direct avec la créance, est une arme stratégique. Elle permet de contourner l’indisponibilité du navire initial (par exemple, s’il est en mer ou dans un port inaccessible) en ciblant un autre actif de la même flotte.
Le principe de l’article 3 de la Convention de 1952 et ses exceptions (propriété, hypothèque)
Comme évoqué, l’article 3 de la Convention de Bruxelles de 1952 pose le principe de la saisissabilité de tout autre navire appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte. Cependant, ce même article prévoit des exceptions importantes. La saisie d’un « sister ship » est exclue pour trois types de créances maritimes spécifiques, listées aux alinéas o), p) et q) de l’article 1er : celles relatives à la propriété ou la copropriété contestée d’un navire, et celles garanties par une hypothèque ou un mort-gage. Pour ces créances, qui portent sur un droit réel très spécifique, seul le navire objet du litige peut être saisi. Le créancier hypothécaire, par exemple, bénéficie d’une sûreté sur un navire désigné et ne peut étendre son droit de saisie aux autres navires de son débiteur au titre de cette même garantie, comme cela est détaillé dans le régime des hypothèques maritimes.
Les « single ship companies » et les « navires apparentés » (confusion de patrimoines, fictivité)
Pour contourner la règle du « sister ship », de nombreux armateurs ont recours à des montages juridiques complexes, notamment la création de « single ship companies ». Chaque navire d’une flotte est détenu par une société distincte, empêchant en théorie la saisie d’un navire pour la dette de la société propriétaire d’un autre. Face à cette pratique, les créanciers ont développé la théorie des « navires apparentés » (associated ships). La jurisprudence française, après avoir un temps admis la saisie sur la base d’une simple « communauté d’intérêts » ou d’une apparence d’unité économique, s’est montrée plus stricte. Aujourd’hui, pour « percer le voile social » et saisir un navire appartenant à une société B pour la dette d’une société A, le créancier doit prouver la fictivité de l’une des sociétés ou une confusion de leurs patrimoines. Il doit établir que l’autonomie juridique des sociétés n’est qu’une façade dissimulant une réalité économique et décisionnelle unique.
La théorie de l’« émanation maritime » pour les flottes d’état
Une problématique similaire se pose pour les flottes appartenant à des États mais exploitées par des sociétés de droit privé distinctes. La théorie de l’ « émanation maritime » permet, sous conditions, de saisir le navire d’une de ces sociétés pour une dette de l’État ou d’une autre société étatique. Comme pour les « single ship companies », les tribunaux français exigent une preuve rigoureuse. Le simple contrôle de l’État sur la société ou l’accomplissement d’une mission de service public ne suffit pas. Le créancier doit démontrer que la société n’a aucune autonomie réelle et ne constitue qu’une simple « émanation » de l’État, sans patrimoine propre distinct.
Application du droit français (article 2284 du Code civil)
En droit français, la situation est plus simple en apparence. L’article 2284 du Code civil établit que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. En application de ce droit de gage général, si un débiteur est propriétaire de plusieurs navires, le créancier peut saisir n’importe lequel d’entre eux pour garantir sa créance, même si celle-ci n’a de rapport qu’avec un seul des navires. Cette règle s’applique y compris si le débiteur est un affréteur, à condition que le navire saisi lui appartienne en propre.
Saisissabilité du navire passé en d’autres mains que celles du débiteur
L’une des plus grandes craintes d’un créancier est de voir le navire, son gage, être vendu ou transféré avant qu’il ait pu le saisir. La question de savoir si la saisie reste possible après ce transfert a donné lieu à d’importantes évolutions jurisprudentielles.
Le navire vendu par le débiteur (droit de suite et revirement jurisprudentiel)
Pendant un temps, la Cour de cassation a admis, sur le fondement de l’article 3 de la Convention de 1952, que le titulaire d’une créance maritime pouvait saisir le navire auquel sa créance se rapporte même si celui-ci avait été vendu. Cette solution, qui consacrait un véritable droit de suite pour toute créance maritime, était très favorable aux créanciers. Cependant, un revirement majeur a eu lieu en 2005. S’appuyant sur l’article 9 de la même convention, la Cour de cassation a jugé que la saisie d’un navire n’appartenant plus au débiteur n’est autorisée que si le créancier se prévaut d’une créance assortie d’un privilège conférant un droit de suite selon la loi du for (la loi française en l’espèce). Désormais, un créancier chirographaire ne peut plus saisir un navire après sa vente ; seuls les créanciers privilégiés conservent cette faculté.
Le navire restitué par l’affréteur à son propriétaire (hésitations jurisprudentielles)
La situation est également incertaine lorsque la créance est née du chef d’un affréteur et que ce dernier a restitué le navire à son propriétaire à la fin du contrat d’affrètement. La jurisprudence a longtemps hésité. Certains arrêts ont autorisé la saisie, estimant que l’article 3, paragraphe 4, de la Convention de 1952 ne limitait pas cette possibilité à la seule période de l’affrètement. D’autres décisions ont refusé, considérant que la saisie pour une dette de l’affréteur est liée au débiteur et non au navire lui-même, et qu’il serait inéquitable de faire supporter au propriétaire les conséquences d’une dette qui lui est étrangère après avoir récupéré son bien. La tendance actuelle, alignée sur le revirement de 2005 concernant la vente, semble pencher vers une impossibilité de saisir le navire après sa restitution, sauf si le créancier peut invoquer une créance privilégiée lui conférant un droit de suite.
La complexité des règles de propriété en droit maritime, combinée aux subtilités des conventions internationales, rend la saisie conservatoire de navire une procédure à haut risque. Une analyse juridique précise est indispensable pour sécuriser une créance ou pour défendre un navire contre une saisie potentiellement abusive. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, prenez contact avec notre équipe d’avocats experts en saisie de navire.
Sources
- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
- Code des transports
- Code civil
- Code des procédures civiles d’exécution