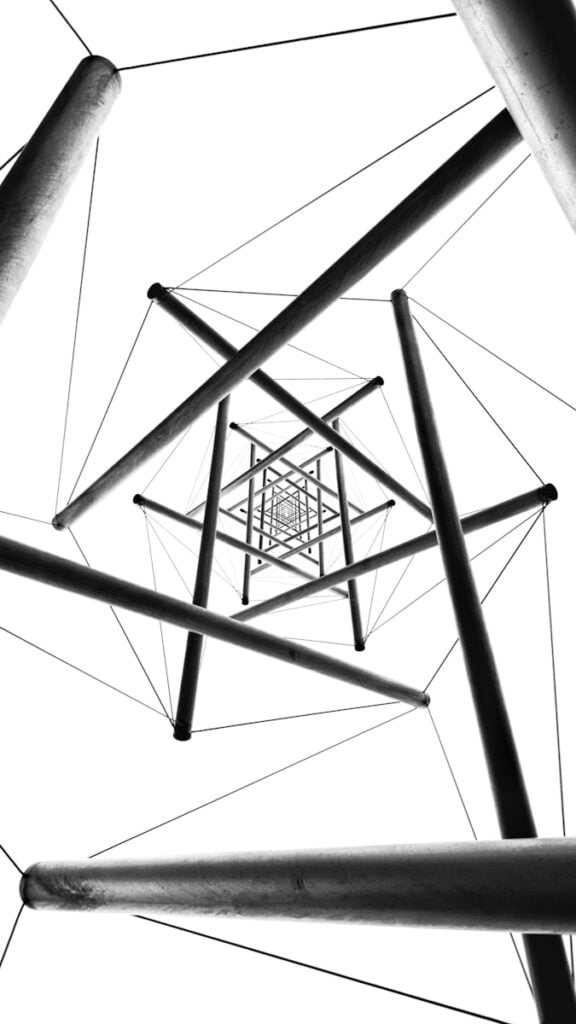L’attrait des taux d’intérêt historiquement bas a souvent conduit les emprunteurs, qu’il s’agisse de collectivités, d’établissements de santé ou d’entrepreneurs, à se tourner vers des solutions de financement présentées comme plus avantageuses. Parmi celles-ci, les prêts structurés, souvent qualifiés de « toxiques », se sont révélés être des montages redoutables. Construits sur des formules d’indexation complexes et opaques, ils ont pu transformer une dette maîtrisable en un fardeau financier incontrôlable. Derrière la promesse d’un coût initial réduit se cachent en réalité les risques inhérents à une ingénierie financière dont les emprunteurs ne mesurent pas toujours la portée. Cet article se propose de décrypter les mécanismes de ces crédits, les fondements juridiques permettant de contester leur validité et les leviers d’action pour engager la responsabilité des établissements bancaires. La complexité de ce contentieux bancaire exige une analyse précise des obligations du prêteur et des droits de l’emprunteur.
Définition et caractérisation des prêts structurés (dits toxiques)
Un prêt structuré est un crédit dont le taux d’intérêt et, parfois, le capital à rembourser, ne sont pas déterminés de manière fixe ou par référence à un indice simple comme l’Euribor. Sa particularité réside dans l’utilisation de formules mathématiques complexes qui lient son évolution à des actifs sous-jacents variés et souvent très volatils. Il s’agit en réalité d’un contrat de prêt auquel est adossé un ou plusieurs produits financiers dérivés, comme des swaps ou des options, qui en modifient radicalement le profil de risque.
Typologie des produits (barrière désactivante, de pente, de change)
Bien que les montages puissent être infiniment variés, on distingue principalement trois grandes familles de prêts structurés qui ont alimenté le contentieux :
- Les produits à barrière désactivante : Ils proposent un taux fixe avantageux tant qu’un indice de référence (un taux de change, un taux d’intérêt) ne franchit pas un certain seuil, appelé « barrière ». Si cette barrière est franchie, le taux bascule sur une formule variable souvent très défavorable et potentiellement illimitée.
- Les produits de pente : Le taux d’intérêt est ici indexé sur l’écart (la « pente ») entre des taux d’intérêt de maturités différentes, par exemple entre un taux à 10 ans et un taux à 2 ans. La complexité de ces courbes rend leur évolution difficilement prévisible pour un non-initié.
- Les produits à barrière de change : Particulièrement risqués, ces prêts sont généralement indexés sur la parité entre plusieurs devises, comme l’euro et le franc suisse (CHF) ou le yen japonais (JPY). Le taux d’intérêt, initialement attractif, peut exploser si le cours de la devise étrangère s’apprécie fortement par rapport à l’euro, entraînant une augmentation exponentielle des remboursements.
Enjeux spécifiques pour les collectivités locales et les particuliers
Les prêts structurés ont été largement commercialisés auprès des collectivités territoriales, des hôpitaux et des organismes de logement social. Attirés par des conditions de départ favorables pour financer leurs investissements, ces acteurs publics se sont retrouvés piégés par des charges financières qui ont grevé lourdement leurs budgets, au détriment du service public. L’encours de ces prêts, porté notamment par des établissements comme Dexia, a représenté plusieurs milliards d’euros et a nécessité une intervention de l’État pour éviter un désastre financier.
Les particuliers et les entrepreneurs ne sont pas en reste. Des crédits immobiliers, souvent destinés à des opérations de défiscalisation, ont été proposés avec des indexations sur des devises étrangères. Pour l’emprunteur, le risque est double : non seulement la charge des intérêts peut flamber, mais le capital restant dû, libellé en devise, peut lui aussi augmenter considérablement si le taux de change évolue défavorablement, menaçant directement le patrimoine personnel.
Le contentieux de la qualification et de la validité des prêts structurés
Face à l’explosion de la charge de la dette, de nombreux emprunteurs ont saisi les tribunaux pour tenter de remettre en cause ces contrats. Les actions judiciaires s’articulent autour de plusieurs axes, visant à contester la nature même du contrat, sa validité ou les conditions de son octroi.
Qualification de produit spéculatif ou d’instrument financier à terme
Une question fondamentale est de savoir si un prêt structuré doit être traité comme un simple crédit ou comme un instrument financier complexe et spéculatif. La distinction est de taille. S’il s’agit d’un instrument financier, la banque est tenue à des obligations beaucoup plus strictes en matière d’information et de conseil, issues du Code monétaire et financier. La jurisprudence définit un produit comme spéculatif lorsqu’il expose l’emprunteur à des risques démesurés, voire illimités, en se basant sur des variables sans rapport avec son activité économique propre. L’intégration d’un swap ou d’options complexes dans la structure du prêt est un indice fort de sa nature spéculative, bien que les tribunaux examinent chaque cas individuellement.
La validité de la clause d’indexation (monétaire, code monétaire et financier)
Le droit français encadre strictement les clauses d’indexation. En vertu des articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier, une clause d’indexation n’est valable que si l’indice choisi est en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties. Une clause qui indexe un prêt interne sur une parité de devises étrangères peut être jugée illicite, car sans lien direct avec l’activité de l’emprunteur. La Cour de cassation a eu des positions divergentes sur ce point, la chambre commerciale se montrant plus souple que la chambre civile. La sanction d’une clause illicite est la nullité, qui peut être absolue si l’on considère qu’elle contrevient à un ordre public de direction monétaire.
L’annulation pour vices du consentement (violence, dol, erreur)
Les emprunteurs ont également tenté de faire annuler ces prêts sur le fondement des vices du consentement prévus par le Code civil. L’erreur sur la nature spéculative du produit, le dol résultant d’une présentation trompeuse par la banque, ou la violence économique exercée sur une collectivité en difficulté sont des arguments avancés. Cependant, ces actions ont souvent échoué, les juges considérant que les emprunteurs, notamment les collectivités locales dotées de services financiers, étaient des « emprunteurs avertis », capables de comprendre la portée de leur engagement, même si la formule mathématique était complexe.
Actions fondées sur les pratiques commerciales trompeuses (code de la consommation)
L’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses, prévue par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, offre un autre angle d’attaque. Une pratique est considérée comme trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations ou présentations fausses, ou de nature à induire en erreur l’emprunteur. Cela peut concerner une présentation qui met en avant un avantage (un taux bas) tout en occultant ou en minimisant un risque majeur (l’exposition à une variation de change illimitée). La démonstration d’une telle pratique peut mener à des sanctions pénales pour la banque et à l’indemnisation du préjudice subi par le client.
La responsabilité de la banque face aux prêts structurés
Au-delà de la validité du contrat lui-même, la responsabilité de l’établissement bancaire peut être recherchée pour manquement à ses obligations professionnelles. Ces devoirs, définis par la jurisprudence, varient en intensité selon la qualité de l’emprunteur et la complexité du produit.
Manquement au devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde impose à la banque d’alerter un emprunteur « non averti » sur les risques spécifiques d’une opération. Ce devoir est particulièrement pertinent dans deux situations : lorsque le crédit finance une opération à caractère spéculatif ou lorsqu’il présente un risque d’endettement excessif pour l’emprunteur. Pour les prêts structurés, le caractère spéculatif est souvent manifeste. La principale difficulté pour l’emprunteur est de prouver sa qualité de « non averti ». Si les particuliers sont plus facilement considérés comme profanes, les collectivités locales ou les entreprises dotées d’un service financier peinent à obtenir cette qualification, ce qui affaiblit leurs chances de succès sur ce fondement.
Manquement au devoir d’information
Plus large que la mise en garde, le devoir d’information oblige la banque à fournir une information complète, exacte et non trompeuse sur les caractéristiques du prêt. La documentation commerciale et contractuelle doit être claire et permettre à l’emprunteur de comprendre la nature et l’étendue des risques. Des condamnations ont été prononcées contre des banques pour ne pas avoir informé leurs clients sur des points essentiels, comme la méthode de valorisation des swaps sous-jacents ou les conséquences d’une évolution défavorable des indices. La banque doit être en mesure de prouver qu’elle a bien remis une documentation adéquate et compréhensible.
Manquement au devoir de conseil
Le devoir de conseil est l’obligation la plus exigeante. Il ne se limite pas à informer, mais requiert de la banque qu’elle oriente activement son client vers la solution la mieux adaptée à sa situation et à ses objectifs. En principe, la banque est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’une opération. Cependant, ce devoir de conseil peut être retenu si la banque a pris l’initiative du montage, a incité le client à opter pour un produit complexe ou a proposé une solution de couverture qui s’est révélée inadaptée. Dans ce cas, son rôle actif justifie une responsabilité accrue.
Le devoir d’éclairer (jurisprudence grimaldi)
Inspiré d’un arrêt de principe (Grimaldi), le devoir d’éclairer représente une obligation plus subtile. Il peut être invoqué même à l’égard d’un emprunteur « averti ». Il repose sur l’idée qu’en présence d’une asymétrie d’informations significative, le professionnel (la banque) qui détient une information que son client ne peut raisonnablement pas avoir, doit la lui communiquer. Dans le contexte des prêts structurés, cela pourrait concerner des informations sur la volatilité exceptionnelle d’un indice ou sur des risques systémiques que seule la banque est en mesure d’anticiper. La violation de ce devoir engage la responsabilité de la banque pour perte de chance pour l’emprunteur de ne pas contracter.
Le traitement légal et les solutions de sortie de crise des prêts toxiques
Face à l’ampleur du contentieux et au risque financier majeur pour les finances publiques, le législateur est intervenu pour encadrer la situation et proposer des portes de sortie, tout en réglementant plus strictement les crédits à l’avenir.
La création du fonds de soutien au remboursement anticipé (loi de finances pour 2014)
Pour aider les collectivités locales et certains établissements publics étranglés par ces emprunts, la loi de finances pour 2014 a institué un fonds de soutien. Financé par l’État et le secteur bancaire, ce fonds est destiné à prendre en charge une partie des indemnités de remboursement anticipé. Cependant, l’octroi de cette aide est conditionné à la conclusion d’une transaction avec la banque, ce qui implique une renonciation à toute action en justice. Ce dispositif a donc forcé les emprunteurs publics à un arbitrage délicat entre une aide certaine mais partielle et un contentieux long et à l’issue incertaine.
La validation rétroactive des prêts consentis (loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014)
La menace la plus sérieuse pour les banques et pour l’État (via sa garantie à Dexia) provenait des actions en nullité fondées sur l’absence ou l’irrégularité du Taux Effectif Global (TEG) dans les contrats. Des jugements avaient commencé à donner raison aux emprunteurs sur ce terrain très formel. Pour parer à un coût estimé à plus de 17 milliards d’euros, le législateur a adopté une loi de validation rétroactive. Cette loi a « validé » les contrats de prêt conclus avec des personnes morales de droit public contre les contestations fondées sur le TEG, à condition que d’autres informations sur le coût du crédit figurent dans l’acte. Saisi de la question, le Conseil Constitutionnel a jugé cette loi conforme à la Constitution, estimant que le risque financier majeur pour les finances publiques constituait un « motif impérieux d’intérêt général » justifiant une telle rétroactivité. Cette loi a fermé une voie de contentieux importante, mais n’a pas touché aux actions fondées sur les manquements aux devoirs d’information ou de conseil.
Les recommandations de l’acpr et l’encadrement des crédits à venir
Pour l’avenir, les autorités ont renforcé la protection des emprunteurs. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a émis des recommandations de bonnes pratiques, exigeant des banques une plus grande transparence. Celles-ci doivent désormais fournir des simulations claires illustrant les effets d’une variation défavorable des indices et remettre un document d’information distinct alertant sur le risque de change. Par ailleurs, la loi a durci les règles applicables aux prêts aux collectivités locales et aux particuliers. Les collectivités ne peuvent plus souscrire d’emprunts fondés sur des indices trop complexes et doivent couvrir intégralement le risque de change. Pour les particuliers, les prêts en devises étrangères sont désormais très restreints.
La problématique des prêts structurés toxiques illustre la tension entre l’innovation financière et la nécessaire protection des emprunteurs. Les litiges qui en ont découlé ont mis en lumière les devoirs des établissements bancaires et les recours dont disposent leurs clients. Si vous êtes confronté à un prêt structuré dont la charge est devenue excessive, il est indispensable d’analyser votre situation contractuelle pour identifier les actions possibles. Notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans cette démarche et défendre vos intérêts face à l’établissement bancaire.
Sources
- Code monétaire et financier
- Code de commerce
- Code civil
- Code de la consommation
- Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la validation de contrats de prêt ou d’emprunt conclus par des personnes morales
- Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014