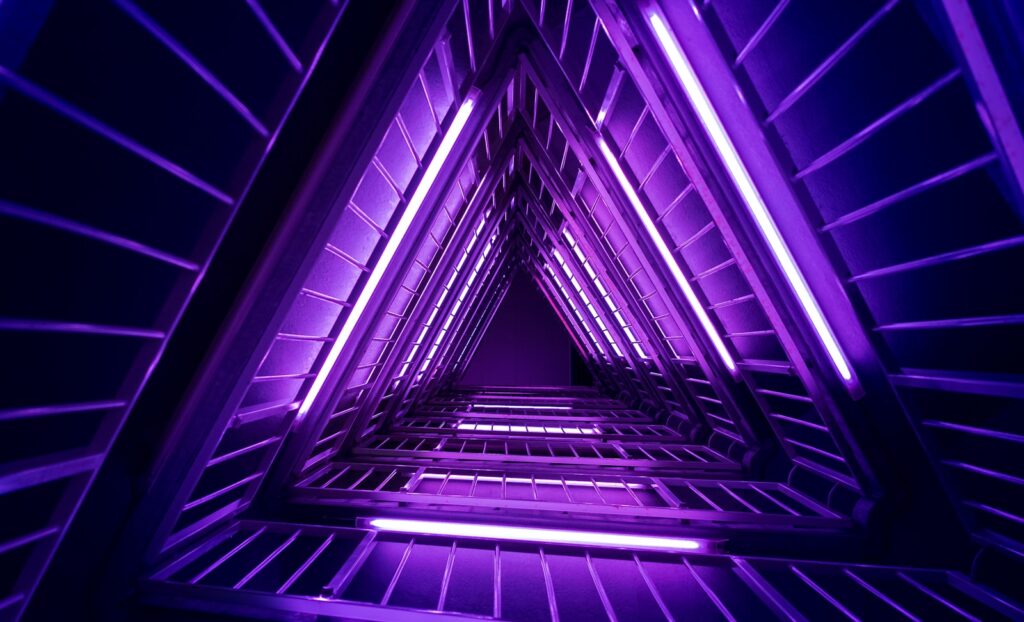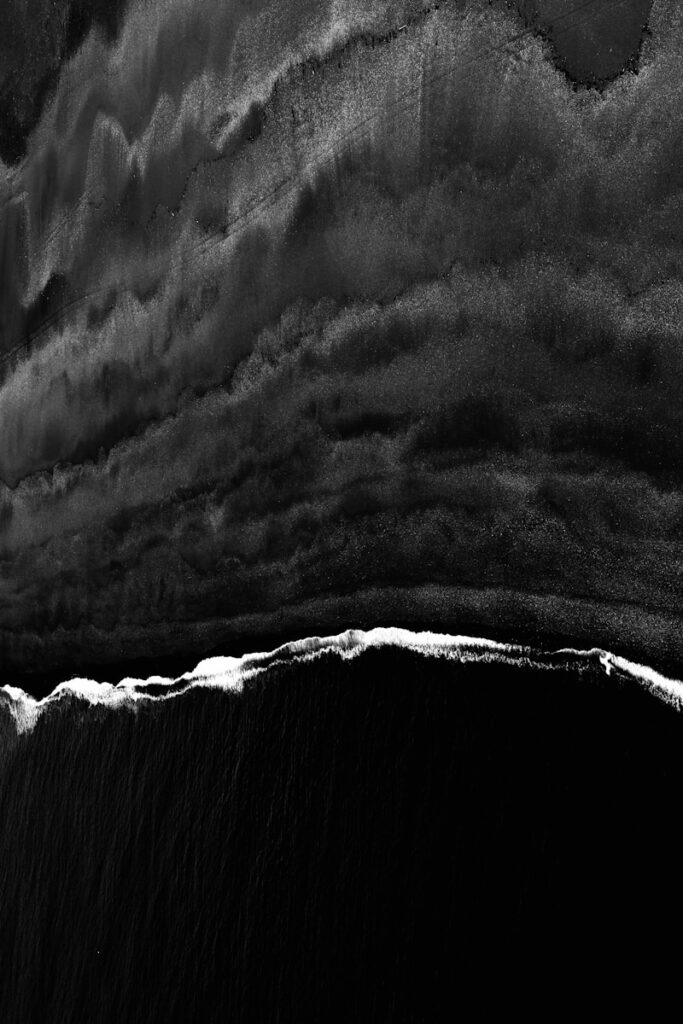Vous avez identifié des agissements de concurrence déloyale de la part d’un rival et vous avez réuni des preuves suffisantes. La question qui se pose maintenant est : concrètement, que pouvez-vous faire ? Quelles sont les démarches à entreprendre pour faire cesser ces pratiques et obtenir réparation ? Pour cela, il est crucial de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Et quelles sont les issues possibles d’une action en justice ? Pour agir efficacement contre la concurrence déloyale, il est essentiel de bien comprendre ses fondements juridiques et sa définition, et de connaître les outils procéduraux à votre disposition et les sanctions que les tribunaux peuvent prononcer. Cet article vous guide à travers les aspects pratiques de l’action : des mesures d’urgence pour stopper rapidement le trouble à l’action au fond pour une réparation complète, sans oublier les questions essentielles de compétence des tribunaux.
Agir en urgence : les mesures préventives par référé
Le temps est souvent un facteur critique en matière de concurrence déloyale. Une campagne de dénigrement, une confusion entretenue sur le marché, un débauchage massif… ces actes causent un préjudice qui s’aggrave jour après jour. Attendre l’issue d’un procès au fond, qui peut prendre des mois voire des années, risque de laisser des séquelles irréparables à votre entreprise. Heureusement, le droit prévoit des procédures d’urgence pour réagir vite : les référés.
Le référé « classique » (devant le Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal judiciaire, selon les cas) permet de demander au juge des mesures rapides lorsque deux conditions principales sont réunies :
- Soit l’existence d’un trouble manifestement illicite : cela signifie que la faute de concurrence déloyale doit être suffisamment évidente, flagrante, même si des discussions sur le fond restent possibles.
- Soit un dommage imminent : un préjudice grave est sur le point de se produire si rien n’est fait immédiatement.
Que pouvez-vous obtenir en référé ?
- La mesure la plus fréquente et la plus utile est la cessation immédiate des agissements déloyaux. Le juge peut ordonner à votre concurrent d’arrêter sa publicité trompeuse, de retirer des produits créant la confusion, de cesser d’utiliser un nom ou un logo litigieux… Cette interdiction est généralement assortie d’une astreinte, c’est-à-dire une pénalité financière (par exemple, 1000 euros par jour de retard) pour s’assurer que la décision soit respectée rapidement.
- Vous pouvez aussi demander une provision, c’est-à-dire une avance sur les dommages et intérêts que vous réclamerez au fond. Cette mesure est accordée si l’existence de votre préjudice et sa cause (la faute) ne sont pas sérieusement contestables.
- Enfin, le juge peut ordonner diverses mesures conservatoires pour éviter que le dommage ne s’aggrave en attendant le jugement sur le fond.
L’avantage majeur du référé est sa rapidité (décision souvent en quelques semaines) et le fait que le juge peut ordonner des mesures même s’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit. Le juge des référés ne tranche pas le litige définitivement, mais il prend les mesures urgentes qui s’imposent face à une situation manifestement anormale ou dangereuse.
Une autre procédure d’urgence utile est la demande de mesures d’instruction « in futurum » (sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile). Son but n’est pas de faire cesser le trouble, mais d’obtenir des preuves en vue d’un futur procès au fond. Si vous suspectez des actes déloyaux mais peinez à les prouver (par exemple, des manœuvres internes chez le concurrent), vous pouvez demander au juge d’ordonner une expertise, un constat par huissier, voire la saisie de certains documents chez votre adversaire. Pour obtenir gain de cause, vous devrez justifier d’un « motif légitime », c’est-à-dire de soupçons sérieux et plausibles. Si vous craignez que les preuves disparaissent si votre adversaire est prévenu, vous pouvez même demander ces mesures « sur requête », c’est-à-dire sans débat contradictoire initial. C’est un outil précieux pour construire un dossier solide avant d’engager une action au fond plus coûteuse et longue.
L’action au fond : obtenir réparation et des mesures définitives
Si les mesures d’urgence visent à parer au plus pressé, c’est l’action au fond qui permettra de faire trancher définitivement le litige, d’établir la responsabilité de votre concurrent et d’obtenir une réparation complète et des interdictions durables.
Quelles sont les sanctions que le juge peut prononcer au terme de ce procès ?
- L’octroi de dommages et intérêts : C’est la sanction « classique » de la responsabilité civile. Elle vise à réparer intégralement le préjudice que vous avez subi du fait de la concurrence déloyale. Comme nous l’avons vu dans l’article précédent, ce préjudice peut être matériel (perte de chiffre d’affaires, de marge…), mais aussi immatériel (atteinte à l’image de marque, trouble commercial, préjudice moral). L’évaluation de ce préjudice est souvent complexe, et les juges disposent d’un large pouvoir d’appréciation. Il est essentiel de leur fournir tous les éléments justificatifs possibles (analyses comptables, études d’impact, attestations…). N’oubliez pas que les juges peuvent aussi tenir compte, pour fixer le montant, des profits indûment réalisés par l’auteur de la faute, dans une logique dissuasive.
- Les injonctions de faire ou de ne pas faire : Au-delà de l’indemnisation financière, le juge peut ordonner des mesures concrètes pour mettre fin définitivement aux agissements déloyaux et en supprimer les effets. Il peut prononcer une interdiction définitive d’utiliser le nom, le slogan, le procédé publicitaire ou le design litigieux. Il peut aussi ordonner des mesures positives, comme la destruction des produits contrefaisants ou créant la confusion, le retrait de documents publicitaires, la modification d’un site internet… Ces injonctions sont également souvent assorties d’astreintes pour garantir leur exécution. Une limite importante cependant : sauf cas très particuliers liés à la violation d’une obligation contractuelle de non-concurrence, le juge ne peut pas interdire à votre concurrent d’exercer son activité commerciale elle-même ; il ne peut interdire que les moyens jugés déloyaux.
- La publication du jugement : Pour compléter la réparation, notamment en cas d’atteinte à votre image ou de confusion semée sur le marché, le juge peut ordonner la publication (intégrale ou par extraits) de sa décision de condamnation dans des journaux ou sur des sites internet de votre choix, aux frais de votre concurrent condamné. C’est un moyen efficace d’informer la clientèle et les professionnels de la faute commise et de rétablir la vérité.
Quelle juridiction saisir ? La compétence en matière de concurrence déloyale
Savoir où et comment engager son action est une question technique mais cruciale. Une erreur peut entraîner des retards, voire l’échec de votre démarche. Pour cela, il est essentiel de bien distinguer la concurrence déloyale d’autres types de litiges commerciaux.
La compétence d’attribution : quel type de tribunal ?
Le choix du tribunal dépend de la nature des parties et parfois du lien avec d’autres litiges :
- Le Tribunal de commerce : C’est la juridiction naturelle pour les litiges de concurrence déloyale entre commerçants (sociétés commerciales, artisans inscrits au répertoire des métiers…). C’est le cas le plus fréquent.
- Le Tribunal judiciaire : Il est compétent si au moins une des parties n’est pas commerçante (profession libérale, association, particulier…). Il est aussi compétent pour les litiges dits « mixtes » (un commerçant contre un non-commerçant) lorsque c’est le non-commerçant qui est poursuivi. Enfin, certains tribunaux judiciaires ont une compétence exclusive pour les actions en concurrence déloyale qui sont connexes à une action en contrefaçon de propriété intellectuelle ou à certaines pratiques restrictives de concurrence.
- Le Conseil de prud’hommes : Attention, sa compétence est strictement limitée aux litiges nés du contrat de travail. Il sera compétent si vous agissez contre un salarié actuel pour manquement à son obligation de loyauté (par exemple, s’il prépare une activité concurrente pendant ses heures de travail), ou contre un ancien salarié pour violation d’une clause de non-concurrence valable prévue dans son contrat. En revanche, si vous agissez contre un ancien salarié (non lié par une clause) pour des actes de concurrence déloyale après la fin de son contrat, c’est le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire qui sera compétent, et non le Conseil de prud’hommes. La frontière est parfois ténue mais l’erreur de juridiction peut être fatale.
La compétence territoriale : où géographiquement ?
Une fois le type de tribunal identifié, il faut savoir lequel saisir géographiquement. Le Code de procédure civile (article 46) vous offre généralement un choix :
- Le tribunal du domicile du défendeur (le siège social pour une société).
- OU le tribunal du lieu où le fait dommageable a été commis (par exemple, le lieu de diffusion d’une publicité dénigrante).
- OU le tribunal du lieu où le dommage a été subi. C’est souvent cette dernière option qui est utilisée en concurrence déloyale. Le lieu où le dommage est subi s’entend du lieu où votre clientèle a été effectivement affectée par les agissements déloyaux. Si votre activité et votre clientèle sont nationales, ou si les actes déloyaux ont été diffusés largement (par exemple sur internet), vous pourriez avoir le choix entre plusieurs tribunaux. Attention, ce n’est pas forcément le lieu de votre propre siège social, mais bien là où l’impact économique s’est produit.
La prescription : ne pas agir trop tard !
Dernier point de vigilance : le délai pour agir. L’action en responsabilité civile pour concurrence déloyale se prescrit par 5 ans. Ce délai commence à courir non pas forcément à partir du premier acte déloyal, mais à partir du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’exercer votre action. Attention, la jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’un « délit continu » : même si les actes déloyaux se poursuivent dans le temps, le délai de 5 ans commence à courir dès que vous avez eu connaissance des faits initiaux. Il est donc essentiel d’être réactif et de ne pas laisser traîner une situation préjudiciable.
Agir contre la concurrence déloyale demande une analyse précise de la situation, une bonne connaissance des options procédurales et une stratégie adaptée. Que ce soit par la voie rapide du référé pour stopper une hémorragie ou par une action au fond pour obtenir une réparation complète, des solutions existent pour défendre vos droits.
Choisir la bonne procédure et la juridiction compétente est essentiel pour défendre efficacement vos droits. Notre cabinet vous guide à travers ces étapes et vous aide à obtenir les sanctions appropriées. N’hésitez pas à nous consulter.
Sources
- Code civil : Article 1240, Article 1241, Article 2224 (Prescription).
- Code de procédure civile : Article 46 (Compétence territoriale), Article 145 (Mesures d’instruction in futurum), Article 835, Article 873 (Référés).
- Code de commerce : Articles L442-4 (Compétence pour certaines pratiques restrictives), L721-3 (Compétence du Tribunal de commerce).
- Code de l’organisation judiciaire : Article L211-10 (Compétence pour la propriété intellectuelle).
- Code du travail (mention de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes pour les litiges liés au contrat de travail).