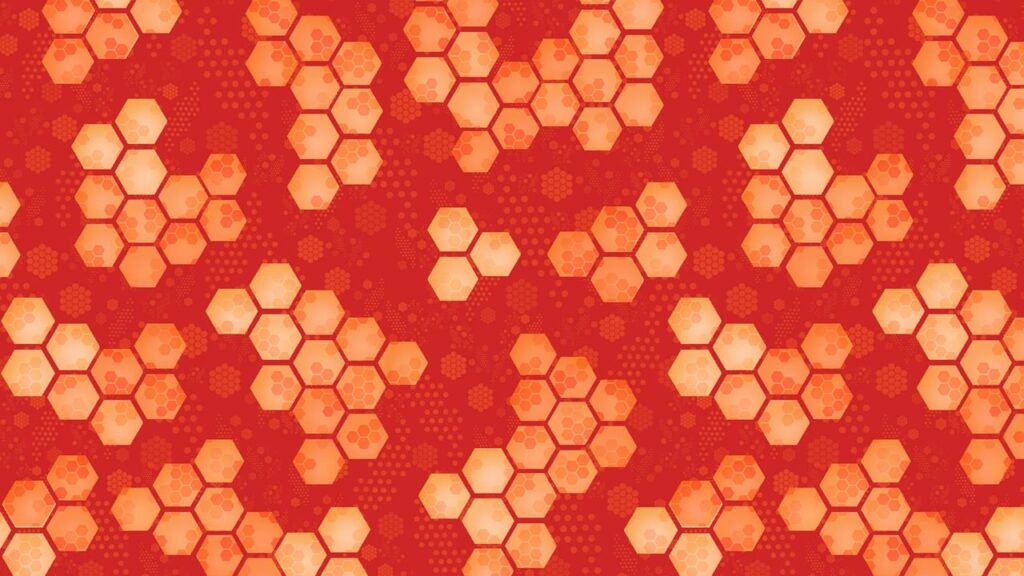L’exécution provisoire est redoutable pour le débiteur condamné. Elle neutralise l’effet suspensif de l’appel ou de l’opposition. Le créancier peut ainsi obtenir paiement alors même que la décision n’est pas définitive.
Mais des garde-fous existent. Le droit offre deux mécanismes protecteurs pour le débiteur : l’arrêt complet de l’exécution provisoire ou son aménagement. Ces dispositifs peuvent limiter les risques d’un paiement prématuré qui s’avérerait injustifié après réformation.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié ces mécanismes. Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau régime cohabite avec l’ancien, applicable aux instances introduites avant cette date.
Les juridictions compétentes pour arrêter l’exécution provisoire
Compétence exclusive du premier président
Dans les deux régimes, le premier président de la cour d’appel détient une compétence exclusive pour arrêter l’exécution provisoire.
L’article 514-3 du Code de procédure civile (nouveau régime) et l’article 524 (ancien régime) consacrent cette compétence. Seul le premier président peut interrompre l’exécution forcée résultant de l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution, malgré son titre, est radicalement incompétent. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 14 septembre 2006 (Civ. 2e, n° 05-21.300, Bull. civ. II, n° 223).
Le premier président statue en référé. Sa décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation depuis le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.
Compétence ratione temporis
Le premier président est compétent de l’acte d’appel jusqu’au dessaisissement de la cour d’appel. Cependant, il perd cette compétence dès qu’un conseiller de la mise en état est désigné.
Pour saisir le premier président, un appel doit exister. Mais peu importe sa recevabilité. La Cour de cassation a jugé que l’exécution provisoire peut être arrêtée tant que « la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable » (Civ. 2e, 18 févr. 2016, n° 14-20.199).
Les moyens d’arrêt dans l’ancien et le nouveau régime
Dans l’ancien régime (instances introduites avant 2020)
L’ancien régime distingue nettement l’exécution provisoire facultative et l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exécution provisoire facultative, l’arrêt est possible dans deux cas :
- Si elle est interdite par la loi
- Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
Pour l’exécution provisoire de droit, l’article 524 alinéa 6 (issu du décret du 20 août 2004) prévoit deux conditions cumulatives :
- Une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du CPC
- Un risque de conséquences manifestement excessives
La Cour de cassation a strictement interprété la violation manifeste de l’article 12. Elle a jugé que « l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste » (Soc. 18 déc. 2007, n° 06-44.548).
Dans le nouveau régime (instances introduites depuis 2020)
Le nouveau régime unifie les conditions d’arrêt. L’article 514-3 et l’article 517-1 imposent désormais deux conditions cumulatives :
- L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
- Un risque de conséquences manifestement excessives
L’appréciation des conséquences manifestement excessives reste économique. Pour les condamnations pécuniaires, ce risque s’apprécie au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier.
Des régimes dérogatoires persistent en matière de presse (article 64 de la loi du 29 juillet 1881) et en droit des entreprises en difficulté (article R. 661-1 du Code de commerce).
L’aménagement : alternative à l’arrêt de l’exécution provisoire
Quand l’arrêt total n’est pas justifié, l’aménagement offre une solution intermédiaire. Il limite les risques pour le débiteur sans priver le créancier de son titre.
Le nouveau régime simplifie les règles d’aménagement en les unifiant pour l’exécution provisoire de droit et facultative. Dans l’ancien régime, des restrictions existaient pour l’aménagement de l’exécution provisoire de droit.
La Cour de cassation a jugé que le pouvoir d’aménagement est laissé à la discrétion du premier président (Civ. 2e, 6 déc. 2007, n° 06-19.134). Cette solution est critiquable car elle néglige la lettre de l’article 524 qui exige normalement des conséquences manifestement excessives.
Les mesures d’aménagement disponibles
La constitution d’une garantie
Le juge peut subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par le créancier. Cette garantie peut être personnelle (cautionnement) ou réelle.
L’article 517 du Code de procédure civile précise que cette garantie doit être « suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations ». Elle protège le débiteur en cas d’infirmation du jugement.
Le juge fixe la nature, l’étendue et les modalités de la garantie. Si une consignation est ordonnée, les fonds sont généralement déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation
L’article 521 du Code de procédure civile permet au débiteur d’éviter l’exécution forcée en consignant le montant de la condamnation. Le débiteur remet « les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Cette mesure n’est pas disponible pour les condamnations au paiement « d’aliments, de rentes indemnitaires ou de provisions ».
La consignation emporte « affectation spéciale et droit de préférence » au sens de l’article 2350 du Code civil.
Une variante existe : la consignation aménagée. Pour un capital alloué en réparation d’un dommage corporel, le juge peut désigner un séquestre qui versera périodiquement à la victime une part déterminée.
La substitution de garantie
L’article 522 du Code de procédure civile permet la substitution d’une garantie primitive à une garantie équivalente. Cette possibilité existe à tout moment.
Contrairement à d’autres mécanismes, aucun fait nouveau n’est requis depuis la garantie initiale. La substitution concerne surtout les garanties fournies par le créancier comme condition de l’exécution provisoire.
Pour la consignation effectuée par le débiteur, la substitution est plus restrictive. La garantie de substitution doit être véritablement équivalente à la consignation, ce qui est rarement admis.
La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 31 mars 1983, a refusé de considérer un cautionnement bancaire comme équivalent à une consignation.
L’expertise d’un avocat est indispensable pour naviguer dans ces mécanismes complexes. Un conseil juridique inapproprié peut faire perdre le bénéfice de ces protections.
Le cabinet reste disponible pour examiner votre situation et identifier la stratégie optimale. Un examen préventif de ces questions, avant même toute condamnation, peut s’avérer déterminant.
Sources
- Code de procédure civile : articles 514 à 526 (ancien régime) et articles 514-1 à 517-4 (nouveau régime)
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
- Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-21.300, Bull. civ. II, n° 223
- Civ. 2e, 18 février 2016, n° 14-20.199
- Soc. 18 décembre 2007, n° 06-44.548, Bull. civ. V, n° 213
- Civ. 2e, 6 décembre 2007, n° 06-19.134, Bull. civ. II, n° 262
- Code civil : article 2350