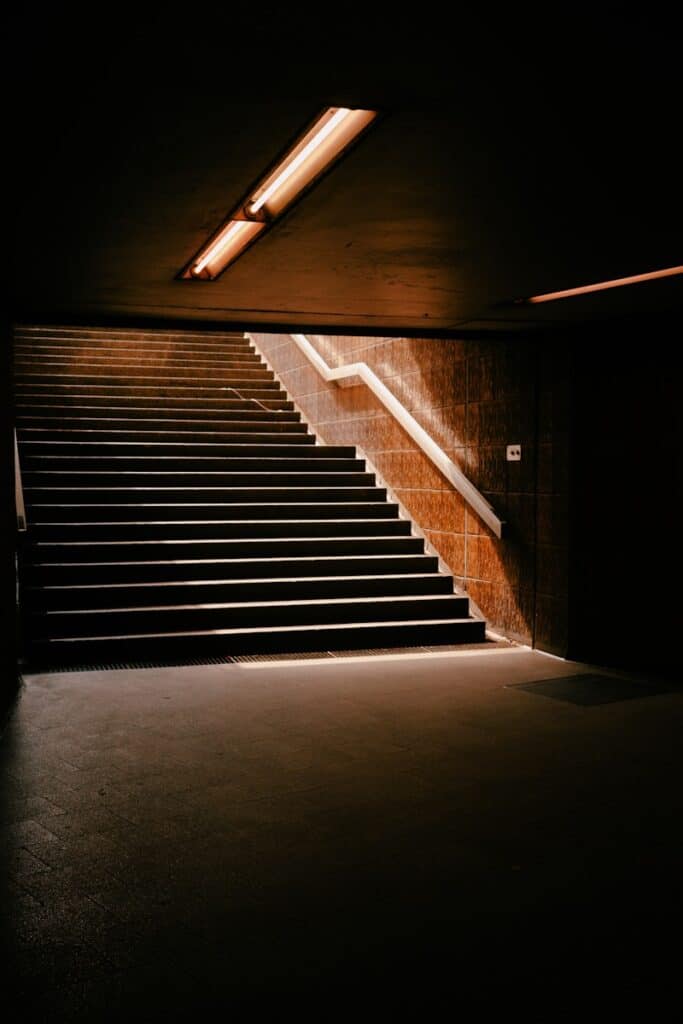Les difficultés économiques d’une entreprise peuvent malheureusement dépasser le simple cadre commercial et financier pour atteindre la sphère pénale. Lorsqu’une gestion hasardeuse, voire frauduleuse, est suspectée d’avoir précipité la chute, le dirigeant s’expose à des sanctions particulièrement lourdes. Au-delà des sanctions civiles et professionnelles qui peuvent l’écarter de la vie des affaires ou impacter son patrimoine, comme la responsabilité pour insuffisance d’actif, le droit pénal prévoit des infractions spécifiques, dont la plus emblématique est la banqueroute. Ce terme, chargé d’histoire et synonyme de faillite frauduleuse, recouvre aujourd’hui des agissements précis qui, s’ils sont prouvés, peuvent mener le dirigeant devant le tribunal correctionnel. Comprendre ce qu’est la banqueroute, quels actes peuvent la constituer et quelles peines sont encourues est essentiel pour tout dirigeant soucieux de naviguer les eaux troubles des difficultés d’entreprise. Cet article détaille ces aspects cruciaux ainsi que les délits dits « connexes » qui peuvent également engager la responsabilité pénale. Pour une vue d’ensemble des différentes sanctions, vous pouvez consulter notre article de synthèse
Qu’est-ce que la banqueroute ?
La banqueroute n’est pas la simple faillite. C’est une infraction pénale qui sanctionne des comportements frauduleux spécifiques commis par certains acteurs économiques dans le cadre strict d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il ne s’agit plus, comme dans le passé, de punir la simple défaillance, mais bien de réprimer la malhonnêteté ou la faute de gestion grave ayant un caractère délictuel. La loi a abandonné les anciennes distinctions entre banqueroute simple et frauduleuse pour retenir une définition unifiée mais couvrant plusieurs types d’agissements. Il est important de noter que la procédure de sauvegarde, destinée à traiter les difficultés avant la cessation des paiements, n’est pas concernée par l’infraction de banqueroute.
Quelles sont les conditions préalables à l’infraction ?
Pour que des poursuites pour banqueroute puissent être engagées, deux conditions fondamentales doivent être réunies.
Les personnes susceptibles d’être sanctionnées (art. L. 654-1)
Le champ d’application de la banqueroute s’est élargi au fil des réformes pour concerner aujourd’hui un éventail assez large d’acteurs économiques. Peuvent être poursuivis :
- Les personnes physiques exerçant une activité indépendante : cela inclut les commerçants, artisans, agriculteurs, ainsi que les professionnels indépendants, y compris ceux exerçant une profession libérale (sauf exceptions liées à des règles disciplinaires spécifiques). La qualité (commerçant, artisan…) doit s’apprécier au moment des faits reprochés. L’absence d’immatriculation n’est pas un obstacle si l’activité est prouvée. Le conjoint du commerçant n’est visé que s’il exerce une activité commerciale séparée. Le nouvel entrepreneur individuel issu de la loi de 2022 est également concerné.
- Les dirigeants de personnes morales de droit privé : cela vise toute personne ayant, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé la personne morale.
- Les dirigeants de droit sont ceux désignés par les statuts ou les organes sociaux (gérant, président, directeur général, administrateur…). Leur responsabilité peut être engagée même s’ils n’étaient pas rémunérés ou s’ils prétendent n’avoir été qu’un prête-nom.
- Les dirigeants de fait sont ceux qui, sans titre officiel, se comportent en véritables maîtres de l’affaire, exerçant une activité de direction en toute indépendance. Leur identification relève de l’appréciation souveraine du juge pénal, qui n’est pas lié par les qualifications retenues par le juge commercial. Un ancien dirigeant peut être qualifié de dirigeant de fait s’il conserve un pouvoir décisionnel important.
- Les représentants permanents de personnes morales dirigeantes : la personne physique désignée pour représenter une société elle-même dirigeante d’une autre société peut être poursuivie.
- Les personnes morales elles-mêmes : depuis la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, une société peut être déclarée coupable de banqueroute si l’infraction a été commise par ses organes ou représentants, pour son compte. En pratique, cela concerne surtout les cas de complicité, par exemple pour un établissement bancaire.
L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (art. L. 654-2)
C’est une condition absolument nécessaire. Sans jugement ouvrant l’une de ces deux procédures collectives, pas de poursuites possibles pour banqueroute. La simple cessation des paiements ne suffit pas. Cette exigence marque la dépendance du droit pénal vis-à-vis de la procédure commerciale. Toutefois, le ministère public ayant la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure collective, il peut provoquer cette condition préalable.
L’ouverture de la procédure implique nécessairement un état de cessation des paiements, défini par le Code de commerce comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le juge pénal doit constater cet état, il conserve une autonomie pour en apprécier la date. Il n’est pas strictement lié par la date fixée par le jugement d’ouverture commercial, même si souvent il s’y réfère. Cette autonomie, bien que critiquée pour l’insécurité juridique qu’elle engendre, permet de sanctionner des faits qui auraient pu échapper à la qualification si seule la date commerciale, parfois fixée provisoirement, était retenue.
Quels sont les faits constitutifs de banqueroute (art. L. 654-2) ?
L’article L. 654-2 du Code de commerce énumère limitativement cinq catégories d’agissements susceptibles de constituer le délit de banqueroute. Il est essentiel de noter que la banqueroute est une infraction intentionnelle. La simple négligence ou l’erreur de gestion ne suffisent pas, il faut une volonté de commettre l’acte répréhensible, même si cette intention se déduit souvent des faits matériels.
1° Achats pour revente à perte / Emploi de moyens ruineux
Ce cas vise les manœuvres désespérées pour obtenir des liquidités afin d’éviter ou de retarder artificiellement le dépôt de bilan. Deux comportements sont visés :
- Avoir fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours : il faut prouver l’intention, dès l’achat, de revendre à perte pour masquer la situation. La revente effective sous le cours doit être constatée, mais pas nécessairement à perte.
- Avoir employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds : le caractère « ruineux » s’apprécie par rapport à la situation de l’entreprise et aux conditions d’obtention des fonds. Les exemples typiques incluent :
- Le recours excessif au crédit bancaire (découverts importants, emprunts coûteux) alors que la situation est déjà compromise.
- L’escompte d’effets de complaisance (traites non causées) ou de fausses factures, générant des frais financiers importants.
- L’émission systématique de chèques sans provision.
Il faut cependant que le moyen soit réellement « ruineux ». Un simple emprunt, même en état de cessation des paiements, ne suffit pas. Un prêt gratuit ne saurait être qualifié de ruineux.
2° Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif
C’est sans doute le cas le plus fréquent et le plus caractéristique de la fraude. Il s’agit de tout acte volontaire visant à soustraire un élément d’actif du débiteur au gage des créanciers.
- Détournement : acte positif de disposition frauduleuse. Exemples :
- Vente d’un bien de l’entreprise à un prix sous-évalué ou à une société fictive.
- Prélèvements personnels excessifs ou injustifiés par le dirigeant.
- Paiements indus (remboursement de compte courant non déclaré, paiement de dettes personnelles avec les fonds sociaux).
- Rémunérations excessives ou fictives.
- Transfert de contrats ou de clientèle vers une autre structure contrôlée par le dirigeant.
- Attention : un paiement préférentiel d’un créancier n’est pas un détournement (il peut relever d’une autre sanction), sauf cas particulier comme une dation en paiement frauduleuse. La jurisprudence distingue aussi ce cas de l’abus de biens sociaux (ABS) : l’intérêt personnel n’est pas requis pour la banqueroute par détournement, et le fait justificatif tiré de l’intérêt du groupe est rejeté en matière de banqueroute.
- Dissimulation : acte visant à cacher l’existence ou la localisation d’un bien. Exemples :
- Cacher des marchandises ou du matériel chez un tiers.
- Ne pas déclarer certains actifs aux organes de la procédure.
- Refuser de communiquer des éléments incorporels essentiels (codes sources de logiciels, par exemple).
Le moment du détournement ou de la dissimulation est débattu. Si l’article L. 654-2 ne le précise pas, la jurisprudence dominante considère que l’infraction est constituée même si les faits sont antérieurs à la cessation des paiements, dès lors qu’ils se poursuivent après ou qu’ils procèdent d’une même intention frauduleuse visant à affecter l’actif disponible.
3° Augmentation frauduleuse du passif
Moins fréquent, ce cas vise à réduire artificiellement l’actif net en gonflant les dettes. Exemples :
- Reconnaissance de dettes fictives.
- Émission de fausses factures.
- Organisation volontaire du non-paiement d’impôts ou de cotisations sociales pour masquer la véritable situation et aggraver le passif. La Cour de cassation a récemment validé cette approche pour le non-paiement délibéré de cotisations URSSAF.
Il ne s’agit pas de sanctionner la simple accumulation de dettes résultant de la poursuite de l’activité. Par exemple, le fait de ne pas licencier les salariés ou de ne pas résilier un bail commercial, même si cela augmente le passif, ne constitue pas en soi une augmentation frauduleuse.
4° et 5° Irrégularités comptables graves
La tenue d’une comptabilité régulière et sincère est une obligation fondamentale. Sa violation grave peut constituer une banqueroute. Deux niveaux de gravité sont distingués :
- 4° Tenue d’une comptabilité fictive, disparition de documents comptables, ou absence totale de comptabilité obligatoire :
- Comptabilité fictive : Existence d’une double comptabilité, ou une comptabilité officielle truffée d’omissions et d’écritures fausses la rendant totalement irréaliste. Ex : enregistrement de créances clients 10 fois supérieures à la réalité.
- Disparition de documents comptables : Destruction volontaire, dissimulation ou refus prolongé de remettre les documents comptables essentiels aux organes de la procédure.
- Absence totale de comptabilité : Défaut complet d’enregistrement chronologique, d’inventaire, etc., lorsque la loi l’impose. Le simple défaut de quelques pièces ne suffit pas.
- 5° Tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales : Introduit en 1994 pour couvrir les cas où une comptabilité existe mais présente des lacunes ou irrégularités flagrantes, sans atteindre le niveau de la fiction ou de l’absence totale. L’adverbe « manifestement » implique que seules les irrégularités graves et évidentes sont visées. L’appréciation se fait in concreto.
Pour ces infractions comptables, peu importe que les faits (absence de tenue, irrégularités) soient antérieurs ou postérieurs à la cessation des paiements.
Quelles sont les sanctions de la banqueroute ?
La banqueroute étant un délit, elle expose ses auteurs et complices à des sanctions pénales (peines principales et complémentaires) prononcées par le tribunal correctionnel.
Peines principales
- Personnes physiques (Art. L. 654-3) : La peine maximale est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le juge fixe le quantum en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur. Une peine d’emprisonnement ferme doit être spécialement motivée et n’intervenir qu’en dernier recours.
- Aggravation (Art. L. 654-4) : Si l’auteur ou le complice est dirigeant d’un prestataire de services d’investissement, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
- Personnes morales (Art. L. 654-7) : L’amende maximale encourue est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit 375 000 € (ou 500 000 € pour les PSI). D’autres peines de l’article 131-39 du Code pénal sont possibles (dissolution, interdiction d’activité, etc.).
Peines complémentaires (personnes physiques – Art. L. 654-5)
Le tribunal peut également prononcer une ou plusieurs peines complémentaires:
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille (droit de vote, éligibilité, tutelle…) pour 5 ans maximum.
- Interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle ou sociale concernée par l’infraction, pour 5 ans maximum. Attention, si une juridiction civile ou commerciale a déjà prononcé une mesure similaire (faillite personnelle, interdiction de gérer), cette interdiction professionnelle ne peut plus être prononcée par le juge pénal pour les mêmes faits suite à une décision du Conseil Constitutionnel (QPC du 29 sept. 2016).
- Exclusion des marchés publics pour 5 ans maximum.
- Interdiction d’émettre des chèques (sauf retrait ou certifiés) pour 5 ans maximum.
- Affichage ou diffusion de la décision de condamnation.
La complicité
Le complice de banqueroute (celui qui aide ou assiste sciemment l’auteur principal) encourt les mêmes peines que l’auteur, et ce, même s’il ne remplit pas personnellement les conditions pour être auteur principal (il n’est ni commerçant, ni dirigeant…). La complicité est fréquemment recherchée, notamment envers les partenaires de l’entreprise comme les banquiers (pour octroi de crédits ruineux en connaissance de cause ), les comptables (pour tenue de comptes irréguliers ) ou les avocats (pour aide à la dissimulation d’actifs ).
Les délits connexes : autres infractions pénales à connaître
Au-delà de la banqueroute, le Code de commerce réprime d’autres comportements pénalement sanctionnables commis en lien avec la procédure collective. Ces « délits connexes » visent à assurer le respect des règles de la procédure.
Délits des articles L. 654-8, L. 654-9, L. 654-10
Ces textes sanctionnent divers agissements :
- Actes de disposition irréguliers (Art. L. 654-8) : Le fait pour le dirigeant (ou débiteur personne physique) d’accomplir un acte de disposition (vente d’un bien…) sans autorisation du juge-commissaire pendant la période d’observation, ou de payer une dette antérieure au jugement d’ouverture. Est également sanctionné le fait de violer les termes du plan (paiement hors échéancier, cession d’un bien déclaré inaliénable par le plan). Le tiers qui passe sciemment l’acte irrégulier avec le débiteur ou reçoit un paiement indu est aussi punissable. La peine est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
- Soustraction, recel, dissimulation d’actif par un tiers (Art. L. 654-9) : Vise celui qui, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recèle ou dissimule des biens de l’entreprise. Sanctionne aussi la déclaration frauduleuse de créances fictives, ou l’exercice d’une activité sous un nom d’emprunt en commettant certains actes frauduleux. Les peines sont celles de la banqueroute.
- Infractions commises par les proches (Art. L. 654-10) : Sanctionne le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux ou alliés du débiteur qui détournent, divertissent ou recèlent des biens de l’actif. Les peines sont celles de l’abus de confiance (actuellement 5 ans et 375 000 €).
- Réintégration des biens (Art. L. 654-11) : Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des biens frauduleusement soustraits.
Délit de malversation (Art. L. 654-12)
Cette infraction grave vise spécifiquement les organes de la procédure collective (administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan…). Elle sanctionne le fait de :
- Porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur (en utilisant des fonds perçus pour soi, en se faisant attribuer des avantages indus).
- Faire un usage de ses pouvoirs contraire aux intérêts des créanciers et du débiteur, dans son propre intérêt.
- Se rendre acquéreur, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utiliser à son profit (cela vise aussi toute personne ayant participé à la procédure, sauf les représentants des salariés). La nullité de l’acquisition est encourue.
Les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Autres délits (Art. L. 654-13, L. 654-14, L. 654-15)
- Paiement préférentiel par un créancier (Art. L. 654-13) : Le créancier qui, après le jugement d’ouverture et en connaissance de la situation, reçoit un paiement irrégulier de la part du débiteur. Peine : 2 ans / 30 000 €.
- Divers faits par le débiteur (Art. L. 654-14) : Soustraire de mauvaise foi une partie de son patrimoine aux poursuites ; ne pas acquitter les dettes mises à sa charge (suite à une condamnation pour insuffisance d’actif par exemple) ; organiser son insolvabilité pour échapper à une condamnation pécuniaire (passerelle avec le délit général d’organisation d’insolvabilité de l’art. 314-7 C. Pén.). Peines : celles de la banqueroute.
- Violation d’une interdiction de gérer (Art. L. 654-15) : Exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation d’une interdiction prononcée (faillite personnelle ou interdiction de gérer). Peine : 2 ans / 375 000 €.
Règles particulières de procédure
La poursuite des infractions pénales liées aux difficultés des entreprises obéit à certaines règles de procédure spécifiques définies aux articles L. 654-16 et suivants du Code de commerce, qui complètent le Code de procédure pénale.
En résumé, la prescription de l’action publique pour les faits de banqueroute commis avant le jugement d’ouverture ne commence à courir qu’à compter de ce jugement. Tant qu’aucune procédure collective n’est ouverte, le délai (actuellement de 6 ans pour les délits) ne court pas. Le ministère public joue un rôle clé, pouvant requérir la communication de tous documents auprès des organes de la procédure. L’action civile en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers peut être exercée par le liquidateur ou l’administrateur, ou par le ministère public. Enfin, les condamnations pour banqueroute ou délits connexes font l’objet d’une publication obligatoire.
La matière pénale des entreprises en difficulté est complexe et les conséquences d’une condamnation peuvent être très lourdes pour un dirigeant. Si vous êtes confronté à une situation de difficultés ou si vous anticipez des risques liés à la gestion passée de votre entreprise, un conseil adapté à votre situation pourrait vous éviter des conséquences pénales graves. Contactez-nous pour obtenir une assistance juridique spécialisée et défendre vos droits face à ces risques.
Sources
- Code de commerce, articles L. 654-1 à L. 654-20 (Banqueroute et autres infractions)
- Code de commerce, articles L. 631-1 (Cessation des paiements)
- Code pénal, articles 121-3 (Intention), 121-6, 121-7 (Complicité), 131-39 (Peines PM), 314-1 (Abus de confiance), 314-7 (Organisation d’insolvabilité)