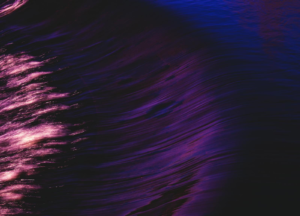Lorsqu’une entreprise est soupçonnée de pratiques anticoncurrentielles, la perspective d’une longue et coûteuse procédure devant l’Autorité de la concurrence, potentiellement suivie de sanctions pécuniaires importantes, peut être préoccupante. Cependant, la confrontation directe n’est pas la seule issue. Le droit de la concurrence français, à l’instar du droit européen, a développé des outils procéduraux alternatifs qui permettent, sous certaines conditions, une résolution négociée des affaires. Ces mécanismes – la clémence, la transaction et les engagements – offrent aux entreprises des opportunités stratégiques pour limiter les risques, réduire les sanctions, voire clore une procédure sans constatation formelle d’infraction. Comprendre leur fonctionnement, leurs conditions d’accès et leurs avantages respectifs est essentiel pour toute entreprise confrontée à une enquête ou une instruction de l’Autorité.
La clémence (Art. L. 464-2 IV C. com.) : dénoncer un cartel pour échapper aux sanctions
La procédure de clémence est un instrument puissant spécifiquement conçu pour lutter contre les ententes secrètes les plus graves, communément appelées « cartels » (accords horizontaux sur les prix, le partage de marchés, les quotas de production, etc.). Son objectif est simple : inciter les entreprises participant à un cartel à le dénoncer à l’Autorité de la concurrence en échange d’une immunité totale ou partielle des sanctions pécuniaires.
- Le principe de la « course à l’Autorité » : La clémence fonctionne sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».
- L’immunité totale (Clémence de type 1) : La première entreprise qui apporte à l’Autorité des preuves déterminantes d’un cartel dont celle-ci n’avait pas connaissance auparavant, ou qui lui permettent de mener des opérations de visite et saisie (« dawn raids »), peut bénéficier d’une exonération totale de l’amende qu’elle aurait autrement encourue. Pour cela, l’entreprise doit remplir des conditions strictes : cesser immédiatement sa participation au cartel (sauf instruction contraire de l’Autorité pour ne pas éventer l’enquête), coopérer pleinement, activement et en continu avec l’Autorité tout au long de la procédure, et ne pas avoir été l’instigatrice du cartel ni avoir contraint d’autres entreprises à y participer.
- La réduction d’amende (Clémence de type 2) : Les entreprises qui ne sont pas les premières à dénoncer le cartel peuvent néanmoins obtenir une réduction significative de leur amende si elles fournissent des éléments de preuve apportant une « valeur ajoutée significative » à l’enquête de l’Autorité, par rapport aux éléments déjà en sa possession. Le taux de réduction dépendra du rang d’arrivée de l’entreprise (la seconde obtient une réduction plus importante que la troisième, etc.) et de l’importance de sa contribution.
- La procédure : Une entreprise souhaitant bénéficier de la clémence doit contacter l’Autorité (souvent via ses avocats) de manière confidentielle. Elle peut d’abord demander un « marqueur » pour réserver sa place dans l’ordre d’arrivée, le temps de rassembler les preuves nécessaires. Elle dépose ensuite une demande formelle de clémence. La procédure, bien que simplifiée récemment par la suppression de l’ »avis de clémence » formel intermédiaire, exige une coopération sans faille jusqu’à la décision finale de l’Autorité.
- Les avantages et limites : Le principal avantage est financier : une immunité totale ou partielle des amendes, qui peuvent atteindre des montants considérables (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial). Il est crucial de noter que la clémence ne protège pas l’entreprise contre les actions en dommages et intérêts que pourraient intenter les victimes du cartel (clients, concurrents lésés). Par ailleurs, la clémence ne s’applique qu’aux ententes horizontales secrètes (Art. L. 420-1 C. com.) et non aux abus de position dominante (Art. L. 420-2 C. com.) ou aux restrictions verticales.
- Protection des personnes physiques : Une avancée importante concerne les individus. L’article L. 420-6-1 du code de commerce prévoit, sous conditions, une immunité de poursuites pénales pour les dirigeants ou salariés qui ont personnellement participé à l’organisation du cartel, s’ils contribuent activement à la demande de clémence de leur entreprise et coopèrent avec l’Autorité. C’est un levier additionnel important pour encourager la dénonciation des cartels.
La transaction (Art. L. 464-2 III C. com.) : reconnaître les faits pour une sanction réduite
La procédure de transaction, qui a succédé à l’ancienne « non-contestation des griefs », offre une autre voie pour une résolution accélérée d’une affaire, mais dans un contexte différent de celui de la clémence.
- Le contexte : Cette procédure peut être proposée par l’Autorité de la concurrence après qu’elle ait notifié ses griefs à une entreprise. Elle ne s’applique donc pas aux cartels secrets non encore découverts, mais plutôt aux cas où l’Autorité a déjà mené son instruction et formalisé ses reproches.
- Le mécanisme : Si l’Autorité estime que l’affaire s’y prête, elle peut proposer une transaction à l’entreprise. Pour en bénéficier, l’entreprise doit s’engager à ne pas contester les griefs qui lui sont reprochés. En contrepartie de cette non-contestation, l’Autorité lui indique une fourchette pour la sanction pécuniaire qu’elle envisage de prononcer, fourchette qui intègre une certaine réduction par rapport à ce que la sanction aurait été dans le cadre de la procédure ordinaire.
- La procédure : L’initiative vient de l’Autorité. L’entreprise dispose d’un délai pour accepter ou refuser la proposition de transaction. Si elle accepte, elle signe un procès-verbal de transaction. L’Autorité rend ensuite une décision finale qui constate l’accord et fixe le montant définitif de la sanction, obligatoirement dans la fourchette annoncée.
- Les avantages : Pour l’entreprise, l’intérêt principal est la réduction de l’amende et une plus grande prévisibilité sur le montant final de celle-ci. La procédure est également plus rapide que la procédure contentieuse classique, qui implique la rédaction d’un rapport détaillé, des observations en réponse et une audience au fond plus longue.
- Les contreparties : L’entreprise renonce à contester les faits et la qualification juridique retenus par l’Autorité dans la notification de griefs. Ce n’est pas une reconnaissance de culpabilité au sens pénal, mais une acceptation des conclusions de l’Autorité aux fins de clore la procédure administrative.
Les engagements (Art. L. 464-2 I C. com.) : proposer des solutions pour éviter une sanction
La procédure d’engagements offre une voie radicalement différente : elle vise à résoudre les préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité par des mesures correctrices proposées par l’entreprise elle-même, permettant ainsi de clore l’affaire sans constatation d’infraction ni sanction pécuniaire.
- Le moment opportun : Les engagements sont généralement proposés par l’entreprise à un stade précoce de la procédure, souvent après que les services d’instruction de l’Autorité ont fait part de leur « évaluation préliminaire » des problèmes de concurrence potentiels, mais avant la notification formelle des griefs.
- Le principe : L’entreprise, pour répondre aux doutes exprimés par l’Autorité, propose de prendre des engagements concrets, de nature à remédier aux problèmes identifiés. Ces engagements peuvent être de nature :
- Comportementale : Modifier des clauses contractuelles jugées problématiques, changer des pratiques commerciales, garantir l’accès à certaines informations ou infrastructures à des concurrents, revoir des politiques tarifaires… C’est le type d’engagement le plus fréquent.
- Structurelle (ou quasi-structurelle) : Céder une partie de ses activités, accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle… Bien que plus rares en pratique anticoncurrentielle (plus courants en contrôle des concentrations), ils peuvent être envisagés.
- La procédure : L’entreprise soumet une proposition d’engagements. L’Autorité évalue si ces propositions sont crédibles, suffisantes et de nature à répondre effectivement aux préoccupations de concurrence. Elle peut mener un « test de marché » : publier les engagements proposés et inviter les tiers intéressés (concurrents, clients, associations…) à faire part de leurs observations. Si, après d’éventuels ajustements, l’Autorité juge les engagements satisfaisants, elle adopte une décision qui les rend obligatoires pour l’entreprise et clôt la procédure.
- Les avantages : L’avantage majeur est l’absence de constatation d’infraction et donc l’absence de sanction pécuniaire. Cela peut aussi préserver la réputation de l’entreprise. La procédure peut être plus rapide et permet à l’entreprise d’avoir une certaine influence sur la nature des remèdes mis en œuvre.
- Les points de vigilance : Les engagements acceptés deviennent juridiquement contraignants. Le non-respect des engagements expose l’entreprise à des sanctions pour inexécution. L’Autorité n’est jamais tenue d’accepter des engagements ; elle conserve un pouvoir d’appréciation et refusera cette voie si elle estime qu’une infraction grave et avérée mérite une sanction (par exemple, pour les cartels les plus dommageables). Les engagements peuvent être révisés si les circonstances du marché évoluent de manière significative.
Quelle procédure choisir : une décision stratégique
Clémence, transaction ou engagements ? Chaque mécanisme répond à des situations et des objectifs différents.
- La clémence est l’outil de choix (et souvent le seul salut) pour une entreprise prise dans un cartel secret qu’elle souhaite dénoncer pour échapper à une amende autrement quasi certaine et potentiellement très élevée.
- La transaction est une option à considérer lorsque les griefs notifiés par l’Autorité semblent difficiles à contester et que l’objectif est de clore rapidement la procédure en obtenant une réduction garantie de l’amende.
- Les engagements sont pertinents lorsque l’entreprise est prête à modifier ses pratiques pour répondre aux préoccupations de l’Autorité et souhaite éviter une condamnation formelle et une amende, souvent dans des cas où la qualification d’infraction n’est pas encore totalement établie ou pour des pratiques moins graves qu’un cartel.
Le choix entre ces procédures, ou la décision de suivre la voie contentieuse classique, est une décision stratégique majeure qui doit être prise après une analyse approfondie des faits, des preuves disponibles, des risques encourus et des objectifs de l’entreprise, idéalement avec l’aide de conseils juridiques expérimentés.
Naviguer dans les méandres des procédures alternatives offertes par l’Autorité de la concurrence demande une expertise spécifique. Si votre entreprise est impliquée dans des pratiques potentiellement anticoncurrentielles, une évaluation rapide de l’opportunité de recourir à la clémence, à la transaction ou aux engagements peut s’avérer déterminante. Notre cabinet est à votre disposition pour vous accompagner dans cette analyse stratégique et vous assister dans vos démarches auprès de l’Autorité.
Sources
- Code de commerce : articles L420-1, L420-2, L420-6-1, L464-2 (paragraphes I, III et IV).
- Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence relatif au programme de clémence français.
- Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence relatif à la procédure de transaction.
- Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence relatif aux engagements en matière de concurrence.
- Jurisprudence pertinente de l’Autorité de la concurrence, de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation.
Entendu, je rédige maintenant l’Article 4 en m’appuyant sur le plan et en respectant vos directives.