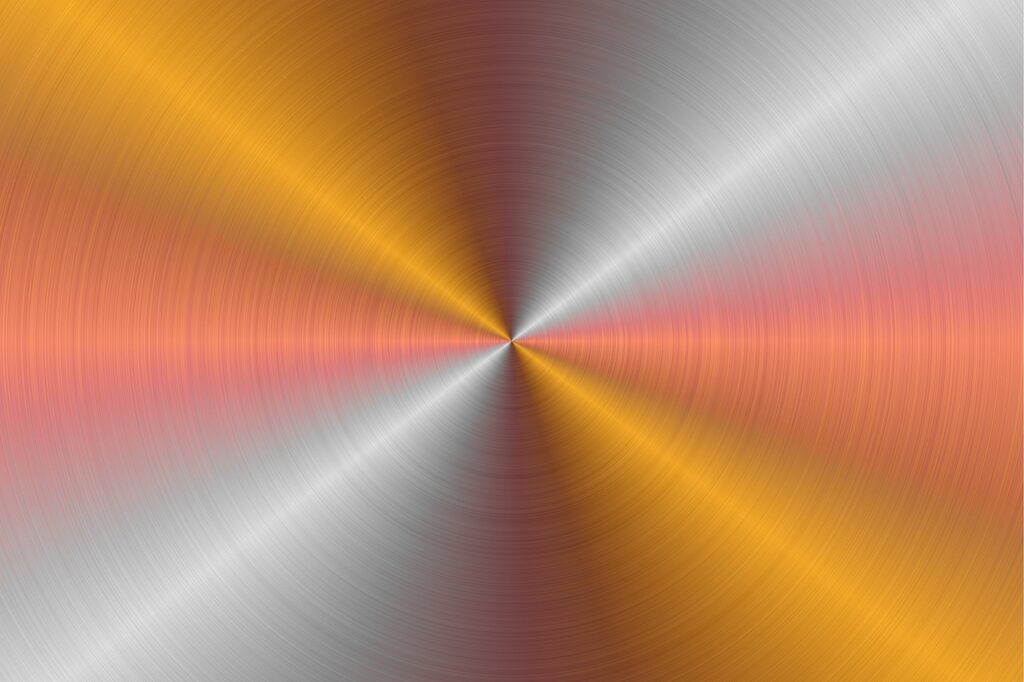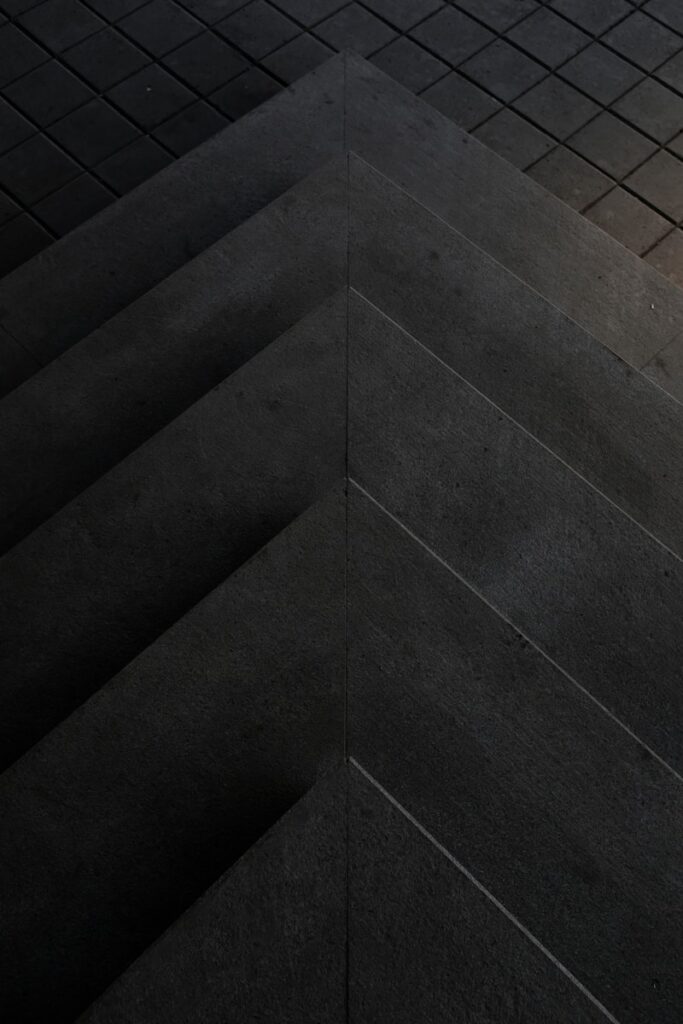« `html
Au-delà de la capture elle-même, la réussite d’une entreprise de pêche dépend fortement de sa capacité à valoriser ses produits et à maintenir des outils de production performants. La commercialisation des produits de la mer, denrées périssables par excellence, est soumise à des exigences strictes de qualité et de normes sanitaires. Parallèlement, la nécessité d’adapter la flotte de pêche aux ressources disponibles et de moderniser les entreprises implique des investissements souvent conséquents, pour lesquels des aides existent mais dans un cadre réglementaire précis.
Comment s’assurer que ses produits peuvent être vendus sur le marché ? Quels mécanismes existent pour soutenir les prix en cas de mévente ? Quelles sont les règles pour importer ou exporter ? Comment l’Europe et la France encadrent-elles l’évolution de la flotte de pêche et quels soutiens financiers sont possibles ? Cet article aborde ces aspects essentiels de l’environnement économique et réglementaire de la pêche maritime.
Mettre sur le marché : exigences de qualité et d’information
Pour pouvoir circuler librement et être vendus, notamment au sein du marché unique européen, les produits de la pêche doivent respecter un ensemble de normes visant à garantir leur qualité, leur fraîcheur et la sécurité sanitaire pour le consommateur.
- Les normes communes de commercialisation de l’UE : L’Union Européenne a défini des standards communs pour un grand nombre de produits de la pêche (poissons, crustacés, mollusques, qu’ils soient frais, réfrigérés ou transformés). Ces normes portent principalement sur des catégories de fraîcheur (évaluée selon des critères organoleptiques précis) et de calibrage (classement par taille ou poids). L’objectif est d’harmoniser la qualité sur le marché et de faciliter les transactions commerciales. Les produits qui ne sont pas conformes à ces normes ne peuvent théoriquement pas être proposés à la vente, vendus ou commercialisés. Le contrôle du respect de ces normes incombe à chaque État membre, qui doit organiser des inspections à tous les stades de la commercialisation, y compris pendant le transport.
- Les normes sanitaires : un impératif absolu : La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure. Face à la diversité des réglementations nationales passées, l’Union Européenne a mis en place, notamment avec le « Paquet Hygiène » entré en vigueur en 2006 (remplaçant les directives spécifiques de 1991), un cadre harmonisé applicable à toutes les denrées alimentaires, y compris les produits de la pêche. Ces règlements fixent des exigences précises en matière d’hygiène tout au long de la chaîne :
- À bord des navires : conditions de manipulation, de lavage, de réfrigération ou de congélation des captures, propreté des équipements et des locaux. Des exigences renforcées s’appliquent aux navires-usines qui transforment les produits à bord.
- Dans les établissements à terre : criées, ateliers de mareyage, usines de transformation doivent respecter des normes strictes concernant la conception et l’entretien des locaux, la gestion de l’eau, la lutte contre les nuisibles, la formation du personnel, la traçabilité et la mise en place de procédures basées sur les principes HACCP (Analyse des dangers – points critiques pour leur maîtrise).
- Dans les lieux de vente en gros.
Tout établissement manipulant des produits de la pêche (y compris les mareyeurs, comme vu dans l’article 2) doit obtenir un agrément sanitaire délivré par les autorités compétentes (en France, souvent les services vétérinaires de la Direction Départementale de la Protection des Populations – DDPP). Cet agrément atteste de la conformité des installations et des pratiques aux exigences réglementaires. Des inspections régulières sont menées par les services officiels pour vérifier le maintien de cette conformité.
Le respect de ces normes, tant commerciales que sanitaires, est une condition sine qua non pour accéder aux marchés et garantir la confiance des consommateurs.
Le régime d’intervention : stabiliser les cours grâce aux OP
Le marché des produits de la pêche est sujet à des fluctuations de prix importantes, liées à la saisonnalité des captures, à la variabilité de l’offre et de la demande. Pour éviter des effondrements de cours préjudiciables aux revenus des pêcheurs, l’Organisation Commune des Marchés (OCM) européenne a mis en place des mécanismes d’intervention, dont les Organisations de Producteurs (OP) sont les principaux opérateurs.
- Le système des prix de retrait : L’idée est de fixer un prix plancher en dessous duquel les produits ne sont pas vendus sur le marché primaire (criée) mais retirés par l’OP. Il existe plusieurs types de prix de retrait :
- Prix de retrait communautaires (ou de l’Union) : Fixés annuellement par l’UE pour une liste d’espèces définies (historiquement : plie, églefin, hareng, sardine, lieu noir…). Ils sont calculés sur la base d’un « prix d’orientation », lui-même dérivé des prix moyens observés les années précédentes. Lorsqu’un lot n’atteint pas ce prix (avec une petite marge de tolérance), l’OP le retire et verse une compensation financière à son adhérent. Cette compensation est financée en partie par l’UE, mais de manière dégressive : plus une OP retire de grandes quantités (en pourcentage de ses ventes annuelles), plus le taux de l’aide européenne diminue, voire devient nul au-delà d’un certain seuil. Le but est d’inciter les OP à ne pas recourir excessivement aux retraits.
- Prix de retrait autonomes : Pour une autre liste d’espèces (historiquement : limande sole, lieu jaune, thon rouge, congre, raie…), les OP peuvent fixer elles-mêmes un prix de retrait. Ce prix ne doit cependant pas dépasser un certain pourcentage (ex: 80%) du prix moyen constaté les années précédentes. Si un produit est retiré à ce prix, l’OP verse une compensation à l’adhérent et peut bénéficier d’une aide publique forfaitaire européenne, mais limitée à un certain volume de retraits annuels (ex: 10% des quantités mises en vente).
- Prix de retrait librement fixés : Enfin, une OP peut décider de fixer ses propres prix de retrait pour n’importe quelle espèce, de manière totalement indépendante. Dans ce cas, l’indemnité versée au producteur est entièrement financée par l’OP elle-même, via un fonds d’intervention alimenté par les cotisations de ses membres. Aucune aide publique n’est alors possible, conformément aux règles de concurrence.
- La gestion des produits retirés : Que deviennent les produits retirés du marché ? Pour ne pas perturber l’écoulement normal des produits vendus, les produits retirés ne peuvent être remis sur le marché pour la consommation humaine directe sous leur forme initiale. L’OP doit leur trouver une destination finale : don à des œuvres caritatives (sous conditions strictes), utilisation pour l’alimentation animale (fabrication de farines), ou, cas le plus fréquent par le passé, dénaturation pour les rendre impropres à la consommation.
- Les aides au stockage : Pour éviter le gaspillage lié aux retraits, l’OCM prévoit également des aides financières pour encourager le stockage temporaire de certains produits retirés du marché (ex: baudroies, soles, crabes, langoustines…). L’idée est de permettre à l’OP de transformer (congélation, salage…) et de stocker ces produits en attendant une période plus favorable pour les remettre sur le marché (par exemple, pour l’industrie de transformation). L’aide européenne couvre alors une partie des frais techniques et financiers liés à ces opérations de stabilisation et de stockage (report ou stockage privé).
Ces mécanismes d’intervention visent à offrir un filet de sécurité aux producteurs, mais leur utilisation est encadrée pour ne pas encourager la surproduction et pour rester compatible avec les règles du marché unique et de la concurrence.
Les échanges avec les pays tiers
La France et l’Union Européenne sont fortement dépendantes des importations pour satisfaire leur demande en produits de la mer. Les échanges avec les pays extérieurs à l’UE sont régis par des règles spécifiques, en plus des accords de pêche bilatéraux ou multilatéraux.
- Le Tarif Extérieur Commun (TEC) : Les importations de produits de la pêche depuis des pays tiers sont soumises au paiement de droits de douane définis dans le TEC de l’UE.
- Suspensions tarifaires : Pour certains produits dont l’UE est déficitaire, ces droits de douane peuvent être temporairement suspendus, totalement ou partiellement, afin de faciliter l’approvisionnement du marché européen à des coûts raisonnables.
- Prix de référence : Afin de protéger le marché européen contre des importations à des prix anormalement bas (dumping), l’UE fixe des prix de référence pour certains produits sensibles. Si la valeur en douane d’un produit importé est inférieure à ce prix de référence, des droits de douane additionnels peuvent être appliqués, ou le bénéfice d’une réduction tarifaire peut être retiré.
- Mesures de sauvegarde : En cas de perturbations graves du marché (ou de menace de perturbation) dues à une augmentation massive des importations ou à des pratiques déloyales, l’UE peut prendre des mesures d’urgence, dites de sauvegarde. Ces mesures, qui doivent rester temporaires et exceptionnelles, peuvent aller jusqu’à la fermeture des frontières pour les produits concernés.
La politique des structures : adapter la flotte et soutenir les investissements
La politique structurelle de la pêche vise principalement à atteindre un équilibre durable entre la capacité de pêche des flottes et les ressources halieutiques disponibles, tout en soutenant la modernisation et la compétitivité des entreprises.
- Adapter la capacité de pêche : Consciente des risques de surexploitation liés à une capacité de pêche excessive, l’UE a mis en place des outils pour maîtriser, voire réduire, la taille globale de sa flotte. Après les Programmes d’Orientation Pluriannuels (POP) des années 1980-90, le système repose désormais sur la fixation, pour chaque État membre, de niveaux de référence pour la capacité totale de sa flotte (exprimée en puissance motrice – kW – et en tonnage – GT). Les États membres ne peuvent dépasser ces plafonds. Toute nouvelle construction ou augmentation de capacité doit être compensée par le retrait d’une capacité équivalente ou supérieure.
- L’outil national : le Permis de Mise en Exploitation (PME) : Pour gérer sa capacité de flotte dans le respect des plafonds européens, la France a institué le Permis de Mise en Exploitation (PME). Ce permis est une autorisation administrative préalable indispensable pour :
- Construire un nouveau navire de pêche.
- Importer un navire destiné à la pêche.
- Modifier un navire existant si cela entraîne une augmentation de sa capacité de capture (augmentation de puissance ou de tonnage).
- Réarmer un navire à la pêche après une période d’inactivité prolongée (plus de 6 mois).
Le PME est délivré par l’autorité administrative (ministre ou préfet selon la taille du navire). Son attribution n’est pas automatique et doit tenir compte des objectifs de gestion de la flotte et de critères tels que la priorité aux nouvelles installations, la pérennisation des entreprises existantes, l’amélioration de la sécurité ou des conditions de travail. Bien qu’attaché au navire, le PME n’est théoriquement pas cessible indépendamment de celui-ci, mais dans la pratique, sa valeur est intégrée au prix de vente du navire, représentant un « droit d’entrée » dans la pêcherie. Certaines activités (goémoniers, sabliers…) ou situations (remplacement d’un navire accidenté, réarmement après formation…) peuvent bénéficier d’exemptions ou de PME dits « de droit », dans les limites des capacités disponibles.
- Les aides structurelles : un financement principalement européen : Le financement de la modernisation de la flotte, de l’amélioration des infrastructures portuaires, de la transformation et de la commercialisation, ou encore des mesures d’accompagnement social (aide à la préretraite, à la reconversion) repose en grande partie sur les fonds européens dédiés à la pêche. Après l’Instrument Financier d’Orientation de la Pêche (IFOP) et le Fonds Européen pour la Pêche (FEP), c’est aujourd’hui le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) qui constitue le principal outil financier pour la période actuelle (son successeur, le FEAMPA, est prévu pour la période post-2020). Ces fonds cofinancent, avec les États membres et les porteurs de projets, des actions visant à atteindre les objectifs de la PCP : adaptation de la flotte (y compris des aides à la sortie définitive), modernisation des navires pour améliorer la sécurité, l’efficacité énergétique ou la sélectivité (sans augmenter la capacité de pêche globale), investissements dans les ports, l’aquaculture, la transformation et la commercialisation, développement local… Les aides nationales directes au secteur sont, quant à elles, très strictement encadrées par les règles européennes sur les aides d’État pour ne pas fausser la concurrence.
Maîtriser les règles complexes de la commercialisation, comprendre les mécanismes d’intervention et connaître les dispositifs d’aide aux investissements sont des éléments déterminants pour la rentabilité et le développement de votre entreprise de pêche. Que vous envisagiez de moderniser votre navire, d’investir dans un atelier de transformation ou que vous rencontriez des difficultés sur le marché, une analyse personnalisée de votre situation et des opportunités de financement peut s’avérer précieuse. Contactez notre cabinet pour en discuter.
Sources
- Règlement (UE) n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (OCM).
- Règlements UE « Paquet Hygiène » (notamment 852/2004, 853/2004, 854/2004) relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires.
- Règlement (UE) n° 508/2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (et ses successeurs).
- Règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP – gestion capacité flotte).
- Code rural et de la pêche maritime (agrément sanitaire, PME, gestion nationale des aides…).
- Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
- Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche (vérifier codification/validité actuelle).
- Code général des impôts et Code des douanes (pour les aspects fiscaux et douaniers des échanges).
« `