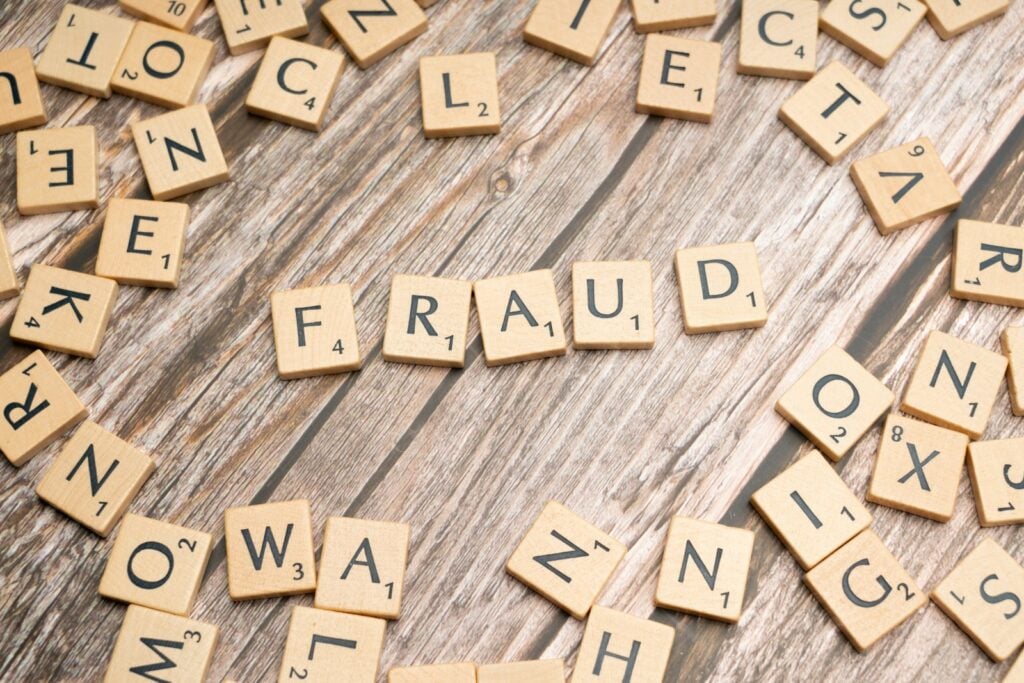L’artisanat représente un pilier essentiel de l’économie française, un secteur dynamique et riche d’une incroyable diversité de métiers. Pourtant, derrière l’image familière du savoir-faire manuel, le statut juridique de l’artisan demeure parfois complexe à cerner. Pour celui qui exerce une activité, comme pour ses clients ou partenaires, il est fondamental de bien comprendre ce que recouvre cette qualification. S’agit-il d’un artiste ? D’un commerçant ? Ou d’une catégorie à part entière ?
Cet article vise à éclaircir la définition légale de l’artisan en France. Nous explorerons d’abord les contours historiques et économiques de cette notion, avant de détailler les critères retenus par la jurisprudence (la qualification civile) puis par l’administration (la qualification administrative, liée notamment à l’immatriculation). Enfin, nous aborderons la portée et les conséquences pratiques de ces différentes qualifications.
L’artisan : une notion aux contours historiques et économiques
L’étymologie même du mot « artisan » révèle une certaine ambivalence. Issu du latin ars, qui désigne le talent, l’habileté, le savoir-faire, il rapproche l’artisan de l’artiste. La frontière entre les deux a longtemps été floue. Si l’on pense intuitivement que l’artiste ne recherche que le beau tandis que l’artisan y mêle une dimension pratique et utile, l’histoire montre que de nombreux artisans revendiquent une fibre artistique (pensons à Vatel ou Boulle) et que des artistes se comparent volontiers à des artisans, comme La Bruyère affirmant : « C’est un métier que de faire un livre comme de faire une pendule ». Longtemps synonymes, les termes « art » et « artisanat » ne se distinguent clairement qu’assez tardivement.
La distinction avec le commerçant n’est pas plus évidente au premier abord. D’un point de vue sociologique, on observe même une tendance à la « commercialisation » de l’artisanat, mais aussi, inversement, une utilisation marketing du label « artisanal » comme argument de vente, gage de qualité et d’authenticité. Juridiquement, le Code de commerce de 1807, en listant les actes de commerce, a créé des zones grises : les « entreprises de manufacture » ou l’achat de biens pour les revendre « après les avoir travaillés » ne font-ils pas penser à l’artisanat ? Malgré ces ambiguïtés, une différence fondamentale demeure : l’artisan se caractérise par sa production, par la création issue de son travail personnel, là où le commerçant se définit avant tout par l’achat pour la revente, la spéculation. L’artisan crée plus qu’il ne vend.
Économiquement, l’artisanat est loin d’être une notion désuète. Surnommé « la première entreprise de France », le secteur comptait en 2013 près de 1,1 million d’entreprises, générant une part significative de la valeur ajoutée nationale. Sa diversité est remarquable : la nomenclature officielle (NAFA) recense près de 500 métiers, des plus traditionnels (maçonnerie, boucherie) aux plus modernes (microélectronique, génie climatique), répartis classiquement en quatre grands secteurs : alimentation, bâtiment, production/services, et métiers d’art. C’est un secteur dynamique, bien que majoritairement composé de très petites structures (près de 60% sans salarié).
La qualification civile de l’artisan : les critères de la jurisprudence
Historiquement, en l’absence de définition légale claire de l’artisan dans le Code civil ou le Code de commerce post-Révolution (qui a aboli les corporations mais défini le commerçant), ce sont les tribunaux qui ont dû préciser les contours de la qualification artisanale. Cette qualification « civile », distincte de celle liée à l’immatriculation administrative, conserve son importance car, en principe, l’artisan relève du droit civil, ce qui influence notamment la compétence juridictionnelle (même si une évolution récente tend à rapprocher le contentieux artisanal des tribunaux de commerce) et le régime de la preuve.
La jurisprudence a évolué. Initialement, la Cour de cassation adoptait une vision très restrictive : toute activité impliquant l’achat de matières premières pour les revendre, même transformées, était considérée comme commerciale (par exemple, un serrurier achetant du fer était vu comme commerçant dès 1812). Cette approche rigide ignorait la réalité du travail artisanal.
Progressivement, sous l’influence de la doctrine prônant une approche plus pragmatique, la jurisprudence s’est assouplie. Un arrêt clé de 1909 concernant un cordonnier a marqué un tournant. Le cordonnier travaillait seul, sur commande, sans magasin, et ses achats de cuir étaient modestes, effectués au fur et à mesure. La Cour a jugé que son gain provenait essentiellement de son travail manuel et non d’une spéculation sur l’achat et la revente, le qualifiant ainsi d’artisan et non de commerçant. De cette évolution découlent les deux critères principaux de la qualification civile, toujours pertinents aujourd’hui : l’existence d’un travail personnel prédominant et l’absence de spéculation.
Critère 1 : Le travail personnel prédominant
L’image de l’artisan est fortement associée au travail manuel. Si la mécanisation a étendu son emprise, ce critère reste central. L’artisan doit participer personnellement et de manière significative à la production ou à la prestation de service. Son principal outil de travail, c’est lui-même. La jurisprudence apprécie cette participation au cas par cas. Par exemple, le dirigeant d’une entreprise de bobinage électrique utilisant principalement des machines automatiques et ne participant pas personnellement aux travaux manuels de finition (qui ne représentaient que 30% de l’activité) n’a pas été considéré comme artisan. De même, un fabricant de ceintures médicales qui prenait les mesures mais ne participait pas à la fabrication (couture, coupe) effectuée par des ouvrières n’a pas été qualifié d’artisan. La prépondérance du travail personnel, souvent manuel, demeure donc essentielle, même si elle est appréciée concrètement.
Critère 2 : L’absence de spéculation
L’artisan est un professionnel qui vise à vivre de son activité ; son but est lucratif. Cependant, il ne doit pas « spéculer », c’est-à-dire chercher son profit principal en tirant parti de facteurs extérieurs comme la force de travail d’autrui ou les fluctuations du marché des matières premières. Sa richesse doit provenir avant tout de son propre travail.
- Spéculation sur la main-d’œuvre : L’artisan peut employer des salariés, mais ceux-ci doivent rester des auxiliaires. Leurs revenus ne doivent pas constituer la source principale de profit de l’entreprise. Si l’artisan se contente d’organiser et de superviser le travail d’un grand nombre de salariés, il bascule du côté commercial. La jurisprudence examine la proportionnalité : employer quelques salariés est compatible avec le statut d’artisan, mais diriger une structure où le travail est majoritairement effectué par une main-d’œuvre salariée nombreuse, sur laquelle l’entrepreneur réalise une marge importante, caractérise une spéculation commerciale. Le nombre exact de salariés n’est pas un critère absolu en soi dans cette qualification civile (contrairement à la qualification administrative), c’est la prépondérance du gain tiré du travail d’autrui par rapport au travail personnel qui est déterminante.
- Spéculation sur les matières premières : L’artisan achète les matières nécessaires à son travail de production ou de transformation. Il ne doit pas réaliser son profit principal sur l’achat et la revente de ces matières. Ne pas constituer de stocks importants est un indice en faveur de la qualification artisanale. De plus, la « théorie de l’accessoire » s’applique : un cordonnier vendant quelques lacets ou du cirage ne devient pas commerçant pour autant, ces ventes restant accessoires à son activité principale de réparation et de fabrication. L’achat de matières premières, acte de commerce par nature, perd ce caractère s’il reste subordonné au travail artisanal et n’excède pas les besoins de cette activité.
La qualification administrative : l’immatriculation et ses conditions
Parallèlement à la définition civile issue de la jurisprudence, une définition « administrative » de l’artisan existe, principalement déterminée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et ses décrets d’application (notamment le décret n° 98-247 du 2 avril 1998). Cette définition conditionne l’obligation d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM). Elle repose sur plusieurs critères cumulatifs.
Critère 1 : Exercer une activité listée
Pour être tenu de s’immatriculer au RM, il faut exercer une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret. Cette liste, annexée au décret de 1998, est très vaste et couvre les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services. Fait notable, cette liste inclut explicitement certaines activités qui pourraient sembler commerciales, comme le « commerce de détail de viandes » ou de « poissons » en magasin spécialisé. Cela souligne que la nature de l’activité seule ne suffit pas toujours à distinguer l’artisan du commerçant pour l’administration, rendant les autres critères d’autant plus importants.
Critère 2 : Respecter la taille de l’entreprise
Initialement, la loi de 1996 limitait l’obligation (et la possibilité) d’immatriculation aux entreprises n’employant pas plus de dix salariés. Ce seuil, calculé hors apprentis et contrats aidés, a été un marqueur fort de l’entreprise artisanale « officielle ». Cependant, conscient que le développement pouvait conduire à dépasser ce seuil sans pour autant perdre la nature artisanale de l’activité, le législateur a assoupli cette règle. La loi Pinel (2014) puis la loi Sapin II (2016) ont introduit un « droit de suite » : une entreprise peut demeurer immatriculée au RM même si son effectif dépasse 10 salariés, tant qu’il reste inférieur à cinquante salariés. Il est même possible de s’immatriculer directement avec plus de 10 salariés (mais moins de 50) en cas de reprise d’un fonds déjà immatriculé. En cas de dépassement du seuil de 50 salariés, l’entreprise peut rester immatriculée pendant l’année du dépassement et les deux années suivantes.
Critère 3 : Agir de manière professionnelle et indépendante
L’activité doit être exercée à titre professionnel, c’est-à-dire de manière habituelle et dans un but lucratif, que ce soit à titre principal ou secondaire. Depuis la loi Pinel, même les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre complémentaire doivent s’immatriculer au RM. L’activité doit aussi être indépendante. Cela exclut le salariat. L’immatriculation au RM crée d’ailleurs une présomption simple de non-salariat vis-à-vis du donneur d’ordre (article L. 8221-6 du Code du travail). Attention toutefois au risque de requalification en contrat de travail si un lien de subordination juridique (pouvoir de direction, de contrôle et de sanction) est démontré, situation fréquente dans certains secteurs comme le bâtiment où la qualification d’artisan est parfois utilisée pour contourner le droit du travail (« faux artisans »). Il faut aussi distinguer l’artisan indépendant du travailleur à domicile (qui travaille pour le compte d’un ou plusieurs établissements, même sans lien de subordination apparent).
Critère 4 : Justifier d’une qualification professionnelle (activités réglementées)
Pour un certain nombre d’activités jugées plus sensibles (listées à l’article 16 de la loi de 1996), l’exercice n’est possible que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent. Cette liste inclut notamment :
- L’entretien et la réparation de véhicules.
- La construction, l’entretien et la réparation de bâtiments.
- Les installations électriques, de gaz, de chauffage, de plomberie.
- Le ramonage.
- Les soins esthétiques (non médicaux).
- La réalisation de prothèses dentaires.
- La préparation de produits frais (boulangerie, boucherie, poissonnerie…).
- L’activité de maréchal-ferrant.
- La coiffure (ajoutée par la loi Sapin II).
Pour ces métiers, il faut justifier, lors de l’immatriculation, d’un diplôme spécifique (CAP, BEP, titre équivalent ou supérieur) ou d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le métier. Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) des CMA sont chargés de vérifier cette qualification. Des débats existent sur l’application de cette exigence à de nouvelles activités (comme le stylisme ongulaire, assimilé ou non aux soins esthétiques). Le système a pu conduire à des situations étonnantes où une qualification dans un métier permettait d’exercer un métier connexe de la même catégorie sans qualification spécifique (ex: plombier devenant chauffagiste), mais la loi tend vers une appréciation plus stricte par métier.
Portée et conséquences des qualifications
Il est essentiel de comprendre que la qualification civile (issue de la jurisprudence) et la qualification administrative (liée à l’immatriculation au RM) sont indépendantes, même si elles se recoupent souvent.
- La qualification civile détermine traditionnellement le régime juridique applicable (droit civil vs droit commercial). Son principal intérêt résidait dans la compétence juridictionnelle (tribunaux civils pour l’artisan). Cependant, la loi « Justice 21 » de 2016 a prévu le transfert progressif (au plus tard le 1er janvier 2022) des litiges entre artisans aux tribunaux de commerce, rapprochant ainsi le traitement processuel de l’artisan de celui du commerçant. Elle conserve une influence sur le régime de la preuve (libre en matière commerciale, plus réglementée en matière civile). Un juge saisi d’un litige n’est pas lié par l’immatriculation ou non au RM pour déterminer si une activité est civile ou commerciale sur le fond.
- La qualification administrative, conditionnée par les critères vus précédemment, déclenche l’obligation (ou la possibilité) d’immatriculation au Répertoire des Métiers. Cette immatriculation est cruciale car elle ouvre l’accès à certains droits spécifiques (comme le bénéfice du statut des baux commerciaux pour le local d’exploitation, ou la possibilité de nantir le fonds artisanal) et conditionne le droit d’utiliser les titres protégés comme « artisan » ou « maître artisan ». Ne pas s’immatriculer alors qu’on y est tenu expose à des sanctions pénales et au risque d’être poursuivi pour travail dissimulé.
On peut donc être considéré comme artisan au sens civil sans remplir les critères pour s’immatriculer au RM (par exemple, un artisan travaillant seul mais dont l’activité n’est pas dans la liste officielle). Inversement, une personne immatriculée au RM (remplissant les critères administratifs) pourrait, dans certains cas limites, être requalifiée de commerçant par un juge si son activité révèle une spéculation prédominante et une faible implication personnelle dans le travail.
Au-delà de la définition légale, l’exercice quotidien de l’artisanat implique également des aspects pratiques liés aux qualifications professionnelles et à la gestion des statuts de vos proches collaborateurs.
Déterminer précisément votre statut d’artisan a des conséquences juridiques importantes, que ce soit pour vos obligations, vos droits ou vos relations avec les tiers, notamment en ce qui concerne la nature de votre fonds artisanal. Notre cabinet peut vous aider à clarifier votre situation au regard des critères civils et administratifs et à sécuriser votre activité.
Sources
- Code de commerce (Articles L.110-1, L.110-2, L.121-1, etc.)
- Code civil (Articles 1240, 1242 al.6, etc.)
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
- Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
- Code de l’artisanat (nouvelle codification depuis 2023)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (art. 95)
- Code du travail (Art. L.8221-6)