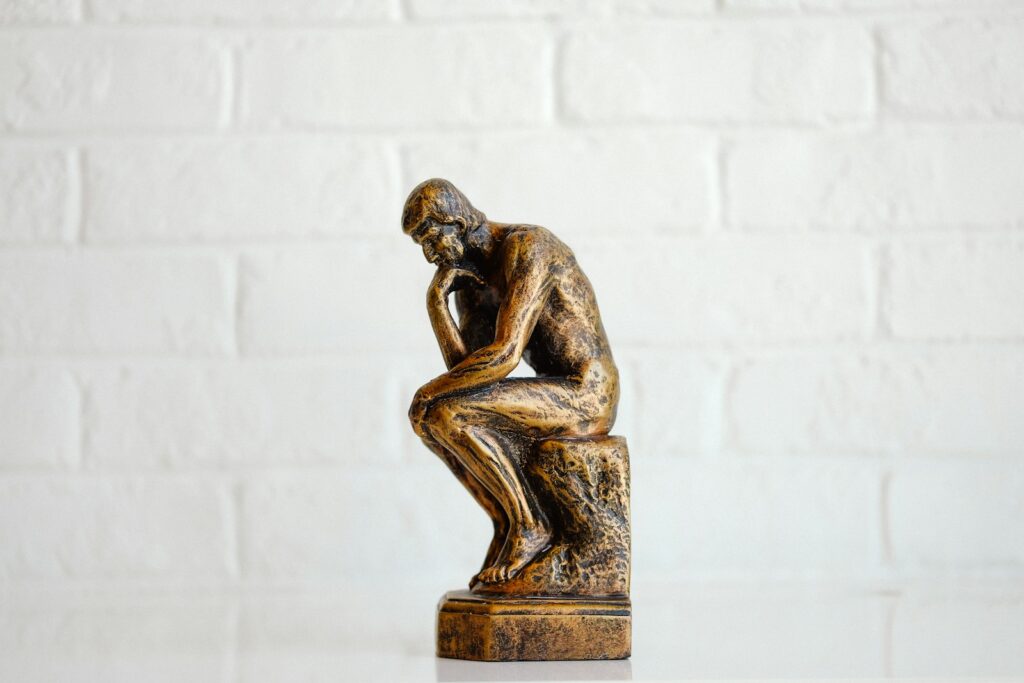Signer une convention d’arbitrage, que ce soit une clause discrète dans un contrat volumineux ou un accord dédié après la naissance d’un conflit, est loin d’être un acte anodin. Cet engagement modifie profondément le paysage juridique pour les parties et peut même avoir des répercussions sur des acteurs qui n’étaient pas initialement autour de la table de négociation. Quelles sont donc les conséquences pratiques de ce choix pour un règlement privé des différends internationaux ? Comment la convention d’arbitrage interagit-elle avec les tribunaux étatiques ? Peut-elle s’étendre à des tiers, et qu’en est-il lorsque l’État lui-même est partie au contrat ? Cet article décortique les effets majeurs de la convention d’arbitrage international.
L’effet principal : écarter les tribunaux étatiques
Le premier effet, et sans doute le plus fondamental, de la convention d’arbitrage est d’obliger les parties signataires à soumettre leur litige à un tribunal arbitral, et corrélativement, à renoncer à saisir les juridictions de l’État. C’est le cœur même de l’engagement arbitral : choisir une justice privée plutôt que publique.
Le droit français tire les conséquences logiques de cet engagement. L’article 1448 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit se déclarer incompétente si l’une des parties le lui demande. Le juge n’a pas, en principe, à examiner la validité ou l’applicabilité de la convention d’arbitrage ; il doit simplement constater son existence et renvoyer les parties à l’arbitrage.
Il existe toutefois une exception importante : le juge étatique peut refuser de se déclarer incompétent si la convention d’arbitrage invoquée est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le terme « manifestement » est essentiel ici. Il signifie que la nullité ou l’inapplicabilité doit sauter aux yeux, être évidente sans nécessiter une analyse approfondie des faits ou du droit. Si la question est simplement douteuse ou nécessite un examen détaillé, le juge doit renvoyer l’affaire aux arbitres. Cette approche restrictive vise à protéger l’efficacité de l’arbitrage et à décourager les manœuvres dilatoires consistant à contester la clause devant le juge étatique pour retarder la procédure arbitrale.
Cette règle est intimement liée au principe dit de « Compétence-Compétence », consacré en droit français par l’article 1465 du Code de procédure civile (applicable en international via l’article 1506). Ce principe a deux facettes :
- L’effet positif : Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. C’est à lui qu’il revient, en priorité, d’examiner les contestations relatives à l’existence, la validité ou la portée de la convention d’arbitrage.
- L’effet négatif : Le juge étatique, saisi d’un litige couvert par une convention d’arbitrage (qui n’est pas manifestement nulle ou inapplicable), doit se déclarer incompétent et laisser l’arbitre examiner en premier lieu sa propre compétence. Le contrôle du juge étatique sur la compétence de l’arbitre n’interviendra, le cas échéant, qu’a posteriori, lors d’un recours contre la sentence arbitrale.
Dans certains systèmes juridiques, notamment de common law, les parties peuvent demander au juge étatique des anti-suit injunctions pour interdire à l’autre partie de saisir un tribunal (étranger ou national) en violation de la convention d’arbitrage. Cette pratique est vue avec réticence en France et au sein de l’Union Européenne, considérée comme portant atteinte à la compétence des juridictions saisies et au principe de confiance mutuelle.
Gérer la complexité : l’arbitrage multipartite
Les litiges commerciaux internationaux sont rarement simples et impliquent fréquemment plus de deux acteurs. Pensons aux grands projets de construction (maître d’ouvrage, entrepreneur, sous-traitants, fournisseurs), aux chaînes de contrats de vente, ou aux opérations de financement complexes. Si chaque contrat contient une clause d’arbitrage distincte, on risque un éclatement des procédures : plusieurs arbitrages parallèles, concernant potentiellement les mêmes faits, avec des coûts multipliés et, surtout, le risque de décisions contradictoires.
Comment l’arbitrage gère-t-il cette complexité ? Les mécanismes classiques du contentieux judiciaire, comme l’appel en garantie ou l’intervention forcée d’un tiers, ne sont pas transposables tels quels en arbitrage, car celui-ci repose sur le consentement des parties. On ne peut forcer une partie à participer à un arbitrage si elle n’y a pas consenti. La Cour de cassation française a clairement affirmé que l’existence d’une convention d’arbitrage entre certaines parties empêche leur attraction forcée devant un juge étatique saisi par une autre partie, même au nom de la connexité ou de l’indivisibilité des litiges.
La solution réside donc principalement dans l’anticipation contractuelle :
- Clauses d’arbitrage multipartites : Il est possible de rédiger des clauses spécifiques dans les différents contrats liés à une même opération, prévoyant par exemple la consolidation des procédures arbitrales futures devant un seul tribunal, ou des mécanismes de désignation des arbitres adaptés à une situation multipartite.
- Importance de l’égalité : Un point de vigilance majeur est le respect du principe d’égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral. Une clause qui donnerait un avantage structurel à un groupe de parties par rapport à un autre dans la désignation des arbitres pourrait être considérée comme contraire à l’ordre public et entraîner l’irrégularité de la constitution du tribunal (jurisprudence Dutco).
Les institutions d’arbitrage jouent ici un rôle essentiel. De nombreux règlements (CCI, LCIA, HKIAC, etc.) contiennent désormais des dispositions permettant, sous certaines conditions (accord des parties, liens entre les affaires, même convention d’arbitrage ou conventions compatibles), la jonction de plusieurs procédures arbitrales pendantes ou l’intervention d’un tiers consentant dans un arbitrage existant. Le choix d’un arbitrage institutionnel peut ainsi offrir des solutions procédurales pour gérer efficacement les litiges multipartites.
La convention d’arbitrage peut-elle lier des non-signataires ?
Le principe de base en droit des contrats est celui de l’effet relatif : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont signé. La convention d’arbitrage n’échappe pas à cette règle. En principe, seuls les signataires sont tenus par l’engagement d’arbitrer.
Cependant, la pratique des affaires internationales et la complexité des montages contractuels ont conduit la jurisprudence française, particulièrement libérale en la matière, à admettre que, dans certaines circonstances, les effets de la convention d’arbitrage puissent s’étendre à des personnes ou sociétés qui ne l’ont pas formellement signée. Cette extension reste exceptionnelle et repose essentiellement sur la recherche d’une volonté implicite ou d’une implication directe.
Les principaux cas d’extension ou de transmission reconnus sont :
- Groupes de sociétés : Une société mère ou une autre société du groupe, bien que non signataire, peut être liée par la clause compromissoire signée par une filiale si elle a été directement impliquée dans la négociation, l’exécution ou la résiliation du contrat principal, et si les circonstances établissent qu’elle avait connaissance de la clause et a consenti, même implicitement, à être liée. L’analyse se fait au cas par cas, en examinant la réalité économique et le comportement des sociétés.
- Chaînes de contrats translatives de propriété : Dans une succession de ventes ou de contrats d’entreprise portant sur la même chose, la jurisprudence considère que la clause d’arbitrage se transmet avec l’action contractuelle en garantie ou en responsabilité, qui est elle-même un accessoire du droit de propriété transmis. Ainsi, le sous-acquéreur peut se voir opposer (ou peut invoquer) la clause signée par le vendeur initial, sauf s’il prouve qu’il ignorait raisonnablement son existence (jurisprudence Alcatel).
- Cession de contrat ou de créance : Le cessionnaire du contrat ou de la créance est également lié par la clause d’arbitrage qui y est attachée.
- Subrogation : L’assureur subrogé dans les droits de son assuré est tenu par la convention d’arbitrage signée par ce dernier.
En revanche, la transmission est généralement exclue pour les garants (comme la caution), sauf s’ils ont manifesté d’une manière ou d’une autre leur acceptation de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat principal garanti. Le cautionnement est en effet considéré comme un contrat distinct.
L’État et les entités publiques face à l’arbitrage international
La question de savoir si un État ou une entité publique peut valablement s’engager dans une convention d’arbitrage a longtemps été débattue. Si le droit interne français pose un principe d’interdiction (article 2060 du Code civil), la jurisprudence a consacré une solution différente pour l’arbitrage international.
Depuis l’arrêt Galakis (1966), il est admis qu’une personne morale de droit public, française ou étrangère, peut valablement conclure une convention d’arbitrage dès lors que celle-ci se rapporte à un contrat international conclu pour les besoins et dans des conditions conformes aux usages du commerce international. Le simple caractère international de l’opération économique suffit à écarter l’interdiction de principe du droit interne.
Cette capacité à compromettre emporte une conséquence majeure : en acceptant l’arbitrage, l’État ou l’entité publique renonce implicitement mais certainement à son immunité de juridiction. Il ne peut plus ensuite invoquer cette immunité pour échapper à la compétence du tribunal arbitral.
La question de l’immunité d’exécution est plus complexe. L’immunité d’exécution protège les biens d’un État étranger contre les mesures de saisie sur le territoire français. Cette immunité n’est pas absolue. Elle peut être écartée :
- Si les biens saisis sont spécifiquement affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui est à l’origine de la créance constatée par la sentence.
- Si l’État a renoncé à son immunité d’exécution. La jurisprudence récente exige une renonciation expresse (Civ. 1ère, 13 mai 2015), abandonnant une exigence antérieure de renonciation « spéciale » (visant des biens précis). L’évolution législative (projet de loi « Sapin 2 » à l’époque des sources du PDF, devenu loi) a pu réintroduire des conditions plus strictes pour certains biens, notamment diplomatiques, exigeant une autorisation judiciaire préalable.
Enfin, la théorie de l’émanation permet parfois d’exécuter une sentence rendue contre un État sur les biens d’une entité publique distincte (entreprise publique, agence…). Pour cela, il faut démontrer que l’entité n’a pas une autonomie réelle vis-à-vis de l’État et que leurs patrimoines se confondent, ce qui est apprécié strictement par les tribunaux.
Arbitrage et conventions internationales
Si les conventions internationales ne régissent pas directement toute la procédure arbitrale, certaines contiennent des dispositions clés sur les effets de la convention d’arbitrage elle-même.
- La Convention de New York de 1958, bien que principalement axée sur la reconnaissance et l’exécution des sentences, impose aux États contractants de reconnaître la validité des conventions d’arbitrage écrites (Art. II.1) et d’obliger leurs tribunaux à renvoyer les parties à l’arbitrage si elles sont saisies d’un litige couvert par une telle convention, sauf si celle-ci est « caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée » (Art. II.3). Elle contient également des règles sur la capacité et la validité de la convention dans le cadre de l’examen des motifs de refus d’exécution (Art. V).
- La Convention Européenne de Genève de 1961 (moins largement ratifiée) confirme également la capacité des personnes morales de droit public à compromettre (Art. II.1) et le principe compétence-compétence (Art. V.3).
Ces textes conventionnels renforcent l’efficacité de la convention d’arbitrage sur la scène internationale.
En conclusion, la convention d’arbitrage international déploie des effets juridiques puissants. Elle confère compétence aux arbitres tout en écartant, en principe, celle des juges étatiques, et peut, dans certaines conditions définies par une jurisprudence constructive, lier des parties au-delà des signataires initiaux, y compris des entités étatiques.
Les effets d’une convention d’arbitrage dépassent souvent le cercle des signataires initiaux. Anticiper ces conséquences est essentiel. Notre cabinet peut vous aider à analyser la portée de vos engagements et à défendre vos intérêts.
Sources
- Code de procédure civile (notamment articles 1448, 1455, 1465, 1505, 1506, 1520, 2060)
- Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) (notamment Articles II, V, VII)
- Convention Européenne sur l’arbitrage commercial international (Genève, 1961) (notamment Articles II, V, VI, VII)
- Jurisprudence clé (mentionnée à titre indicatif : Cass. Civ. 1ère, 2 mai 1966, Galakis; Cass. Civ. 1ère, 7 janvier 1992, Dutco; Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2007, Alcatel)