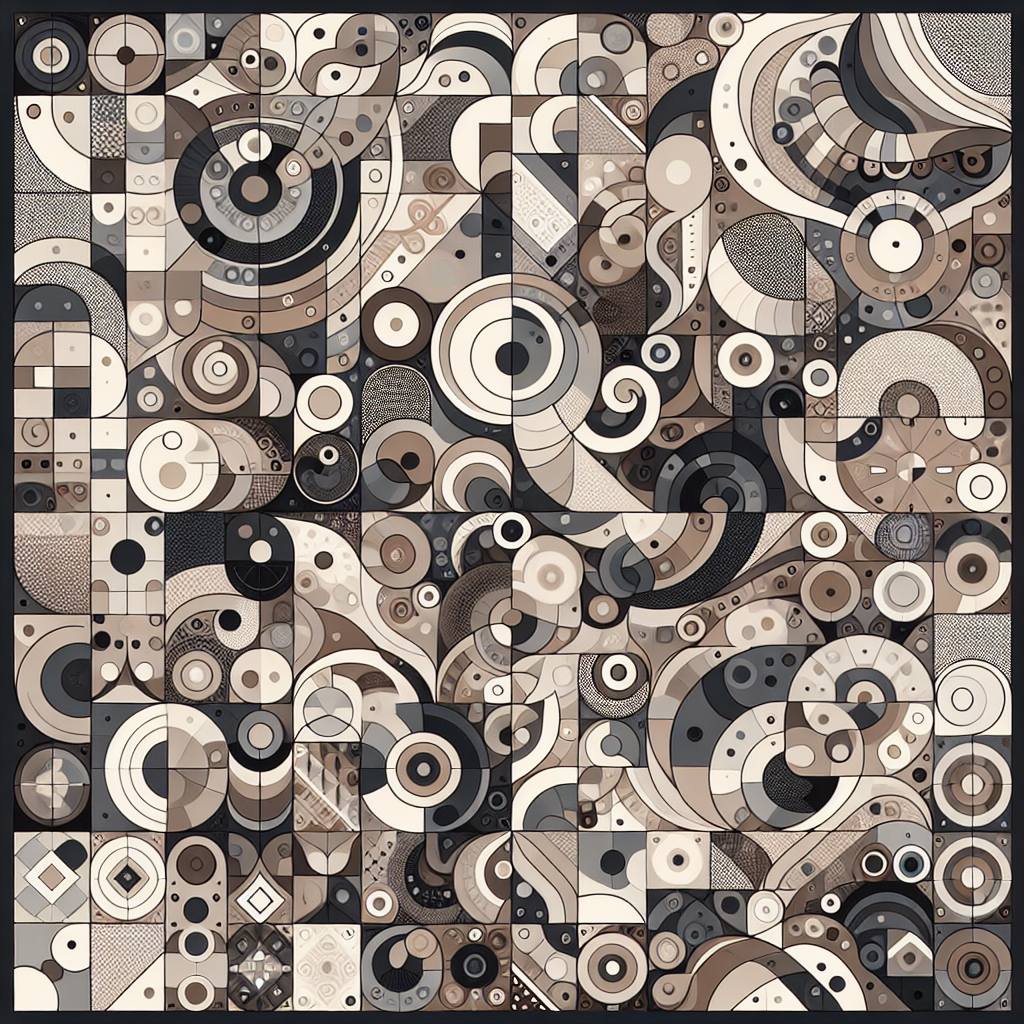Posséder un fonds artisanal, c’est détenir bien plus qu’un simple ensemble de biens matériels. C’est un outil de travail dynamique, source de revenus, mais aussi un actif valorisable qui peut servir à obtenir du crédit ou dont la transmission peut être judicieusement préparée. Pour en comprendre pleinement les implications, il est essentiel de connaître au préalable sa composition et ses modes d’acquisition. Une fois le fonds acquis, comment optimiser son exploitation ? Il est essentiel pour cela de bien comprendre le statut juridique de l’artisan lui-même. Comment l’utiliser pour financer son développement ? Et comment anticiper sa gestion future ou sa transmission ?
Cet article explore les différentes facettes de la gestion et de la valorisation du fonds artisanal. Nous aborderons les modes d’exploitation, directs ou indirects (usufruit, location-gérance, gérance-mandat), les techniques permettant de mobiliser le fonds comme garantie (sûretés réelles), et enfin les outils d’anticipation successorale comme le mandat à effet posthume.
L’exploitation du fonds artisanal : différentes modalités
Si l’exploitation directe par le propriétaire est le cas le plus courant, diverses situations peuvent amener à dissocier la propriété de l’exploitation effective du fonds. Le droit offre plusieurs mécanismes pour encadrer ces situations. Au-delà des structures juridiques d’exploitation, le quotidien de l’entreprise artisanale repose aussi sur la qualité de ses qualifications et la gestion de ses ressources humaines, qu’il s’agisse de l’accueil d’apprentis ou de la formalisation du statut du conjoint.
Exploitation pour compte propre : l’usufruit du fonds
L’usufruit est le droit d’utiliser un bien appartenant à autrui (le nu-propriétaire) et d’en percevoir les fruits, à charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil). Ce droit est temporaire (viager pour une personne physique, 30 ans maximum pour une personne morale). Il peut naître de la loi (par exemple, les droits du conjoint survivant sur la succession) ou d’un contrat (donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, vente de l’usufruit…).
Appliqué à un fonds artisanal :
- Droits et obligations de l’usufruitier : Il a le pouvoir de gérer et d’exploiter le fonds pour en percevoir les bénéfices (qui sont considérés comme des fruits). Il peut réaliser les actes d’administration et même certains actes de disposition sur les éléments du fonds (ex : remplacer du matériel), tant qu’il maintient la substance de l’ensemble. Il peut même donner le fonds en location-gérance. En contrepartie, il doit exploiter le fonds « raisonnablement », l’entretenir (réparations courantes), payer les charges annuelles liées à l’exploitation, et dresser un inventaire au début de l’usufruit.
- Droits et obligations du nu-propriétaire : Il conserve le droit de disposer du fonds (le vendre, par exemple, mais sans nuire aux droits de l’usufruitier qui conserve son usufruit sur le bien vendu). Il doit assurer la jouissance paisible de l’usufruitier (ne pas le concurrencer, par exemple). Il est responsable des « grosses réparations » (celles touchant à la structure, notion difficile à transposer au fonds mais visant sans doute les investissements majeurs pour sa pérennité), bien que l’usufruitier ne puisse l’y contraindre judiciairement en l’état actuel du droit.
- Extinction : L’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier (ou au terme prévu), par la perte totale du fonds, par le non-usage pendant 30 ans, ou par déchéance en cas d’abus de jouissance. À la fin, l’usufruitier restitue le fonds au nu-propriétaire, sans pouvoir réclamer d’indemnité pour les améliorations qu’il y aurait apportées (article 599 al. 2 du Code civil), une règle souvent critiquée.
Exploitation pour compte propre : la location-gérance
La location-gérance (ou gérance libre) est un contrat par lequel le propriétaire (ou l’exploitant) d’un fonds artisanal en confie la location à un gérant (le locataire-gérant) qui l’exploite à ses risques et périls, moyennant le paiement d’une redevance (articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce). C’est une formule utile pour assurer une gestion temporaire (maladie, attente d’un héritier…) ou pour permettre à un futur acquéreur de tester l’affaire avant de l’acheter.
Points clés du régime (spécifique aux fonds de commerce et artisanaux) :
- Qualification : C’est un contrat de location portant sur un bien meuble incorporel (le fonds), distinct du bail immobilier des locaux. Il est intuitu personae concernant le locataire (il ne peut sous-louer ou céder le contrat sans accord).
- Conditions : Pour pouvoir louer son fonds, le loueur doit en principe l’avoir exploité personnellement pendant au moins deux ans (article L. 144-3). De nombreuses exceptions existent (héritiers, majeurs protégés, établissements de crédit…) et une dispense judiciaire peut être obtenue. Le non-respect de cette condition entraîne la nullité du contrat.
- Publicité : Le contrat doit être publié dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours. Le locataire-gérant doit s’immatriculer au RM.
- Obligations du loueur : Délivrer le fonds en état d’être exploité, garantir contre les vices cachés, assurer la jouissance paisible, et surtout, il est solidairement responsable avec le locataire des dettes contractées par ce dernier à l’occasion de l’exploitation, jusqu’à la publication du contrat et pendant les 6 mois suivants (article L. 144-7). Cette solidarité est un frein majeur à la formule.
- Obligations du locataire : Exploiter le fonds raisonnablement, sans en modifier l’activité principale, payer la redevance, entretenir le fonds (réparations courantes), et le restituer en fin de contrat.
- Extinction : Elle intervient à l’échéance du terme convenu (pas de droit au renouvellement automatique), par résiliation (faute, accord), par perte du fonds, ou par décès du locataire. La fin du contrat rend immédiatement exigibles les dettes d’exploitation du locataire (article L. 144-9).
Exploitation pour compte d’autrui : la gérance-mandat
Ici, le propriétaire (le mandant) confie la gestion du fonds à un gérant (le mandataire), qui agit au nom et pour le compte du mandant, moyennant une commission souvent proportionnelle au chiffre d’affaires (articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce). Le mandant reste propriétaire et supporte les risques de l’exploitation. Le gérant-mandataire dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail (embauche de personnel…).
Ce statut hybride, créé pour sécuriser des situations intermédiaires entre salariat et entrepreneuriat, est encadré :
- Formation : Le mandant doit fournir une information précontractuelle détaillée au futur gérant (article L. 146-2). Le gérant-mandataire doit s’immatriculer au RM (ou RCS).
- Régime : C’est un mandat, soumis aux règles du Code civil (articles 1984 et s.), mais avec des spécificités inspirées du droit du travail :
- Rémunération : Une commission minimale doit être garantie, fixée par accord-cadre ou, à défaut, par le ministre (ou le juge).
- Obligations : Le mandant doit mettre le fonds à disposition, payer la commission, rembourser les frais et avances, et indemniser le mandataire des pertes subies sans faute de sa part (article 2000 C. civ.). Le mandataire doit gérer avec diligence, rendre compte, et respecter les instructions.
- Extinction : Souvent considéré comme un mandat d’intérêt commun (révocable uniquement pour juste motif ou d’un commun accord), il prévoit une indemnité de fin de contrat spécifique en cas de résiliation par le mandant (sauf faute grave du gérant), égale aux commissions des 6 derniers mois (article L. 146-4).
Exploitation pour compte d’autrui : le mandat à effet posthume
Créé par la loi de 2006 sur les successions (articles 812 et s. du Code civil), cet outil permet à une personne (le mandant) de désigner de son vivant un mandataire (personne physique ou morale) chargé d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession après son décès, pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés.
- Spécificités : C’est un mandat qui déroge aux règles classiques : il prend effet au décès, le mandataire représente les héritiers (qui ne l’ont pas choisi) et non le défunt, et il dessaisit les héritiers de la gestion des biens concernés.
- Conditions : Il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime (inaptitude d’un héritier, nécessité de gérer des biens professionnels…), donné et accepté par acte notarié avant le décès. Le mandataire doit être capable et ne pas être frappé d’interdiction de gérer si des biens professionnels sont concernés.
- Pouvoirs : Les pouvoirs du mandataire sont limités aux actes conservatoires et d’administration provisoire avant l’acceptation de la succession par l’héritier concerné. Après acceptation, les pouvoirs sont ceux définis par le mandat (généralement administration, sauf mandat exprès pour des actes de disposition). Le mandat s’exerce sous réserve des pouvoirs d’un éventuel exécuteur testamentaire.
- Durée : En principe 2 ans (prorogeable judiciairement), mais porté à 5 ans (prorogeable) si justifié par l’inaptitude de l’héritier ou la nécessité de gérer des biens professionnels.
C’est un outil puissant pour assurer la continuité de l’exploitation d’un fonds artisanal après le décès de l’exploitant, en attendant que les héritiers puissent prendre le relais ou décider du sort de l’entreprise.
La mobilisation du fonds artisanal comme garantie
Le fonds artisanal, en tant qu’actif économique, peut servir de garantie pour obtenir des financements. Deux grandes approches existent : les sûretés basées sur la propriété du fonds et celles basées sur sa valeur.
Les sûretés basées sur la propriété
Ici, le créancier obtient une forme de droit de propriété sur le fonds en garantie de sa créance.
- La Clause de Réserve de Propriété (CRP) : (Articles 2367 et s. du Code civil) Stipulée dans un contrat de vente du fonds (souvent à crédit), elle suspend le transfert de propriété à l’acquéreur jusqu’au paiement intégral du prix. Le vendeur reste propriétaire et peut revendiquer le fonds en cas de non-paiement. Pour être efficace, notamment en cas de procédure collective de l’acquéreur, la clause doit être écrite et convenue au plus tard à la livraison. Elle est très protectrice pour le vendeur.
- Le Crédit-Bail sur fonds artisanal : (Articles L. 313-7 et s. du Code monétaire et financier) Une société de financement achète le fonds et le loue à l’artisan avec une promesse unilatérale de vente à l’issue d’une période déterminée. L’artisan paie des loyers (redevances) et peut acquérir le fonds à la fin en levant l’option. C’est une technique de financement, mais peu utilisée pour les fonds artisanaux car risquée pour le crédit-bailleur (la valeur du fonds dépend de l’exploitation par l’artisan) et soumise au régime contraignant de la location-gérance (notamment la solidarité du bailleur). La publicité de l’opération est obligatoire.
- La Fiducie-Sûreté : (Articles 2011 et s., 2372-1 et s. du Code civil) L’artisan (constituant) transfère la propriété de son fonds à un créancier (ou un tiers) fiduciaire, à charge pour ce dernier de le restituer une fois la dette payée. En cas de défaut de paiement, le fiduciaire acquiert la libre disposition du fonds (ou le vend) pour se payer. L’artisan conserve généralement l’usage du fonds via une convention ad hoc (non soumise au régime de la location-gérance si le fonds est commercial – attention, l’article 2018-1 C.civ. ne vise pas explicitement le fonds artisanal, ce qui pourrait poser problème). C’est une sûreté très forte mais complexe, nécessitant un acte notarié et un enregistrement fiscal.
Les sûretés basées sur la valeur : Le Nantissement
C’est la sûreté la plus spécifiquement associée au fonds artisanal depuis sa reconnaissance légale (article 22, Loi 96-603 renvoyant aux articles L. 142-1 et s. du Code de commerce).
- Définition : Le nantissement est l’affectation du fonds (bien meuble incorporel) en garantie d’une dette, sans que l’artisan en soit dépossédé. Il continue d’exploiter son fonds.
- Intérêt : Bien que souvent perçu comme une garantie de second rang (sa valeur dépendant de la bonne marche de l’entreprise), il est fréquemment demandé par les banques en complément d’autres sûretés.
- Types : Il peut être conventionnel (accord entre l’artisan et le créancier) ou judiciaire (obtenu par un créancier via une autorisation du juge pour garantir une créance paraissant fondée et dont le recouvrement est menacé).
- Formalités : Le nantissement conventionnel doit être constaté par écrit et enregistré. Surtout, il doit être inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce compétent dans les 30 jours de l’acte, sous peine de nullité. L’inscription est valable 10 ans et doit être renouvelée. Le nantissement judiciaire fait l’objet d’une inscription provisoire puis définitive.
- Assiette : Le nantissement porte sur les éléments incorporels listés par la loi (enseigne, nom, droit au bail, clientèle, propriété intellectuelle…) et sur le matériel et le mobilier professionnel. Il ne couvre pas les marchandises.
- Effets : Le créancier nanti bénéficie d’un droit de préférence (être payé avant les créanciers chirographaires sur le prix de vente du fonds) et d’un droit de suite (pouvoir faire vendre le fonds même s’il a été cédé à un tiers). Il ne peut cependant pas demander l’attribution judiciaire du fonds en paiement. En cas de non-paiement, il peut provoquer la vente forcée du fonds aux enchères publiques.
Exploiter, financer ou transmettre votre fonds artisanal nécessite des choix stratégiques aux conséquences juridiques et financières importantes. La location-gérance engage votre responsabilité différemment de la gérance-mandat. Le choix d’une sûreté (nantissement, fiducie…) dépendra des exigences de vos partenaires financiers et du niveau de risque acceptable. Notre cabinet vous conseille sur les structures d’exploitation et les options de financement les plus adaptées à votre projet, afin d’optimiser la gestion de votre fonds et de sécuriser vos opérations.
Sources
- Code civil (Art. 578 et s., 812 et s., 1709 et s., 1984 et s., 2000, 2011 et s., 2355 et s., 2367 et s., 2372-1 et s.)
- Code de commerce (Art. L.142-1 et s., L.143-1 et s., L.144-1 et s., L.146-1 et s., R.143-1 et s., R.144-1)
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (Art. 22)
- Code monétaire et financier (Art. L.313-7 et s., R.313-3 et s.)
- Code des procédures civiles d’exécution (Articles relatifs aux mesures conservatoires et à la distribution des deniers)