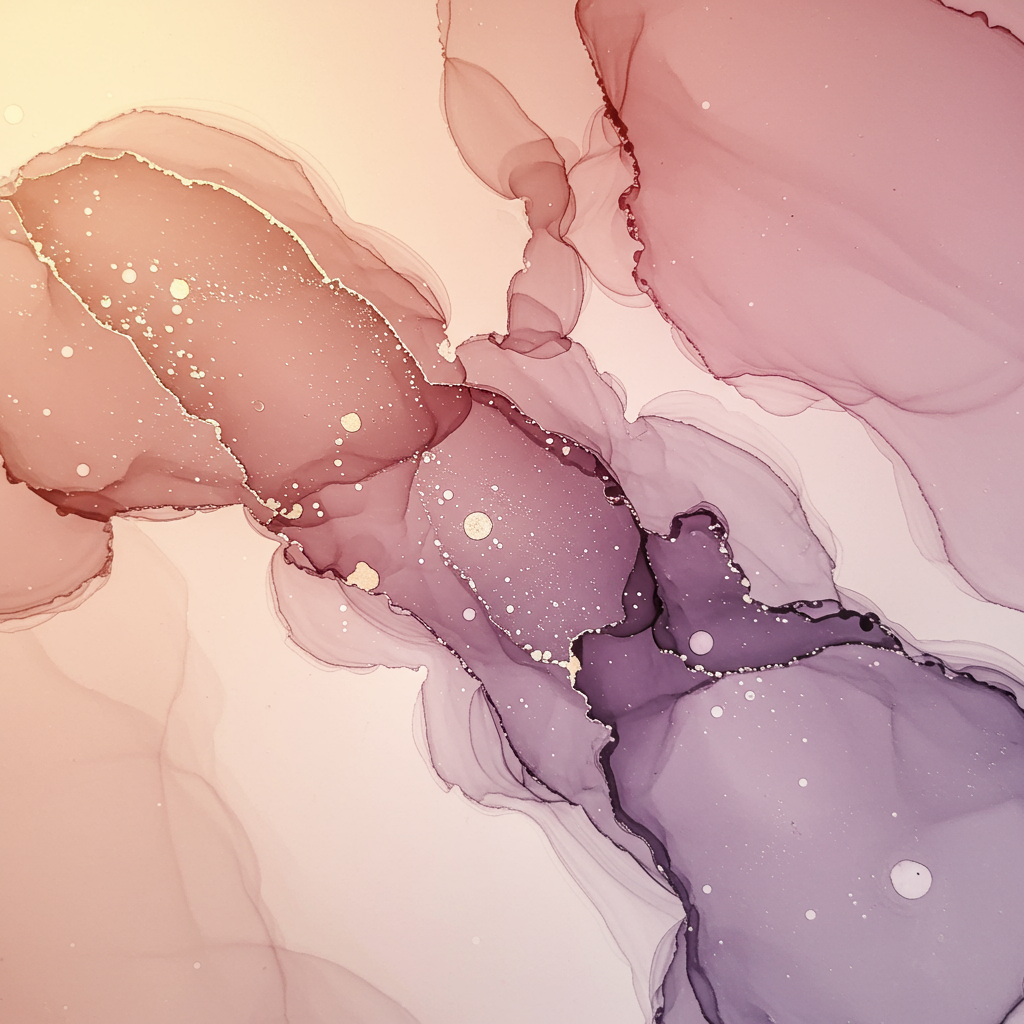Le nantissement de compte-titres est un mécanisme de garantie puissant et souple, très utilisé dans la vie des affaires pour sécuriser un financement ou une transaction. Sa mise en place obéit cependant à un formalisme précis, où chaque étape conditionne sa validité et son efficacité. Une simple erreur ou omission peut priver le créancier de la sécurité attendue. Cet article détaille les étapes de sa constitution, un aspect essentiel abordé dans notre guide complet du nantissement de compte-titres. Il s’adresse aux dirigeants et entrepreneurs qui souhaitent comprendre les démarches pour mettre en place cette sûreté de manière correcte et robuste.
Les fondements juridiques de la constitution
Avant 1996, la prise de garantie sur des titres financiers était fragmentée et complexe, chaque type de titre possédant son propre régime. La loi de modernisation des activités financières a introduit une réforme majeure en créant un régime unifié, aujourd’hui piloté par un texte central du droit des sûretés mobilières.
L’article L. 211-20 du code monétaire et financier
Ce texte est la pierre angulaire du nantissement de compte-titres. Il définit le mécanisme, son assiette, ses conditions de formation et ses modalités de réalisation. Codifiant les principes de la loi de 1996, cet article a été retouché au fil du temps, notamment par les réformes du droit des sûretés de 2006 et 2021, pour en préciser et renforcer l’efficacité. Il consacre une sûreté qui ne porte plus sur des titres identifiés un par un, mais sur un ensemble dynamique : le compte lui-même, conçu comme une universalité.
Distinction avec l’ancien gage de valeurs mobilières
Le nantissement de compte-titres a remplacé l’ancien gage de valeurs mobilières, qui présentait des rigidités importantes. Le principal apport de la réforme a été d’introduire une souplesse considérable. Auparavant, le gage portait sur des titres spécifiques et figeait la composition du portefeuille. Toute opération de vente ou de substitution nécessitait de nouvelles formalités complexes. Le nantissement moderne, lui, porte sur le compte. Cela signifie que le contenu du portefeuille peut évoluer par subrogation réelle (le produit de la vente d’un titre est automatiquement inclus dans la garantie) ou par des ajouts, sans remettre en cause la sûreté initiale. Cette innovation a rendu la garantie compatible avec une gestion active du portefeuille de titres.
La déclaration de nantissement : une formalité impérative
Le cœur du processus de constitution réside dans un document unique : la déclaration de nantissement. C’est cet acte qui donne naissance à la sûreté et la rend opposable à tous, y compris à la société émettrice des titres et aux autres créanciers.
Contenu obligatoire de la déclaration
Pour être valable, la déclaration, signée par le titulaire du compte (le constituant), doit être datée et comporter une série de mentions obligatoires définies par l’article D. 211-10 du Code monétaire et financier. Elle doit explicitement se dénommer « Déclaration de nantissement », mentionner l’article L. 211-20, et identifier précisément les parties (constituant et créancier). Surtout, elle doit désigner la créance garantie, soit par son montant, soit par des éléments permettant de l’identifier sans ambiguïté. Enfin, elle doit lister la nature et le nombre des titres qui composent initialement l’assiette de la garantie et les éléments d’identification du compte sur lequel ils sont inscrits.
Valeur juridique et opposabilité aux tiers
La force du système réside dans la simplicité de cette formalité. La seule signature de cette déclaration suffit à constituer le nantissement. Il n’est pas nécessaire de notifier l’acte à la société qui a émis les titres, comme la Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises. Une fois la déclaration signée, la sûreté est valablement formée entre les parties et devient immédiatement opposable aux tiers. La date de la déclaration fixe le point de départ de la garantie et son rang par rapport à d’autres éventuelles sûretés.
L’ouverture du compte spécial ou l’identification deep
Pour que le nantissement soit effectif, les titres nantis doivent être isolés des autres actifs du constituant. Cette individualisation est assurée soit par leur inscription sur un compte spécial, soit, pour les titres plus modernes, par une identification informatique.
Le rôle du teneur de compte
Les titres sont inscrits sur un « compte spécial » ouvert au nom du constituant, qui en reste propriétaire. Ce compte est en réalité un sous-compte du compte-titres ordinaire. Il peut être tenu par différents acteurs : la société émettrice elle-même (pour les titres nominatifs purs), un intermédiaire financier (une banque, une entreprise d’investissement) ou un dépositaire central comme Euroclear France. Le teneur de compte a un rôle de gardien : il s’assure que les titres inscrits sur ce compte spécial ne sont pas cédés sans l’accord du créancier, sauf si une convention l’autorise.
Spécificités du compte fruits et produits
Le nantissement couvre par défaut non seulement les titres, mais aussi les « fruits et produits » qui en découlent : dividendes, intérêts, produits de remboursement ou de vente. Pour les collecter, un compte espèces associé, souvent appelé « compte fruits et produits », peut être ouvert. Son utilisation est facultative et peut être aménagée par convention. Lorsque le teneur du compte-titres n’est pas habilité à recevoir des fonds (cas fréquent des émetteurs non bancaires), ce compte espèces doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit. Les sommes qui y sont versées sont alors réputées faire partie de la garantie depuis la date de la déclaration initiale.
L’identification des titres via un dispositif d’enregistrement électronique partagé (deep)
La technologie a fait évoluer la manière dont les titres sont représentés. L’ordonnance de 2017 a validé l’inscription de certains titres financiers dans un DEEP, un registre distribué s’apparentant à une blockchain. Pour ces titres, l’inscription en DEEP « tient lieu d’inscription en compte ». Le nantissement est alors constitué non par l’ouverture d’un compte, mais par une « identification par un procédé informatique » qui vient marquer les titres comme étant nantis. L’ensemble des titres ainsi marqués est légalement assimilé au compte nanti et suit le même régime. Cette technologie, qui modernise la transmission de titres, soulève des questions spécifiques traitées dans notre article sur les enjeux du nantissement de compte-titres à l’ère du deep.
L’intérêt de la convention de nantissement
Si la déclaration est la seule formalité légale obligatoire, la rédaction d’une convention de nantissement entre le constituant et le créancier est une pratique hautement recommandée. Cet acte contractuel permet d’organiser la vie de la sûreté et d’en préciser les règles de fonctionnement. La convention est l’outil privilégié pour définir les règles applicables à la gestion et l’évolution du portefeuille nanti.
Les clauses essentielles à inclure
Mais pourquoi rédiger une convention si elle n’est pas obligatoire ? Parce qu’elle permet d’anticiper de nombreuses situations. Les parties peuvent y prévoir les conditions dans lesquelles le constituant peut gérer son portefeuille (vendre des titres à condition de réinvestir le produit), ou au contraire stipuler une inaliénabilité totale. Elles peuvent organiser les modalités d’un complément de garantie (clause « d’arrosage ») si la valeur des titres baisse. C’est également dans la convention que l’on peut insérer un « pacte commissoire », cette clause essentielle qui autorisera le créancier, en cas de défaillance du débiteur, à s’approprier les titres sans passer par une vente publique ou une décision de justice. Les délais de réalisation de la garantie peuvent aussi y être aménagés.
La notification au teneur de compte en cas de convention
Lorsque la convention autorise le constituant à disposer des titres nantis, le teneur de compte doit en être informé par écrit. Il devient alors le garant du respect des règles fixées par les parties. En pratique, il est fréquent que le teneur de compte intervienne directement à l’acte de convention pour formaliser ses propres engagements et s’assurer que les instructions sont claires et applicables.
Les nantissements successifs sur un même compte
Une question fréquente est de savoir s’il est possible de nantir une seconde fois un compte-titres déjà affecté en garantie. La réponse est positive, et cette faculté a été expressément confirmée par la loi.
Licéité et modalités de constitution des nantissements de second rang
Un constituant peut parfaitement octroyer un nantissement de second, voire de troisième rang sur un même compte. Cette possibilité est utile lorsqu’un portefeuille de titres a une valeur bien supérieure à la première créance garantie, libérant ainsi une capacité de crédit supplémentaire. La constitution d’un nantissement de second rang suit la même procédure : une nouvelle déclaration de nantissement doit être signée. Le rang des créanciers est alors déterminé par l’ordre chronologique de leurs déclarations. Le créancier de second rang ne pourra exercer ses droits qu’une fois le créancier de premier rang désintéressé, que ce soit par le paiement de la dette ou la réalisation de la garantie.
La constitution d’un nantissement de compte-titres est un acte juridique dont la précision formelle conditionne l’efficacité. Chaque étape, de la rédaction de la déclaration à la négociation d’une convention sur-mesure, comporte des implications qu’il est indispensable de maîtriser. Pour sécuriser vos garanties et bénéficier d’un accompagnement par un avocat expert pour la constitution de vos sûretés et garanties, contactez notre cabinet.
Sources
- Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-20 et D. 211-10 à D. 211-14-1.
- Code civil, notamment les articles 2340 (nantissements successifs) et 2348 (pacte commissoire).
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
- Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé.