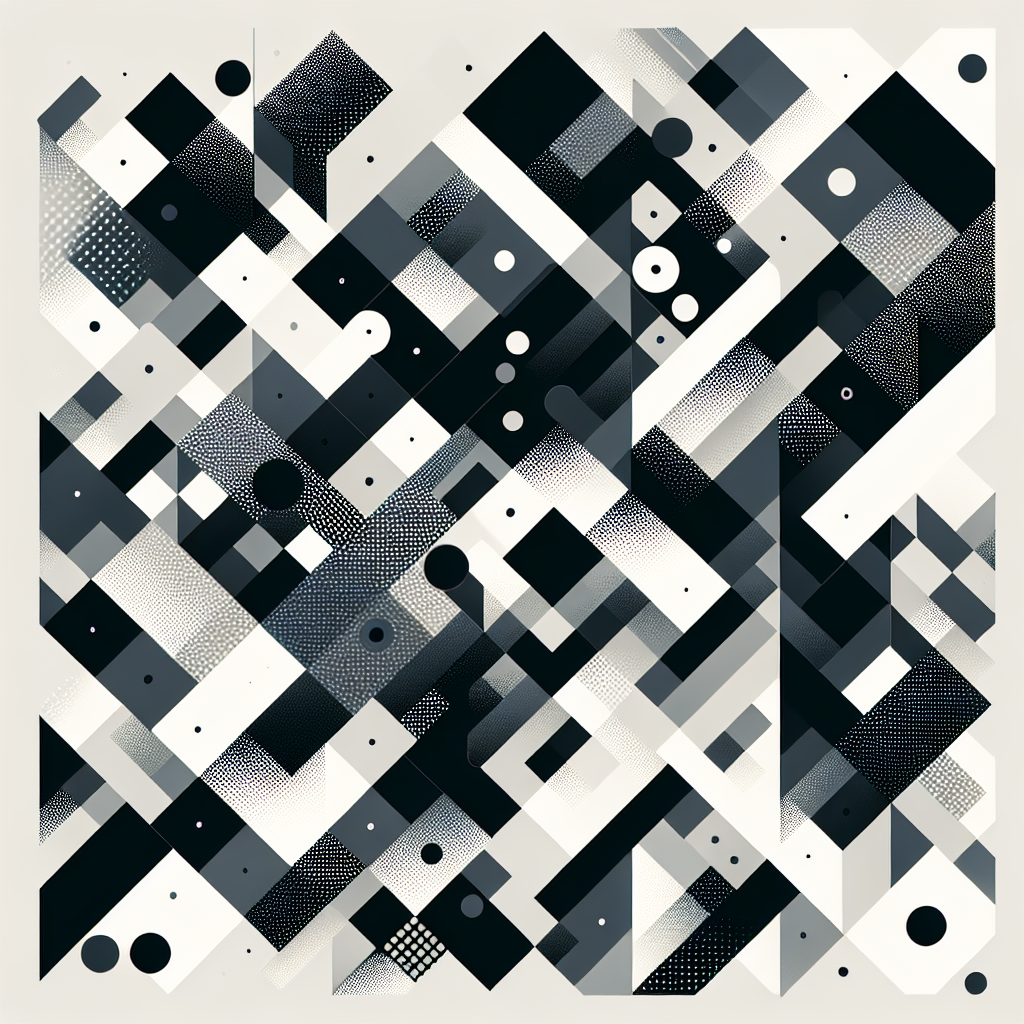Un tribunal a ordonné à votre débiteur de s’exécuter sous astreinte, mais rien ne bouge. Que faire ? L’astreinte n’est qu’une menace financière tant qu’elle n’est pas liquidée. Cette étape déterminante transforme l’astreinte en créance exigible.
Conditions de la liquidation
Qui peut demander la liquidation ?
Seul le bénéficiaire de l’obligation assortie d’astreinte peut demander sa liquidation. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 8 décembre 2011 : un syndicat de copropriétaires ne peut demander la liquidation d’une astreinte prononcée au profit de certains copropriétaires uniquement (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-26.337).
En cas de cession de créance, la jurisprudence a évolué. Désormais, le cessionnaire peut demander la liquidation de l’astreinte, mais uniquement pour la période postérieure à la notification de la cession au débiteur (Civ. 2e, 7 juill. 2011, n° 10-20.296).
Point important pour les syndics : ils ne peuvent agir sans autorisation préalable de l’assemblée générale. L’action en liquidation d’astreinte ne constitue pas une mesure conservatoire (Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-15.385).
À quel moment intervient la liquidation ?
L’astreinte peut être liquidée même après l’exécution tardive de l’obligation. La Cour de cassation l’a tranché dans deux arrêts du 8 décembre 2005 : le retard dans l’exécution justifie la liquidation de l’astreinte (Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 03-19.473 et n° 04-12.643).
Fait méconnu : la demande en liquidation se prescrit par 5 ans selon l’article 2224 du Code civil, et non par 10 ans comme les titres exécutoires (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-22.241).
La preuve de l’inexécution de l’obligation
La charge de la preuve varie selon la nature de l’obligation :
- Pour une obligation de faire : c’est au débiteur de prouver qu’il l’a exécutée (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-24.502)
- Pour une obligation de ne pas faire : c’est au créancier de prouver la violation (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-12.252)
Tous moyens de preuve sont admis, mais un constat d’huissier reste l’option la plus solide. La Cour de cassation reconnaît pleinement sa validité (Civ. 2e, 22 mars 2012, n° 11-14.664).
Juridictions compétentes pour liquider l’astreinte
Principe : compétence du juge de l’exécution
L’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe clair : la liquidation relève de la compétence du juge de l’exécution (JEX).
Ce dernier dispose d’un pouvoir d’interprétation des décisions d’autres juges. Il doit clarifier les obligations imprécises (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-13.636). Mais attention : interpréter n’est pas modifier. Le JEX ne peut remettre en cause le dispositif initial.
Exception : juge resté saisi ou s’étant réservé la liquidation
Deux exceptions à cette compétence du JEX existent :
- Quand le juge qui a prononcé l’astreinte reste saisi de l’affaire (juge de la mise en état, conseiller de la mise en état…)
- Quand le juge s’est expressément réservé la liquidation
Pour la seconde exception, l’intention du juge doit être explicite. La formule « il nous en sera référé en cas de difficulté » ne suffit pas (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20.955).
Une question intéressante a été tranchée récemment : en cas d’appel, la cour peut-elle liquider une astreinte que le premier juge s’était réservée ? La réponse est oui, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel (Soc. 20 oct. 2015, n° 14-10.725).
Sanctions du non-respect des règles de compétence
L’article R. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution est sans appel : « l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ».
Contrairement à d’autres incompétences qui peuvent être couvertes, celle-ci s’impose au juge. C’est un moyen d’ordre public.
Calcul du montant de l’astreinte liquidée
Appréciation de la cause étrangère
L’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée, totalement ou partiellement, si l’inexécution provient d’une cause étrangère (art. L. 131-4 al. 3 CPCE).
Pour l’astreinte définitive, c’est le seul échappatoire. La jurisprudence est stricte sur cette notion.
N’est pas une cause étrangère :
- La vente de l’immeuble à démolir (Civ. 2e, 15 déc. 2005, n° 04-12.353)
- La grève des préposés (Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-10.817)
- La liquidation judiciaire (Com. 2 oct. 2001, n° 00-10.337)
A été reconnue comme cause étrangère :
- L’impossibilité de produire des documents non détenus (Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 02-14.631)
- Le départ définitif du locataire rendant inutiles les travaux (Civ. 2e, 6 avr. 2006, n° 04-14.887)
Évaluation du comportement du débiteur
Pour l’astreinte provisoire uniquement, l’article L. 131-4 al. 1 du CPCE prévoit que la liquidation tient compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut réduire le montant théorique ou même supprimer l’astreinte.
Mais attention : le juge ne peut prendre en compte le préjudice du créancier (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-15.755). L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Modulation ou suppression de l’astreinte provisoire
Le juge apprécie souverainement la proportion dans laquelle l’astreinte doit être modérée (Civ. 3e, 29 avr. 2009, n° 08-12.952).
Des éléments comme l’âge, l’état de santé, ou la surcharge de travail peuvent justifier une modération (Montpellier, 7 nov. 2013, RG n° 13/00638).
Par contre, une erreur de service ne suffit pas (Civ. 2e, 20 déc. 2000, n° 98-23.102).
Le montant final ne peut jamais dépasser celui fixé initialement (Civ. 2e, 11 mai 2006, n° 05-17.402).
Effets de la décision liquidant l’astreinte
Nature de la créance d’astreinte
La créance d’astreinte présente plusieurs caractéristiques :
- Elle est versée intégralement au créancier (Code des procédures civiles d’exécution, art. L. 131-1 et suivants)
- Elle produit intérêts au taux légal dès le prononcé de sa liquidation (Com. 19 mars 1991, Bull. civ. IV, n° 109)
- Elle n’est pas garantie par l’assurance (Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 87-13.744)
- Elle n’est pas due par les cautions (Civ. 1re, 3 avr. 2002, n° 00-10.893)
La créance se cumule avec d’éventuels dommages-intérêts et indemnités d’occupation (Civ. 2e, 30 janv. 2003, n° 01-12.749).
Recours contre la décision de liquidation
La décision liquidant l’astreinte est exécutoire de plein droit (art. R. 131-4 CPCE). La jurisprudence refuse systématiquement tout sursis à exécution (Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-25.124).
Le taux du ressort pour l’appel est déterminé par le montant demandé à titre de liquidation, et non par celui accordé (Soc. 6 mai 1998, n° 96-40.544).
Si la décision principale est infirmée, toutes les décisions de liquidation sont anéanties par ricochet, même celles passées en force de chose jugée (Com. 3 mai 2006, n° 04-15.262).
Exécution de la décision de liquidation
Une fois l’astreinte liquidée, elle constitue une créance comme une autre. Elle peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée classiques.
Si l’obligation n’a toujours pas été exécutée, le créancier peut demander une nouvelle astreinte, souvent plus élevée. Certaines cours d’appel n’hésitent pas à multiplier le taux par six, voire plus (Paris, 5 avr. 2007, RG n° 2006/20124).
Fait souvent ignoré : en cas d’absorption de la société débitrice, la société absorbante reste tenue de l’astreinte liquidée pour des faits antérieurs à la fusion (Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-19.524).
Une juriste renommée a brillamment qualifié la liquidation de « métamorphose de l’astreinte » : la menace conditionnelle devient une créance certaine.
Vous cherchez à récupérer au plus vite une créance assortie d’astreinte ? Notre équipe d’avocats possède une solide expertise en recouvrement judiciaire et procédures d’astreinte. N’hésitez pas à prendre contact pour une analyse précise de votre situation et des perspectives de liquidation.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4
- Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-26.337, Bull. civ. II, n° 224
- Civ. 2e, 7 juill. 2011, n° 10-20.296, Bull. civ. II, n° 157
- Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-15.385, Bull. civ. III, n° 71
- Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 03-19.473, Bull. civ. II, n° 307
- Civ. 2e, 8 déc. 2005, n° 04-12.643, Bull. civ. II, n° 308
- Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-22.241, RDBF 2019, n° 135
- Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-24.502, Bull. civ. II
- Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-12.252
- Civ. 2e, 22 mars 2012, n° 11-14.664
- Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-13.636, Bull. civ. II, n° 51
- Civ. 2e, 15 janv. 2009, n° 07-20.955, Bull. civ. II, n° 13
- Soc. 20 oct. 2015, n° 14-10.725, D. 2015, p. 2199
- Com. 3 mai 2006, n° 04-15.262, Bull. civ. IV, n° 106
- Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-19.524, RTD civ. 2016, p. 861