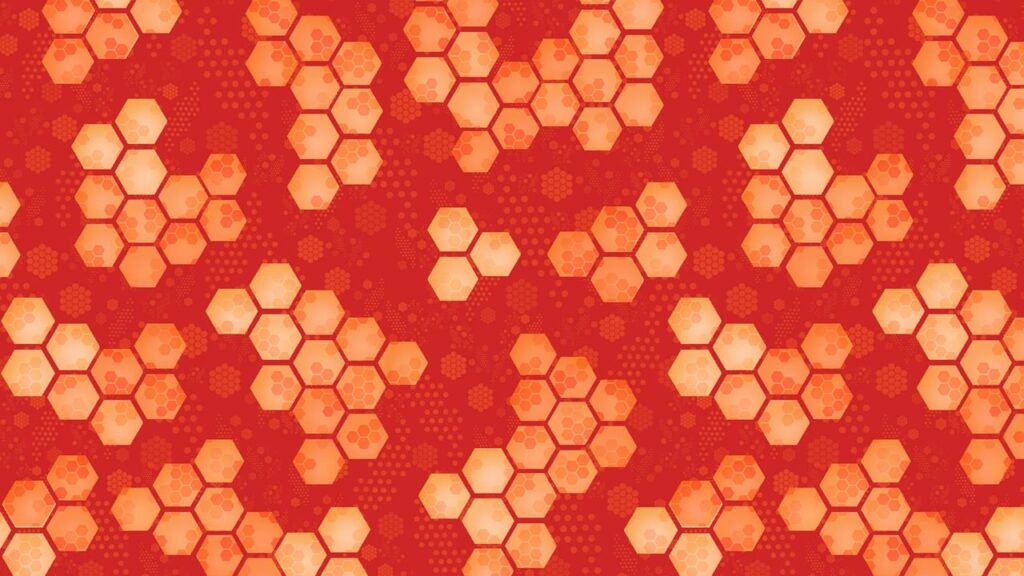Le monde maritime a ses propres règles. Quand un navire se retrouve immobilisé par une saisie conservatoire, c’est tout un équilibre économique qui bascule. Le temps d’immobilisation coûte cher. L’armateur perd de l’argent. Les marchandises n’arrivent pas à destination.
La mainlevée devient alors un enjeu crucial pour l’armateur. Elle représente la liberté retrouvée pour son navire.
I. Principe de la mainlevée
Définition et fondements juridiques
La mainlevée est l’acte qui met fin à l’immobilisation du navire saisi. Elle permet au navire de reprendre la mer.
Elle trouve son fondement juridique dans le Code des transports (article L. 5114-21) et la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Cette dernière précise dans son article 5 : « Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente […] autorisera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aura été fournie. »
Différents types de mainlevée
On distingue plusieurs types de mainlevée :
- La mainlevée contre garantie (la plus courante)
- La mainlevée pure et simple (rare, en cas d’irrégularité manifeste)
- La mainlevée conditionnelle (pour un ou plusieurs voyages)
Autorité compétente
C’est le juge de l’exécution qui détient la compétence pour ordonner la mainlevée. Il s’agit du même juge qui a autorisé la saisie. Comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2014, le juge dispose d’un « pouvoir d’appréciation pour accorder la mainlevée ».
II. Mainlevée contre garantie
Types de garanties acceptables
La garantie doit offrir au créancier une sécurité équivalente à celle que lui procurait la saisie du navire. Les juges acceptent différentes formes de garanties.
Cautions bancaires
La caution bancaire constitue la garantie de référence. Elle présente l’avantage d’être émise par un établissement financier solide. Le juge vérifie certains éléments :
- L’irrévocabilité de l’engagement
- L’absence de conditions suspensives
- La durée de validité suffisante
Lettres d’engagement des P&I Clubs
Spécificité du monde maritime, les P&I Clubs (Protection and Indemnity) sont des associations d’armateurs qui proposent une couverture d’assurance. Leurs lettres d’engagement (Letter of Undertaking ou LOU) sont généralement acceptées comme garantie.
Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 février 2020 a confirmé cette pratique, précisant que « la lettre d’engagement émise par un P&I Club notoirement solvable constitue une garantie suffisante ».
Consignation
La consignation d’une somme d’argent entre les mains d’un tiers (avocat, CARPA, Caisse des Dépôts) constitue également une garantie solide. Elle présente l’avantage de la simplicité mais immobilise des fonds.
III. Évaluation de la garantie
Critères d’évaluation
Le montant de la garantie doit être « suffisant » selon les termes de la Convention de Bruxelles. En pratique, il correspond généralement au montant de la créance invoquée, majoré des intérêts et frais prévisibles.
Dans son arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a précisé que la garantie pouvait inclure non seulement les salaires proprement dits, mais aussi « des dommages et intérêts liés à la rupture anticipée et abusive du contrat de travail, un solde de congés payés, une prime de précarité ».
Pouvoir du juge
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de la garantie. Il peut cantonner la créance à un montant qu’il estime raisonnable.
L’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017 a clairement établi que « le juge n’a pas à apprécier la contestation du débiteur portant sur le montant de la créance alléguée » pour fixer la garantie.
Contestations possibles
L’armateur peut contester le montant de la garantie s’il l’estime excessif. Cette contestation peut porter sur :
- La surévaluation de la créance
- L’inclusion de créances non maritimes
- La prise en compte d’intérêts trop élevés
Jurisprudence
La jurisprudence a progressivement affiné les critères d’évaluation de la garantie. Un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 17 décembre 1985 a établi que la garantie doit être évaluée « en fonction de l’importance des créances du saisissant » et non sur la simple « solvabilité évidente de l’armateur ».
IV. Mainlevée sans garantie
Cas d’irrégularité de la saisie
Dans certains cas, la mainlevée peut être ordonnée sans garantie. Cela arrive lorsque la saisie est manifestement irrégulière.
Défaut de titre
L’absence de titre exécutoire, quand celui-ci est nécessaire (cas de la saisie-exécution), constitue un motif de mainlevée sans garantie.
Absence de créance maritime
Pour les saisies pratiquées sur le fondement de la Convention de Bruxelles, l’absence de créance maritime entraîne la mainlevée sans garantie. Les tribunaux vérifient si la créance invoquée entre bien dans les catégories énumérées à l’article 1er de la Convention.
Le tribunal de commerce de Marseille a ainsi ordonné une mainlevée sans garantie le 5 février 2013 car la créance invoquée par une agence de voyages ne constituait pas une créance maritime.
Navire non saisissable
Certains navires ne peuvent être saisis :
- Navires d’État affectés à un service public
- Navires de guerre
- Certains navires représentant l’unique outil de travail
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mai 1989, a confirmé l’impossibilité de saisir un navire de pêche constituant l’instrument de travail nécessaire à l’activité professionnelle de l’artisan pêcheur.
V. Procédure de mainlevée
Initiative de la demande
La demande de mainlevée est généralement initiée par l’armateur ou son représentant. Elle peut aussi être demandée par toute personne ayant intérêt à voir le navire libéré (affréteur, chargeur, etc.).
Forme de la demande
La demande prend la forme d’une assignation en référé devant le juge de l’exécution. Elle doit contenir :
- L’identité des parties
- La description du navire saisi
- Les références de l’ordonnance de saisie
- Les motifs justifiant la mainlevée
- L’offre de garantie le cas échéant
Débat contradictoire
Contrairement à la procédure de saisie qui est non contradictoire, la procédure de mainlevée donne lieu à un débat entre les parties. Le créancier peut s’opposer à la mainlevée ou contester le montant de la garantie proposée.
Voies de recours
L’ordonnance de mainlevée est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours. Cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que le navire peut reprendre la mer dès la décision de première instance.
VI. Conséquences de la mainlevée
Libération du navire
La mainlevée permet au navire de quitter le port immédiatement. Les autorités portuaires sont informées et ne peuvent plus s’opposer au départ du navire.
Sort de la garantie
La garantie reste en place jusqu’à l’issue du litige au fond. Si le créancier obtient gain de cause, il pourra se payer sur la garantie. Dans le cas contraire, la garantie sera restituée à l’armateur.
Suites de la procédure
La mainlevée ne met pas fin au litige au fond. Le créancier doit introduire une action au fond dans un délai d’un mois à compter de la saisie, à peine de caducité de celle-ci.
Éventuelle responsabilité du saisissant
Si la saisie s’avère injustifiée, le saisissant peut voir sa responsabilité engagée. L’armateur peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation indue de son navire.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a qualifié d’abusive une saisie pratiquée sans vérification préalable de l’identité du propriétaire du navire.
La mainlevée constitue donc un moment charnière dans la procédure de saisie conservatoire. Elle permet un équilibre entre les intérêts du créancier et la nécessité de ne pas immobiliser inutilement un outil économique aussi important qu’un navire. Les garanties jouent ici un rôle essentiel, en substituant à l’immobilisation physique du navire une sûreté financière équivalente.
Sources
- Code des transports, articles L. 5114-21 et L. 5114-22
- Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2014, n° 13-10.092
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-21.571
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, n° 20-21.546
- Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 18/18966
- Cour d’appel de Pau, 17 décembre 1985
- Tribunal de commerce de Marseille, 5 février 2013
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mai 1989
- Cour d’appel de Douai, 8 novembre 2011, n° 10/00318