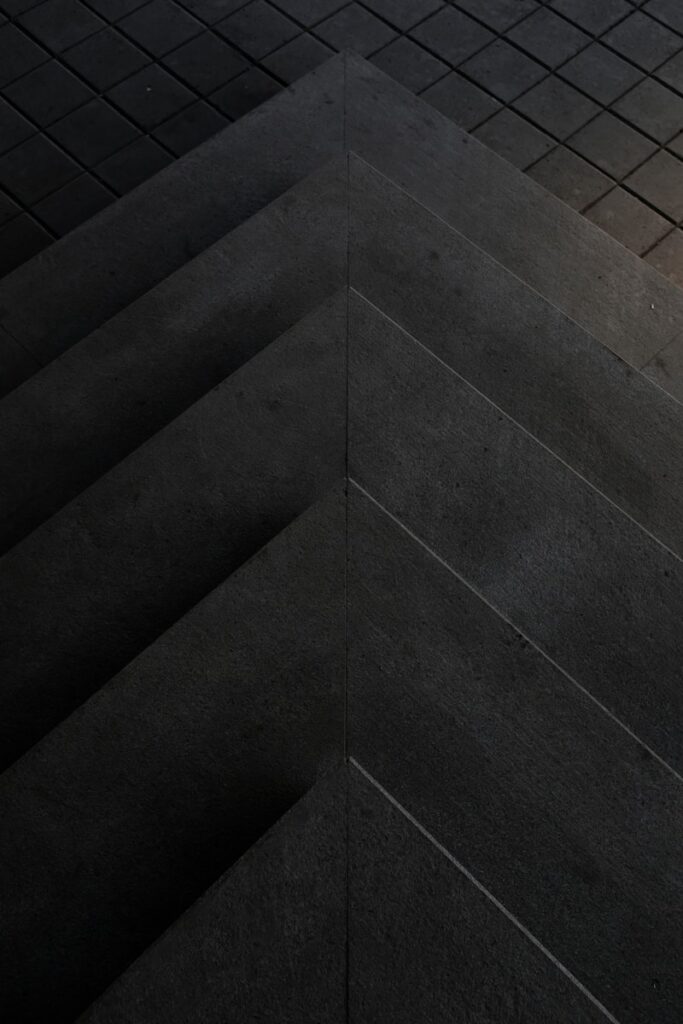Le régime des nullités constitue l’un des piliers fondamentaux de la procédure civile. Comprendre les conséquences d’un acte de procédure annulé s’avère essentiel pour tout justiciable. Que devient un acte frappé de nullité ? Cette annulation entraîne-t-elle systématiquement la chute de l’ensemble de la procédure ?
L’anéantissement rétroactif : principe et nuances
L’adage latin ne laisse a priori aucune place au doute : « quod nullum est, nullum producit efficium » (ce qui est nul ne produit aucun effet). L’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. Ce principe structure l’ensemble du régime des nullités prévu aux articles 112 à 121 du Code de procédure civile.
La jurisprudence a néanmoins développé des solutions pragmatiques pour éviter les conséquences radicales qu’entraînerait une application littérale de ce principe. La Cour de cassation, gardienne de l’équilibre procédural, a ainsi posé des limites à l’anéantissement total. Par deux arrêts de la 2ème Chambre civile (7 juin 2012, n°11-30.272 et 2 juillet 2009, n°08-11.599), elle confirme que l’annulation n’emporte pas toujours disparition de l’ensemble des effets produits par l’acte.
Cette évolution jurisprudentielle témoigne d’une volonté des magistrats de préserver l’efficacité du procès civil.
Les limites à l’anéantissement total
Le rapport d’expertise annulé : une source d’information persistante
Une solution surprenante concerne les rapports d’expertise annulés. Selon une jurisprudence constante (Com. 6 octobre 2009, n°08-15.154), le juge conserve le droit d’y puiser des « renseignements ». Il peut ainsi utiliser les éléments factuels contenus dans un rapport d’expertise nul, à condition que ces éléments soient corroborés par d’autres preuves.
Toutefois, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur ce rapport entaché de nullité, comme le rappelle un arrêt de la 1ère Chambre civile du 5 décembre 1973 (n°72-12.577).
Le rapport d’expertise n’étant pas un acte juridique stricto sensu mais un élément d’information, ses constatations factuelles survivent partiellement à la nullité.
L’effet interruptif préservé : l’apport décisif de la loi de 2008
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a marqué une rupture majeure. Avant cette réforme, l’article 2247 ancien du Code civil prévoyait que l’annulation d’un acte de procédure anéantissait son effet interruptif sur les délais de prescription.
Désormais, l’article 2241 alinéa 2 du Code civil dispose expressément :
« [L’interruption résultant de la demande en justice] produit ses effets […] lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Cette disposition s’applique tant aux vices de forme qu’aux vices de fond comme l’a confirmé la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2015 (n°14-15.198).
L’interruption des délais de péremption d’instance et du délai de l’article 528-1 du Code de procédure civile est également préservée en cas d’annulation.
L’étendue variable de l’anéantissement
Entre les parties : une annulation à géométrie variable
L’annulation opère-t-elle à l’égard de toutes les parties ? La réponse requiert des distinctions.
Dans l’hypothèse d’un acte comportant deux demandeurs dont l’un est décédé, la nullité n’affecte que la saisine émanant du défunt (Civ. 1ère, 16 décembre 2015, n°15-14.273). Le negotium valable demeure intact.
En matière d’expertise, la question devient plus complexe. Selon un arrêt du 15 avril 2010 (n°09-10.239), le rapport annulé pour violation du contradictoire devient inutilisable à l’égard de toutes les parties, même celles n’ayant pas soulevé la nullité.
L’effet domino sur les actes subséquents
Selon un principe classique, la nullité d’un acte entraîne celle des actes qui en dépendent nécessairement.
L’exemple typique concerne l’acte introductif d’instance. Sa nullité emporte celle de l’ensemble de la procédure ultérieure, comme l’illustre un arrêt de la 2ème Chambre civile du 19 février 2015 (n°14-10.622) qui, annulant un commandement valant saisie immobilière, a invalidé l’ensemble des actes suivants jusqu’à l’adjudication.
En revanche, cette contagion reste limitée aux actes directement dépendants. Ainsi, la nullité d’une assignation en référé n’entraîne pas celle de l’assignation au fond (Civ. 2ème, 11 octobre 1989, n°88-10.881).
Cette mécanique délicate exige un examen minutieux des liens entre les actes procéduraux. Un avocat pourra déterminer si l’annulation d’un acte menace l’ensemble de votre stratégie procédurale ou permet, au contraire, de préserver certains acquis.
Parce que la nullité d’un acte de procédure constitue un terrain miné où s’entremêlent principes théoriques et applications pragmatiques, nos avocats procéduralistes peuvent analyser votre dossier et identifier les risques ou opportunités liés à une éventuelle nullité. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation approfondie.
Sources
- Code de procédure civile, articles 112 à 121
- Code civil, article 2241 alinéa 2 (issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008)
- Civ. 2ème, 7 juin 2012, n°11-30.272
- Civ. 1ère, 16 décembre 2015, n°15-14.273
- Civ. 2ème, 19 février 2015, n°14-10.622
- Civ. 3ème, 11 mars 2015, n°14-15.198
- Com. 6 octobre 2009, n°08-15.154
- Civ. 1ère, 5 décembre 1973, n°72-12.577
- Civ. 2ème, 15 avril 2010, n°09-10.239
- Civ. 2ème, 11 octobre 1989, n°88-10.881