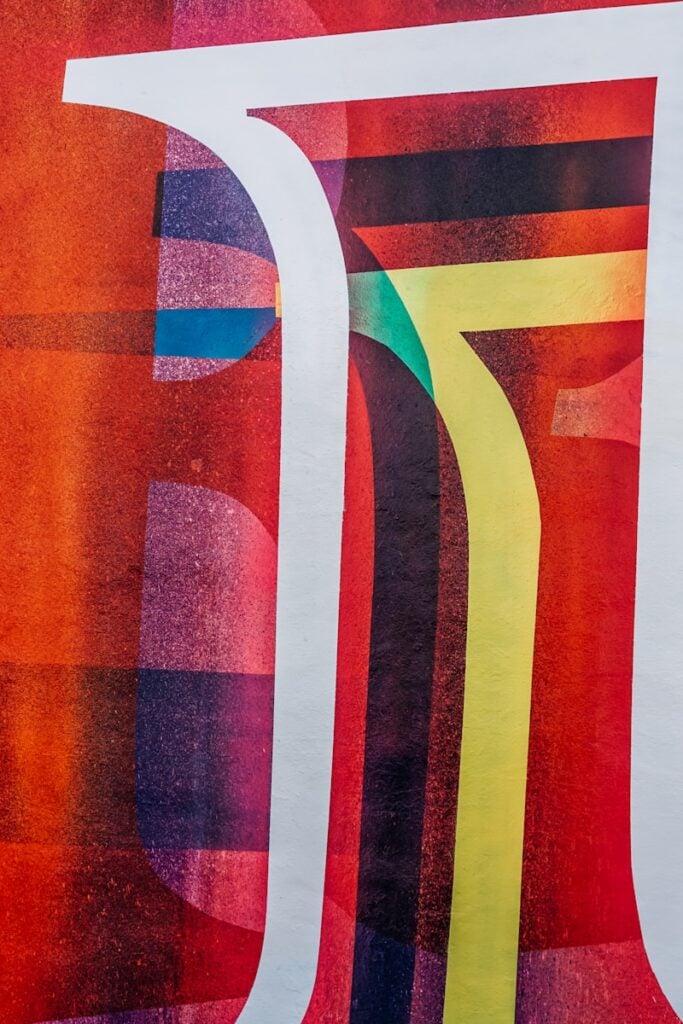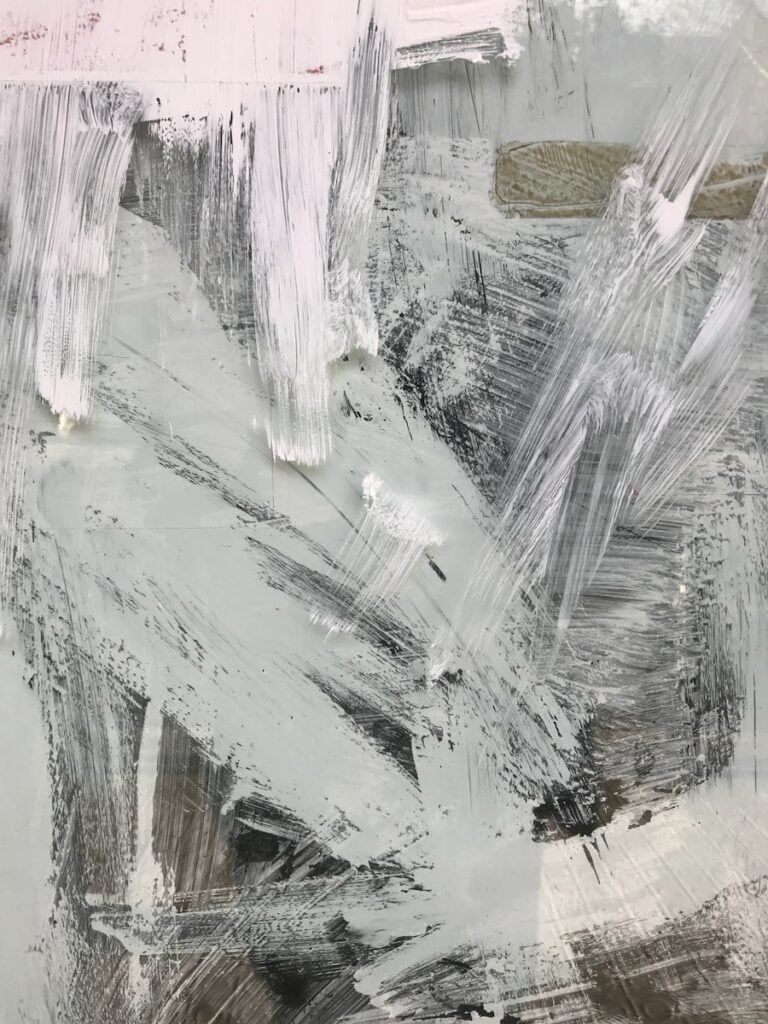« `html
Lorsqu’une entreprise navigue en eaux troubles, confrontée à des vents contraires – qu’il s’agisse de difficultés économiques, de litiges importants ou de tensions financières –, l’instinct peut être d’attendre, espérant une accalmie. Pourtant, attendre que la situation atteigne le point critique de la cessation des paiements n’est pas toujours la seule issue. Le droit français propose un mécanisme conçu spécifiquement pour les entreprises qui anticipent la tempête : la procédure de sauvegarde.
Introduite en 2005, cette procédure judiciaire vise à offrir un cadre protecteur aux entreprises qui, bien que rencontrant des difficultés sérieuses qu’elles ne parviennent pas à surmonter seules, ne sont pas encore en état de cessation des paiements. C’est une démarche volontaire, une sorte de main tendue par la loi pour permettre une réorganisation avant qu’il ne soit trop tard. Cet article se propose d’explorer en détail le fonctionnement de la procédure de sauvegarde : quelles sont ses conditions d’accès très spécifiques, quels objectifs poursuit-elle, et en quoi peut-elle constituer une option stratégique pour un dirigeant prévoyant ?
Qu’est-ce que la procédure de sauvegarde ?
L’objectif fondamental de la sauvegarde est clairement énoncé par l’article L. 620-1 du Code de commerce : elle est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Contrairement au redressement ou à la liquidation judiciaires qui interviennent une fois la crise de trésorerie avérée (la cessation des paiements), la sauvegarde se positionne en amont.
Son caractère principal est d’être une démarche volontaire. Seul le débiteur – que ce soit le chef d’entreprise personne physique ou le représentant légal d’une personne morale – peut en demander l’ouverture au tribunal compétent (Tribunal de commerce pour une activité commerciale ou artisanale, Tribunal judiciaire pour une activité civile, agricole ou libérale). Ni un créancier, ni le ministère public ne peuvent l’initier. Cette exclusivité souligne la philosophie de la procédure : inciter le dirigeant à agir de lui-même, de manière responsable et anticipée, dès l’apparition de difficultés significatives.
En sollicitant la sauvegarde, l’entreprise se place sous la protection du tribunal. Cela entraîne des effets immédiats importants, notamment le gel des dettes antérieures au jugement d’ouverture et la suspension des poursuites individuelles des créanciers. L’entreprise bénéficie ainsi d’un répit pour élaborer, sous la supervision des organes désignés par le tribunal (juge-commissaire, mandataire judiciaire et éventuellement administrateur judiciaire), un plan de sauvegarde visant à restructurer ses dettes et à assurer sa pérennité.
Quelles sont les conditions pour ouvrir une sauvegarde ?
L’accès à la sauvegarde est conditionné par des critères stricts, définis à l’article L. 620-1 du Code de commerce, qui la distinguent nettement des autres procédures.
L’absence impérative de cessation des paiements
C’est la condition négative cardinale : pour bénéficier d’une sauvegarde, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements. Rappelons que la cessation des paiements est l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible (ses dettes arrivées à échéance) avec son actif disponible (ses liquidités immédiates ou mobilisables à très court terme).
Cette absence de cessation des paiements doit être vérifiée par le tribunal au jour où il statue sur la demande d’ouverture. C’est une différence majeure avec :
- Le redressement et la liquidation judiciaires, qui exigent la cessation des paiements.
- La procédure de conciliation (une mesure amiable et confidentielle), qui peut être ouverte même si une cessation des paiements existe, à condition qu’elle date de moins de 45 jours.
C’est au débiteur qui demande la sauvegarde d’apporter les éléments justifiant qu’il n’est pas dans cette situation critique. Il doit démontrer qu’il est encore capable d’honorer ses dettes échues avec sa trésorerie disponible et ses éventuelles réserves de crédit confirmées.
Justifier de « difficultés insurmontables »
Outre l’absence de cessation des paiements, le débiteur doit prouver l’existence de « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». C’est la condition positive.
La nature de ces difficultés n’est pas limitée par la loi. Elles peuvent être :
- Économiques : Baisse importante du chiffre d’affaires, perte d’un marché essentiel, rupture d’approvisionnement…
- Financières : Difficultés à obtenir des financements, endettement croissant même s’il est encore couvert par l’actif disponible, besoin de restructurer des dettes importantes à venir…
- Juridiques : Un litige majeur dont l’issue défavorable pourrait déstabiliser l’entreprise, des contraintes réglementaires nouvelles et coûteuses…
- Sociales : Des tensions internes importantes impactant l’activité…
L’élément clé est le caractère insurmontable de ces difficultés par le débiteur seul. Cela signifie que sans l’aide du cadre protecteur de la sauvegarde (suspension des poursuites, possibilité d’imposer des délais ou remises dans le plan), l’entreprise ne parviendrait pas à résoudre ces problèmes et risquerait, à terme, de tomber en cessation des paiements.
Initialement, la loi exigeait de prouver que ces difficultés étaient de nature à conduire à la cessation des paiements. Cette exigence a été supprimée en 2008 pour assouplir l’accès à la procédure. Aujourd’hui, il suffit de démontrer la réalité des difficultés et l’incapacité à les surmonter sans aide extérieure. Le tribunal apprécie souverainement, au cas par cas, si ces conditions sont remplies, en se basant sur les documents fournis par le débiteur (situation de trésorerie, compte de résultat prévisionnel, état des dettes…).
Il est important de noter que, pour une société, ces difficultés sont appréciées au niveau de la société elle-même, indépendamment de la richesse de ses associés ou de l’appartenance à un groupe financièrement solide. Le principe d’autonomie des personnes morales prévaut. Une société filiale en difficulté peut donc demander une sauvegarde même si sa société mère est prospère (sauf cas de confusion des patrimoines avérée).
Si le tribunal estime que les difficultés existent mais ne sont pas insurmontables au sens de la loi sur la sauvegarde, il peut, depuis une modification de 2016 (article L. 621-1, al. 3), inviter le débiteur à se tourner vers une procédure de conciliation, plus adaptée à des difficultés moins critiques ou nécessitant une négociation confidentielle avec les principaux créanciers.
Quand les difficultés sont-elles appréciées ?
Comme pour la cessation des paiements, la jurisprudence est claire : les conditions d’ouverture de la sauvegarde (absence de cessation des paiements et difficultés insurmontables) doivent être réunies au jour où le tribunal rend sa décision. Si la situation de l’entreprise évolue entre le dépôt de la demande et le jugement, c’est la situation au jour du jugement qui compte. En cas d’appel d’un jugement ayant ouvert la sauvegarde, la cour d’appel se placera également à la date du jugement de première instance pour vérifier si les conditions étaient remplies à ce moment-là.
La sauvegarde comme outil de gestion stratégique ?
La relative souplesse des conditions d’ouverture, notamment la suppression du lien direct exigé avec une future cessation des paiements, a pu susciter des débats. Certains ont craint que la sauvegarde ne soit utilisée par des entreprises non pas pour surmonter de réelles difficultés menaçant leur survie, mais comme un moyen stratégique de se délier d’obligations contractuelles jugées trop lourdes (renégocier un bail commercial, sortir d’un contrat de franchise coûteux, etc.).
L’affaire dite « Cœur Défense » a illustré ce débat il y a quelques années. La Cour de cassation (dans un arrêt du 8 mars 2011, n° 10-13.988 et suivants, rendu sous l’empire de l’ancien texte) a finalement estimé que si les conditions légales d’ouverture sont objectivement réunies (difficultés réelles et insurmontables, absence de cessation des paiements), le tribunal doit ouvrir la procédure, quels que soient les mobiles du débiteur ou les conséquences sur ses contrats. Le juge n’a pas à opérer un contrôle d’opportunité ou à juger des intentions du dirigeant, dès lors que la loi est respectée.
Cependant, cette approche trouve sa limite dans la fraude. Si le tribunal décèle que la demande de sauvegarde est manifestement abusive, détournée de sa finalité légale et motivée par une intention frauduleuse (par exemple, protéger artificiellement les intérêts d’une autre entité), il pourrait rejeter la demande. L’équilibre reste délicat entre l’outil de prévention et le risque d’instrumentalisation. Toutefois, les statistiques montrent que la sauvegarde reste une procédure relativement peu utilisée, ce qui tend à indiquer que les craintes d’un détournement massif ne se sont pas concrétisées.
Et si la situation se dégrade ? La conversion de la sauvegarde
La sauvegarde n’est pas une garantie absolue de succès. La situation de l’entreprise peut continuer à se détériorer pendant la période d’observation (la période initiale ouverte par le jugement, généralement de 6 mois renouvelables, pendant laquelle le plan est préparé). La loi prévoit alors des mécanismes de « conversion » de la procédure vers un régime plus adapté à la nouvelle situation.
Si la cessation des paiements préexistait (erreur d’appréciation initiale)
Il peut arriver que le tribunal, au moment d’ouvrir la sauvegarde, se soit trompé et que l’entreprise était en réalité déjà en cessation des paiements. Si cette situation est révélée après coup, le tribunal peut, sur demande du débiteur, de l’administrateur (s’il y en a un), du mandataire judiciaire ou du ministère public, convertir la sauvegarde en redressement judiciaire ou directement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible (article L. 621-12 C. com.).
Si la cessation des paiements apparaît pendant la sauvegarde
Même si l’entreprise n’était pas en cessation des paiements à l’ouverture, elle peut le devenir au cours de la période d’observation, par exemple en accumulant de nouvelles dettes qu’elle ne peut payer (les dettes nées après le jugement d’ouverture doivent en principe être payées à leur échéance). Dans ce cas, l’article L. 622-10, alinéa 2 du Code de commerce permet également au tribunal, saisi par les mêmes acteurs (débiteur, administrateur, mandataire, MP), de prononcer la conversion en redressement ou en liquidation judiciaire.
Si l’adoption d’un plan de sauvegarde est impossible
Parfois, même sans cessation des paiements immédiate, il devient évident au cours de la période d’observation qu’aucun plan de sauvegarde viable ne pourra être adopté (désaccord profond avec les créanciers, absence de perspectives de redressement…). Si, dans ce cas, la simple clôture de la sauvegarde conduirait « de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements », le tribunal peut alors décider de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire (article L. 622-10, al. 3). Cette disposition permet notamment d’envisager un plan de cession de l’entreprise, solution possible en redressement mais pas en sauvegarde.
Conséquences de la conversion
La conversion n’est pas l’ouverture d’une nouvelle procédure. La procédure initialement ouverte se poursuit, mais sous un régime différent (redressement ou liquidation). Les principaux effets sont :
- Le tribunal doit (ou peut) fixer la date de cessation des paiements.
- Les délais, notamment pour la déclaration des créances, ne sont pas rouverts. Les créanciers qui étaient forclos le restent.
- La mission des organes peut être adaptée (par exemple, l’administrateur judiciaire peut se voir confier une mission de représentation en redressement, impossible en sauvegarde).
- Les règles propres au nouveau régime s’appliquent (par exemple, possibilité d’un plan de cession en redressement).
Un cas particulier : la sauvegarde accélérée
À côté de la sauvegarde « classique », il existe une procédure plus rapide : la sauvegarde accélérée (articles L. 628-1 et suivants C. com.). Issue d’une réforme de 2021 transposant une directive européenne, elle fusionne les anciennes « sauvegarde accélérée » et « sauvegarde financière accélérée » (SFA).
Son objectif est de permettre une restructuration très rapide pour les entreprises qui ont déjà bien avancé dans la négociation avec leurs créanciers dans le cadre d’une procédure de conciliation préalable.
Conditions d’accès
Pour demander une sauvegarde accélérée, le débiteur doit :
- Être (ou avoir été très récemment) en procédure de conciliation.
- Justifier de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde suffisamment avancé et susceptible de recueillir un soutien large des créanciers concernés (« parties affectées »). Le rapport du conciliateur est ici essentiel.
- Avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
Point notable : contrairement à la sauvegarde classique, la sauvegarde accélérée peut être ouverte même si le débiteur est en cessation des paiements, à condition que celle-ci ne soit pas antérieure de plus de 45 jours à la date de la demande d’ouverture de la conciliation préalable. Ce n’est donc pas une procédure purement préventive, mais plutôt un outil de finalisation rapide d’une restructuration négociée. La constitution de classes de parties affectées (regroupements de créanciers et éventuellement d’associés selon leurs droits) est obligatoire pour voter le plan. Il est aussi possible de limiter la procédure aux seuls créanciers financiers (banques, fonds…), reprenant l’esprit de l’ancienne SFA.
Ouverture et déroulement rapide
Le tribunal statue sur l’ouverture après rapport du conciliateur. La procédure est ensuite très courte : le plan doit être adopté dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, prorogeable une seule fois pour une durée maximale de deux mois supplémentaires (soit 4 mois maximum au total).
Anticiper est souvent la clé pour préserver l’avenir de son entreprise. La procédure de sauvegarde, bien que judiciaire, est conçue dans cet esprit. Si votre entreprise fait face à des difficultés sérieuses mais gérables, évaluer l’option de la sauvegarde pourrait être judicieux. Notre équipe se tient à votre disposition pour analyser votre situation et vous conseiller sur la pertinence de cette démarche.
Sources
- Code de commerce (Articles L. 620-1 et s., L. 621-12, L. 622-10, L. 628-1 et s.).
- Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive (pour le contexte de la sauvegarde accélérée).
« `