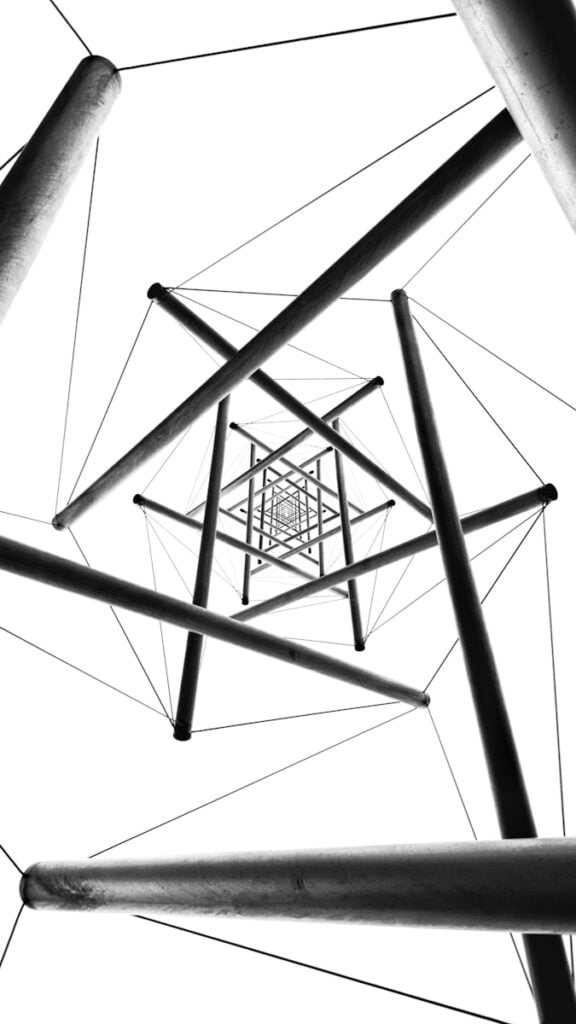Quand le tribunal désigne un expert, une mécanique juridique précise se met en marche pour déterminer sa rémunération. Ce système protège les parties tout en garantissant que l’expert reçoit une juste compensation pour ses travaux.
L’interdiction du paiement direct
L’expert judiciaire ne peut recevoir directement son paiement des parties. L’article 248 du Code de procédure civile établit cette règle fondamentale : l’expert, mandataire de justice, ne reçoit paiement que de la partie désignée par le juge et uniquement pour le montant fixé.
Cette interdiction s’étend même aux simples remboursements de débours. Toute violation pourrait remettre en question l’impartialité de l’expert.
Des exceptions existent pour les constatations (article 251 du CPC) et consultations (article 258 du CPC), mesures d’instruction simples qui échappent au régime de consignation.
Le rôle central du juge
Le juge qui désigne l’expert exerce un contrôle total sur sa mission. Selon les articles 232 et suivants du Code de procédure civile, il fixe les délais, traite les difficultés rencontrées et gère les incidents. Toute décision concernant provisions et honoraires relève de sa compétence exclusive.
Les provisions et leur fonctionnement
Au moment de nommer l’expert, le juge fixe une provision aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible (article 269 du CPC). Il désigne la partie qui doit consigner cette somme au greffe dans un délai déterminé.
Si plusieurs parties sont responsables, le juge précise la proportion pour chacune. Il peut aussi échelonner les échéances de consignation.
Le non-respect du délai de consignation rend caduque la décision d’expertise. Toutefois, le juge peut, sur demande motivée, proroger ce délai ou relever la caducité.
Acomptes et provisions complémentaires
Durant l’expertise, l’expert peut demander un acompte si la complexité de l’affaire l’exige. L’article 280 du CPC autorise le juge à permettre un prélèvement sur la consignation pour couvrir certaines dépenses indispensables.
En pratique, l’option la plus courante reste la consignation d’une provision complémentaire. L’expert adresse au juge une demande motivée expliquant l’avancement de ses travaux et les difficultés rencontrées. Le juge taxateur statue librement sur cette demande, quelle que soit l’autorité ayant fixé la provision initiale.
Cette provision supplémentaire devient nécessaire quand elle conditionne la poursuite technique des opérations, comme pour des travaux de déblaiement ou de désamiantage (Civ. 2e, 16 mai 2013, n° 11-28.060).
L’ordonnance de taxe : une procédure spécifique
La fixation des honoraires des experts échappe au régime général de vérification des dépens. L’article 284 du CPC confie cette mission au juge qui a désigné l’expert.
L’expert joint à son rapport sa demande de rémunération, dont il envoie copie aux parties. Celles-ci disposent de 15 jours pour transmettre leurs observations écrites à l’expert et au tribunal.
Le juge ne peut fixer la rémunération qu’après l’exécution complète de la mission. Un simple pré-rapport contenant des conclusions provisoires ne suffit pas (Civ. 2e, 15 avril 2010, n° 08-21.832).
L’article 284 du CPC précise les critères d’évaluation : diligences accomplies, respect des délais et qualité du travail fourni. Le juge doit répondre aux contestations portant sur ces éléments (Civ. 2e, 2 février 2017, n° 16-13.224).
Une appréciation souveraine
Les barèmes professionnels auxquels se réfèrent certains experts n’ont qu’une valeur indicative pour le juge. La jurisprudence affirme constamment que la fixation de la rémunération des techniciens relève de l’appréciation souveraine du magistrat (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-17.910).
Le juge peut considérer la notoriété de l’expert, la complexité de la mission, mais doit veiller à ce que la rémunération reste proportionnée à la tâche effectuée.
Il n’est pas tenu de limiter la rémunération définitive au montant de la provision consignée (Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-25.551), ni de se référer à une estimation préalable communiquée par l’expert (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-11.230).
Une possible réduction de la rémunération
Le juge peut réduire les honoraires demandés en cas de:
- Manque de célérité (Civ. 2e, 27 avril 1979, n° 77-15.312)
- Faiblesses du rapport (Civ. 2e, 24 octobre 1979, n° 77-15.604)
- Travaux non demandés et inutiles (Civ. 2e, 6 juillet 2000, n° 98-18.119)
- Tarif horaire excessif pour des tâches simples (Civ. 2e, 22 mars 2007, n° 06-11.770)
Avant de réduire la rémunération, l’article 284 du CPC impose au juge d’inviter l’expert à formuler ses observations, obligation impérative (Civ. 2e, 20 mai 1992, n° 90-17.857).
Une voie de recours spécifique
L’article 724 du CPC prévoit un recours unique contre la décision fixant la rémunération de l’expert : l’appel devant le premier président de la cour d’appel.
Ce recours ne peut concerner que la rémunération définitive, à l’exclusion des décisions fixant les provisions. Il peut porter aussi sur la répartition de la charge entre les parties (Civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 13-10.655).
Le délai d’un mois court, pour chaque partie, à partir de la notification de l’ordonnance, et pour l’expert, à partir de la notification par le greffe (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-14.644).
Contrairement au droit commun de la taxe des dépens, ce recours n’est pas suspensif (article 724 du CPC). L’ordonnance de taxe bénéficie donc de l’exécution provisoire de droit.
Une particularité : si c’est le premier président qui a taxé le mémoire du technicien, le recours s’exerce devant lui-même, s’apparentant alors à une demande de révision.
Ces règles précises sécurisent la rémunération des experts tout en offrant aux parties des garanties contre d’éventuels excès. Pour maximiser vos chances dans ce type de procédure, n’hésitez pas à consulter notre cabinet. Nous vous aiderons à apprécier le caractère raisonnable des honoraires réclamés et à formuler, le cas échéant, une contestation étayée.
Sources
- Code de procédure civile : articles 232 et suivants, 248, 251, 258, 269, 280, 284 et 724
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 avril 2010, n° 08-21.832
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 mai 2013, n° 11-28.060
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 février 2017, n° 16-13.224
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 juin 2013, n° 12-17.910
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 mai 2021, n° 19-25.551
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 septembre 2006, n° 05-11.230
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 avril 1979, n° 77-15.312
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 octobre 1979, n° 77-15.604
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 juillet 2000, n° 98-18.119
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 mars 2007, n° 06-11.770
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 mai 1992, n° 90-17.857
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 janvier 2014, n° 13-10.655
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-14.644