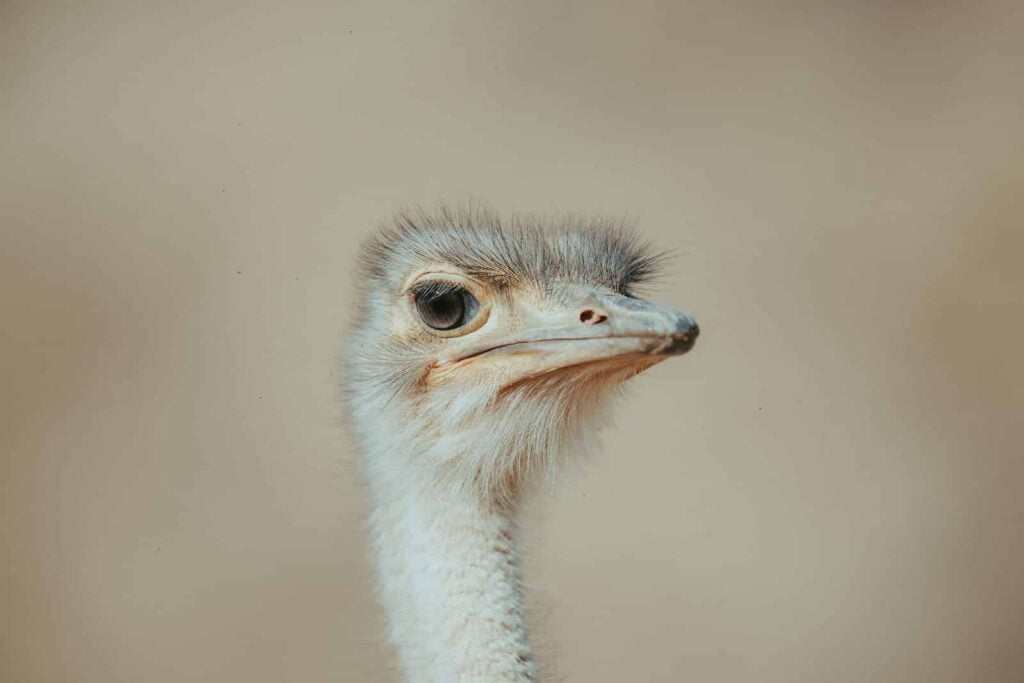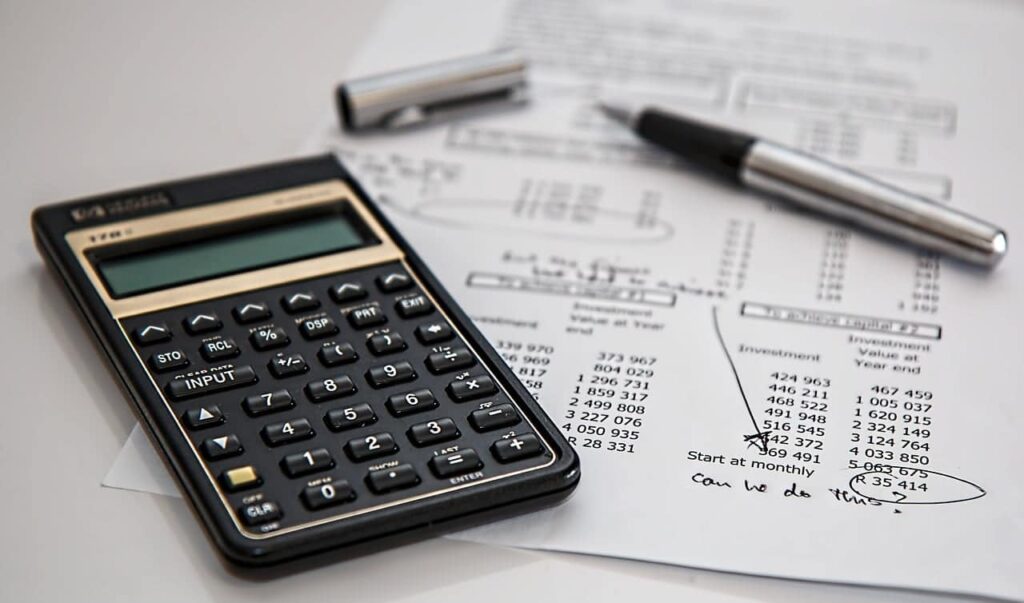Dans le monde parfois opaque du recouvrement de créances, certains outils juridiques se révèlent plus efficaces que d’autres. La sommation aux fins d’exécution appartient à cette catégorie d’actes qui, bien que méconnus du grand public, constituent un levier puissant pour inciter un débiteur à s’exécuter volontairement.
Qu’est-ce qu’une sommation aux fins d’exécution ?
Définition et nature juridique
La sommation aux fins d’exécution est un acte extrajudiciaire signifié par huissier de justice. Son objectif : enjoindre à un débiteur d’exécuter une obligation. Comme le définit le Vocabulaire juridique du doyen Cornu, il s’agit d’une « invitation comminatoire » – comprendre par là une demande assortie d’une menace implicite de poursuites.
Dans sa forme moderne, cet acte constitue l’héritier direct de pratiques juridiques anciennes. Des documents historiques attestent de son utilisation dès l’Ancien Régime, tant dans les provinces de droit écrit que coutumières.
Distinction avec la mise en demeure
Ne confondons pas sommation et mise en demeure. La mise en demeure est un concept plus large qui englobe plusieurs actes dont la sommation. L’article 1344 du Code civil précise : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
La sommation représente donc une forme particulière de mise en demeure, celle réalisée par acte d’huissier.
Différence avec le commandement
La distinction entre sommation et commandement s’avère plus subtile. Le commandement est également un acte d’huissier visant l’exécution d’une obligation. Toutefois, à la différence de la sommation, il s’inscrit généralement dans une procédure d’exécution forcée.
Le commandement constitue souvent un préalable direct à une saisie ou une expulsion. Comme l’a précisé la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 déc. 1998, n°96-18.255), il « engage » l’exécution au sens procédural, justifiant ainsi la compétence du juge de l’exécution en cas de contestation.
Les domaines d’application
Applications générales
Sommation du débiteur
La sommation peut intervenir chaque fois qu’une mise en demeure s’avère nécessaire envers un débiteur (articles 1344 et suivants du Code civil). Elle devient inutile lorsque l’inexécution contractuelle est irréversible – ce que l’article 1231 du Code civil qualifie d' »inexécution définitive ».
Sommation du créancier
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a introduit un mécanisme novateur : la mise en demeure du créancier. Prévue aux articles 1345 et suivants du Code civil, elle permet au débiteur d’interpeller un créancier qui, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû.
Cette inversion des rôles traditionnels offre une protection au débiteur de bonne foi confronté à un créancier récalcitrant.
Applications spéciales
Des textes spécifiques imposent parfois le recours à une sommation. Par exemple :
- En droit des successions, l’article 771 du Code civil permet, quatre mois après l’ouverture d’une succession, de sommer un héritier de prendre parti.
- En droit commercial, l’article L. 141-20 du Code de commerce prévoit qu’un acquéreur peut être sommé par tout créancier de consigner la portion exigible du prix d’un fonds de commerce.
- En procédure pénale, l’article 319 du Code de procédure pénale stipule qu’une sommation peut être faite à un accusé qui refuse de comparaître.
Les aspects formels de la sommation
Compétence de l’huissier
La sommation doit être signifiée par un huissier de justice ou un clerc assermenté. Sa compétence territoriale se limite au ressort de la cour d’appel, comme le précise l’article 3 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
Rédaction et mentions obligatoires
L’acte doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 648 du Code de procédure civile :
- La date de signification
- Les informations relatives au requérant
- Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier
- Les nom et domicile du destinataire
L’arrêté du 29 juin 2010 impose également d’autres éléments comme le cachet de l’étude, l’image de Marianne ou le sceau de l’étude.
Plus spécifiquement, une sommation aux fins d’exécution doit préciser clairement la volonté du créancier d’obtenir l’exécution et détailler l’obligation réclamée. Pour les obligations financières, un décompte des sommes dues est indispensable.
Modalités de signification
La signification suit les règles classiques des articles 653 et suivants du Code de procédure civile. Elle doit prioritairement être faite à personne (article 654). Ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’elle peut être délivrée à domicile ou à résidence (article 655).
Depuis 2012, la signification électronique est possible, mais uniquement avec l’accord du destinataire (article 662-1).
Coût de la démarche
Le coût de la sommation est encadré par l’article A444-10 du Code de commerce. En principe, il est supporté par le requérant. Deux exceptions existent :
- Lorsque la sommation s’inscrit dans une procédure d’exécution forcée
- Dans le cas d’une sommation visant la mise en demeure du créancier (article 1345-3 du Code civil)
Les effets juridiques de la sommation
Effets psychologiques
La sommation exerce une contrainte comminatoire sur son destinataire. Par la menace de poursuites, elle incite le débiteur à exécuter volontairement son obligation. Cette pression psychologique est accentuée par l’intervention de l’huissier.
Cet effet constitue souvent la principale finalité recherchée par le créancier. Il lui permet d’économiser les frais d’un procès ou d’une exécution forcée.
Effets juridiques communs
Le principal effet juridique commun à toutes les sommations est de constater officiellement l’inexécution. Cet élément probatoire se révèle précieux en cas de litige ultérieur.
Contrairement à une idée reçue, la sommation n’interrompt pas le délai de prescription. La jurisprudence est constante sur ce point (Civ. 3e, 6 mars 1996, n°94-13.212).
Effets juridiques spécifiques
Pour les obligations de sommes d’argent
La sommation fait courir les intérêts moratoires au taux légal (article 1231-6 du Code civil). Ces dommages-intérêts dus en raison du retard sont calculés à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.
Pour les obligations de délivrer
La mise en demeure « met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà » (article 1344-2 du Code civil). Cette règle déroge au principe du transfert des risques lors du transfert de propriété.
Pour la mise en demeure du créancier
Une sommation adressée au créancier produit des effets immédiats : elle arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier (article 1345 du Code civil).
Après un délai de deux mois, des effets différés apparaissent. Le débiteur peut alors consigner la somme à la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrer la chose due, ce qui le libère de son obligation.
La rédaction d’une sommation aux fins d’exécution nécessite une maîtrise technique approfondie. Une erreur dans sa formulation ou sa signification peut la priver de ses effets juridiques les plus importants. Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, en amont comme en aval de la procédure de recouvrement. N’hésitez pas à nous contacter pour un premier échange sur votre situation.
Sources
- Code civil, articles 771, 1196, 1231, 1344, 1344-2, 1345 à 1345-3, 1351-1.
- Code de commerce, articles L. 141-20, L. 143-5, A444-10.
- Code de procédure civile, articles 648, 653 à 662-1.
- Code de procédure pénale, article 319.
- Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers.
- Cour de cassation, Civ. 2e, 16 décembre 1998, n°96-18.255.
- Cour de cassation, Civ. 3e, 6 mars 1996, n°94-13.212.
- G. CORNU, Vocabulaire juridique, 13e éd., 2020, PUF.
- R. LAHER, Répertoire de procédure civile – Sommation, juin 2020, Dalloz.