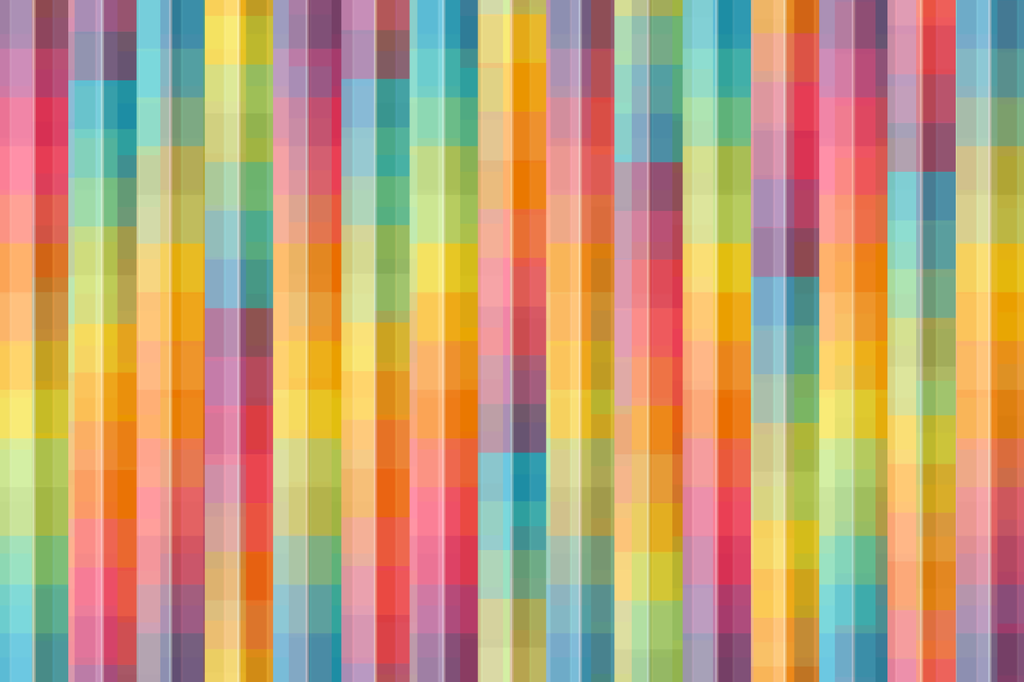Les emprunteurs immobiliers connaissent bien l’assurance crédit emprunteur, souvent perçue comme une simple formalité lors de la souscription d’un prêt. Cette vision s’avère réductrice. Ce contrat complexe mérite une attention particulière, tant durant son exécution qu’au moment de sa résiliation.
Les particularités d’exécution de l’assurance emprunteur
L’assurance emprunteur constitue un montage juridique singulier. Elle repose sur un enchevêtrement de relations contractuelles entre trois acteurs : l’assureur, l’établissement de crédit (souscripteur) et l’emprunteur (adhérent).
Ce triangle contractuel explique la complexité du régime juridique applicable. La Cour de cassation a confirmé l’existence d’un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent, malgré l’intervention du souscripteur (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648).
L’originalité de cette construction ne s’arrête pas là : l’établissement de crédit y joue un double rôle. D’abord souscripteur du contrat groupe, il devient généralement bénéficiaire désigné par l’adhérent en cas de sinistre. Cette particularité rend l’analyse juridique délicate.
Les obligations des parties pendant l’exécution du contrat
Les obligations d’information du souscripteur
L’obligation d’information ne s’arrête pas à la signature du contrat. La jurisprudence a considérablement étendu le champ des obligations du souscripteur au cours de l’exécution du contrat.
Dans un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007, la Cour de cassation a imposé aux banques une véritable obligation de mise en garde : « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » (Cass. ass. plén. 2 mars 2007, n° 06-15.267).
Plus récemment, la chambre commerciale a même considéré que le banquier doit informer l’assuré du caractère abusif d’un refus de garantie opposé par l’assureur (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.866).
Ces obligations connaissent toutefois des limites :
- Le souscripteur n’est pas tenu d’informer l’adhérent sur des éléments sans lien direct avec le contrat
- Sa responsabilité n’est pas engagée s’il ne disposait pas des informations nécessaires
- L’adhérent ne peut invoquer la responsabilité du souscripteur s’il a lui-même fait preuve de déloyauté
Les obligations de l’adhérent
L’adhérent doit respecter son obligation de déclaration du risque avec sincérité. Mentir ou dissimuler des informations médicales peut entraîner la nullité du contrat (article L.113-8 du Code des assurances).
Il doit également s’acquitter du paiement des primes, généralement prélevées avec les échéances du prêt.
La gestion des sinistres
La survenance d’un sinistre constitue un moment critique dans l’exécution du contrat d’assurance emprunteur.
La déclaration du sinistre
Bien que la forme de la déclaration soit libre, la jurisprudence veille à ce que les formalités ne soient pas excessives. La Cour de cassation s’est montrée hostile aux formulaires standards de déclaration imposés par les assureurs (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999).
Ici encore, le souscripteur doit jouer un rôle actif. La jurisprudence lui impose d’informer l’adhérent sur les démarches à accomplir. La Cour de cassation a sanctionné un établissement de crédit qui n’avait pas réclamé à son client un certificat médical pourtant indispensable à la prise en charge (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994).
Le versement de l’indemnité
Conformément à l’article L.113-5 du Code des assurances, c’est à l’assureur – et non au souscripteur – qu’il incombe de régler l’indemnité.
En pratique, le bénéficiaire est généralement l’établissement de crédit. L’assureur se substitue donc à l’emprunteur pour rembourser le solde du prêt, ce qui vaut paiement de la dette et emporte libération de l’emprunteur (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995).
Les modifications contractuelles et leurs limites
La modification du contrat d’assurance emprunteur est strictement encadrée.
Lorsqu’elle concerne le contrat-cadre conclu entre l’assureur et le souscripteur, l’article L.141-4 du Code des assurances impose d’informer les adhérents par écrit. Cette obligation pèse sur le souscripteur, qui doit prouver qu’il l’a respectée.
Attention toutefois : pour les prêts immobiliers, l’article L.312-9 du Code de la consommation prévoit qu’une modification des risques garantis ou des modalités de mise en jeu de l’assurance n’est pas opposable à l’emprunteur qui n’y a pas consenti.
L’évolution du droit de résiliation
Longtemps, les tribunaux ont considéré que l’assurance emprunteur ne pouvait être résiliée avant le terme du prêt. Cette situation, désavantageuse pour les emprunteurs, a connu une évolution progressive.
La loi du 1er juillet 2010
Cette loi a posé le principe selon lequel le prêteur ne peut pas refuser un contrat d’assurance autre que celui qu’il propose, si ce contrat présente un niveau de garantie équivalent.
Cette avancée restait limitée puisqu’elle ne s’appliquait qu’au moment de la souscription du prêt. Une fois le contrat signé, l’emprunteur restait lié.
La loi Hamon du 17 mars 2014
La loi Hamon a introduit une faculté de résiliation pendant les 12 mois suivant la signature du contrat (article L.113-12-2 du Code des assurances). Un petit pas, mais encore insuffisant.
La Cour de cassation s’est d’ailleurs montrée réticente à étendre cette faculté, comme en témoigne un arrêt du 24 mai 2017 où elle refuse d’y voir un principe général de résiliation annuelle.
La loi du 21 février 2017 (amendement Bourquin)
Cette loi a constitué une avancée majeure en permettant la résiliation annuelle des contrats d’assurance emprunteur. Cette disposition, codifiée à l’article L.313-30 du Code de la consommation, s’applique à tous les contrats en cours depuis le 1er janvier 2018.
Les conditions actuelles de résiliation par l’emprunteur
Aujourd’hui, un emprunteur peut résilier son contrat d’assurance à trois moments :
- Dans les 12 mois suivant la signature (loi Hamon)
- À chaque date anniversaire du contrat (amendement Bourquin)
- À tout moment pendant la première année pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 2022 (loi Lemoine)
La procédure à suivre est stricte :
- Trouver un nouveau contrat présentant des garanties équivalentes
- Adresser une lettre de résiliation à l’assureur actuel
- Respecter un préavis de 15 jours si la résiliation intervient dans la première année, ou de deux mois à partir de la deuxième année
Le prêteur dispose de 10 jours ouvrés pour accepter ou refuser la substitution. Tout refus doit être motivé.
Le changement d’assurance représente souvent un enjeu financier considérable. Une étude récente du courtier Magnolia.fr évoque des économies moyennes de 15 000 € sur la durée totale d’un prêt immobilier.
Notre cabinet accompagne régulièrement des clients pour sécuriser leur changement d’assurance emprunteur. N’hésitez pas à nous consulter pour évaluer votre situation et vous guider dans ce processus délicat. Un rendez-vous préalable peut éviter bien des écueils et garantir le succès de votre démarche.
Sources
- Code des assurances, articles L.113-5, L.113-8, L.141-1 à L.141-4
- Code de la consommation, articles L.312-9, L.313-30
- Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648
- Cass. ass. plén. 2 mars 2007, n° 06-15.267
- Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-15.866
- Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon)
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (amendement Bourquin)
- Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (loi Lemoine)