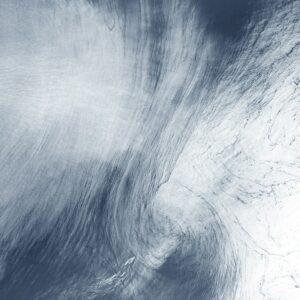Dans l’arène du commerce international, chaque transaction s’accompagne d’une multitude de risques. L’éloignement des partenaires commerciaux, l’instabilité politique de certaines régions, la volatilité des monnaies et l’insolvabilité potentielle des débiteurs constituent des obstacles majeurs pour les entreprises exportatrices. Ces incertitudes peuvent transformer une opportunité commerciale prometteuse en cauchemar financier. L’assurance-crédit export s’est imposée comme la réponse à ces défis.
Les organismes d’assurance-crédit en droit comparé
Le panorama mondial des organismes d’assurance-crédit révèle deux modèles dominants.
Le premier modèle regroupe les pays où une institution unique gère à la fois le financement et la garantie des opérations d’exportation. Aux États-Unis, l’Eximbank (Export-Import Bank of the United States) illustre parfaitement cette approche intégrée. Le Royaume-Uni a opté pour l’ECGD (Export Credit Guarantee Department), le Canada pour l’EDC (Exportation et Développement Canada) et l’Australie pour l’EFIC (Export Finance et Insurance Corporation).
Le second modèle comprend les pays dotés d’organismes spécialisés qui délivrent des assurances-crédit pour le compte de l’État. L’Allemagne s’appuie sur le consortium Hermes-Treuearbeit, la Belgique sur l’Office National du Ducroire (OND), l’Espagne sur la CESCE (Compania Espanola de Seguros de Crédito a la exportacion) et l’Italie sur la SACE (Sezione speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione).
Cette différence structurelle n’est pas anodine. Elle reflète des choix stratégiques nationaux et des traditions administratives variées.
Le système français et le rôle de la COFACE
La France s’inscrit dans le second modèle, avec la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) comme acteur central. Cette institution délivre des polices d’assurance pour le compte de l’État français.
La décision d’octroyer une garantie relève du Directeur des Relations Économiques Extérieures (DREE), après consultation de la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, comme le précise l’article L.432-3 du Code des assurances.
La particularité du système français réside dans sa démarche collégiale. La « Commission des garanties » réunit plusieurs ministères pour examiner les demandes de couverture. Cette approche interministérielle permet d’évaluer non seulement les aspects financiers, mais aussi les implications diplomatiques et stratégiques des opérations d’exportation.
L’assurance-crédit à moyen et long terme
Types de polices et risques couverts
La COFACE propose des polices individuelles aux exportateurs (pour les crédits fournisseurs) et aux banques (pour les crédits acheteurs). Ces polices couvrent quatre catégories de risques :
- Le risque commercial : défaillance financière de l’acheteur
- Le risque politique strict : confiscation, nationalisation, embargo
- Le risque de non-transfert : impossibilité de rapatrier les fonds
- Le risque catastrophique : guerres, révolutions, catastrophes naturelles
Pour les crédits acheteurs, la COFACE propose des polices de type « PR » pour les emprunteurs privés et « SP » pour les emprunteurs publics. Cette distinction permet d’adapter la couverture à la nature juridique du débiteur et aux risques spécifiques qui en découlent.
Quotités garanties selon les opérations
La COFACE ne couvre jamais 100% des risques, à la différence de certains organismes étrangers comme l’Eximbank américaine. Cette politique de « ticket modérateur » vise à responsabiliser les opérateurs économiques.
Les quotités garanties varient selon le type d’opération :
- Pour les crédits acheteurs avec soutien financier public : 95% maximum
- Pour les crédits financiers d’accompagnement : 90% maximum
- Pour les crédits fournisseurs face à des risques politiques : 90%
- Pour les crédits fournisseurs face à des risques commerciaux : 85% (90% si la créance est couverte par une garantie bancaire)
Une exception notable existe pour les financements d’appareils Airbus. Dans ce cas particulier, la COFACE peut délivrer une garantie à 100%, conjointement avec l’assureur-crédit allemand Euler Hermès et l’ECGD britannique.
Mais les chiffres ne disent pas tout. Un exportateur doit comprendre que ces pourcentages non couverts représentent un risque réel pour sa trésorerie.
Les polices complémentaires et risques spécifiques
Le commerce international génère des risques spécifiques à chaque phase d’une opération d’exportation. La COFACE a développé des polices complémentaires pour y répondre.
Pendant la période de fabrication, l’exportateur peut voir l’opération échouer si l’acheteur ne verse pas les acomptes prévus ou si le crédit acheteur n’entre pas en vigueur. Une police spécifique couvre ce risque d’interruption.
Le risque de change constitue un autre péril. Entre l’offre de prix et la conclusion du contrat, les fluctuations monétaires peuvent réduire drastiquement la rentabilité d’une opération. La COFACE gère des polices qui protègent contre ces variations imprévisibles.
Les banques ne sont pas en reste. Dans les crédits acheteurs sans stabilisation, elles subissent un risque de taux entre l’offre de crédit et la signature du contrat. La COFACE peut couvrir ce risque en compensant l’écart entre le coût de refinancement à la date de l’offre et celui à la date de signature.
Ces polices complémentaires ne sont pas des options superflues. Elles répondent à des besoins concrets et peuvent sauver une entreprise exportatrice d’un désastre financier.
Considérations pratiques pour les exportateurs
L’assurance-crédit export n’est pas un simple produit financier. C’est un outil stratégique qui mérite une approche proactive.
Les exportateurs doivent anticiper leurs besoins de couverture dès la phase de prospection. Une demande tardive peut compromettre l’ensemble de l’opération.
L’évaluation des risques nécessite une connaissance approfondie du pays importateur. La classification des pays par l’OCDE en huit catégories de risque influence directement les primes d’assurance. Un exportateur averti intègre ce paramètre dans ses calculs de rentabilité.
La négociation contractuelle avec l’acheteur étranger doit prévoir des clauses de paiement compatibles avec les exigences des assureurs-crédit. Une clause de paiement mal rédigée peut disqualifier l’opération pour certaines couvertures.
Enfin, la dimension européenne ne doit pas être négligée. La directive 84/568 du 27 novembre 1984 encourage la collaboration entre assureurs-crédit européens pour les opérations impliquant des sous-traitants d’autres pays membres.
La complexité de ces mécanismes justifie un accompagnement juridique spécialisé. L’analyse des contrats, la structuration des opérations et la négociation des polices d’assurance requièrent une expertise que seul un avocat spécialisé peut apporter.
Notre cabinet accompagne les exportateurs dans cette jungle réglementaire. Contactez-nous avant d’entamer vos démarches d’exportation. Nous transformerons ces contraintes en opportunités pour votre développement international.
Sources
- Code des assurances, article L.432-3 relatif à la Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur
- G. Barral, L’assurance des crédits à l’exportation, Nathan, 1987
- M. Noinville, La COFACE, Dunod, 1993
- G. Bourdeaux, Le crédit acheteur international. Approche française et comparative, Economica, 1995
- Arrangement OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (dernière version entrée en vigueur le 1er juillet 2007)
- Directive européenne 84/568 du 27 novembre 1984 concernant la collaboration entre assureurs-crédit européens