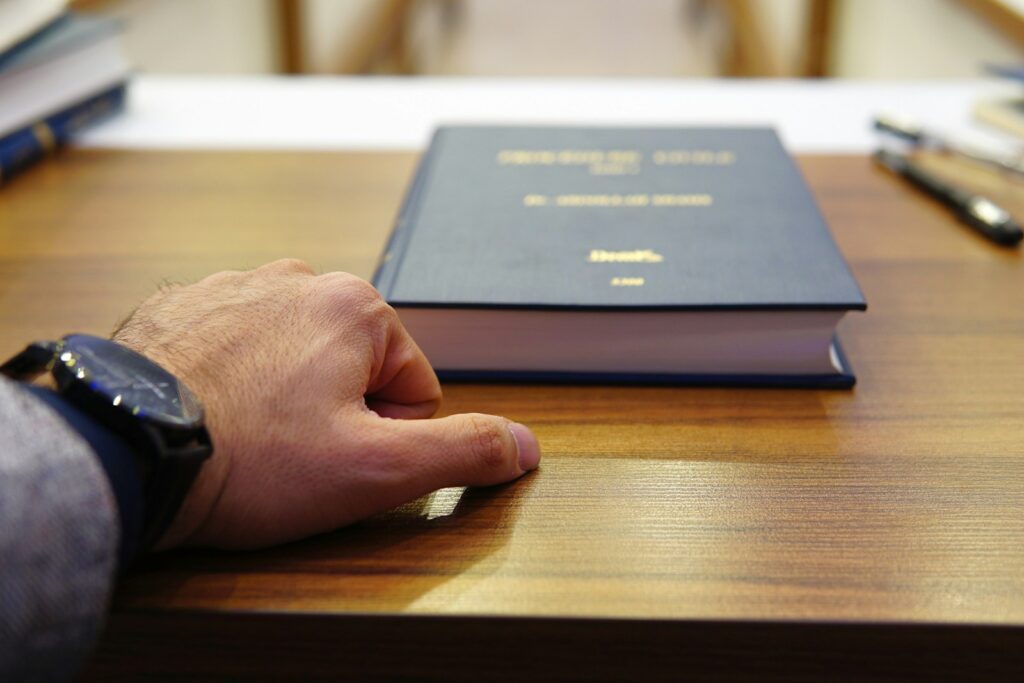Moins connu que l’emprunt bancaire classique ou l’émission d’actions, le bon de caisse représente pourtant un instrument financier qui peut s’avérer pertinent tant pour les entreprises cherchant à diversifier leurs sources de financement que pour les épargnants en quête de placements. Cet outil, encadré par des règles spécifiques, mérite une attention particulière.
Mais qu’est-ce qu’un bon de caisse exactement ? Depuis une réforme intervenue en 2016, il s’agit d’un titre obligatoirement nominatif (émis au nom d’une personne désignée) et non négociable sur un marché. Concrètement, il matérialise un engagement pris par un commerçant (l’émetteur) de rembourser une somme d’argent à une échéance déterminée, somme qui lui a été prêtée par le souscripteur du bon. C’est donc la contrepartie d’une opération de prêt.
Pour bien comprendre son fonctionnement et son utilité, il est nécessaire d’explorer sa nature juridique parfois discutée, les conditions de son émission et de sa circulation, ainsi que les règles encadrant son paiement et sa fiscalité.
Quelle est la nature juridique d’un bon de caisse ?
La qualification juridique des bons de caisse a pu prêter à débat par le passé, notamment avant qu’ils ne deviennent exclusivement nominatifs. Il est cependant aujourd’hui admis qu’ils ne constituent pas des valeurs mobilières. Contrairement aux obligations, par exemple, les bons de caisse ne sont pas fongibles : ils ne représentent pas des fractions égales d’une émission globale et ne sont pas destinés à être échangés sur un marché boursier. Chaque bon est émis individuellement, souvent au fil de l’eau, en fonction des besoins de trésorerie de l’émetteur ou des demandes de placement des souscripteurs. Le taux d’intérêt peut également varier d’un bon à l’autre.
De même, assimiler le bon de caisse à un effet de commerce classique, comme une lettre de change ou un billet à ordre, n’est pas pertinent. Même si une certaine jurisprudence a pu y voir des similitudes, notamment lorsque les bons pouvaient être « à ordre », leurs caractéristiques propres les en distinguent. Par exemple, le bon de caisse représente toujours un prêt d’argent, alors que la créance sous-jacente à un effet de commerce peut avoir diverses origines. De plus, le régime juridique spécifique des effets de commerce ne s’applique pas tel quel aux bons de caisse.
Finalement, la qualification la plus juste, confirmée par la jurisprudence, est celle de reconnaissance de dette. Le bon de caisse est avant tout un titre qui constate l’existence d’une dette de l’émetteur envers le souscripteur, née du prêt consenti. Cette qualification n’est pas sans importance. Historiquement, elle a permis de clarifier la situation des sociétés à responsabilité limitée (SARL) qui, bien qu’interdites d’émettre des valeurs mobilières (sauf obligations nominatives sous conditions depuis 2004 ), pouvaient émettre des bons de caisse nominatifs car ceux-ci n’étaient pas considérés comme des valeurs mobilières. La distinction conserve également un intérêt sur le plan fiscal.
Qui peut émettre des bons de caisse et dans quelles conditions ?
L’émission de bons de caisse n’est pas ouverte à tous. Le Code monétaire et financier encadre strictement les émetteurs potentiels et les conditions d’émission.
Les émetteurs autorisés sont limitativement énumérés par la loi. Il s’agit principalement :
- Des établissements de crédit.
- Des personnes physiques ou sociétés ayant la qualité de commerçant et pouvant justifier avoir établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Il est important de noter que les sociétés de financement sont explicitement exclues. L’émission de bons de caisse par les entreprises commerçantes constitue une exception au monopole bancaire concernant la réception de fonds du public.
Conditions de durée et de taux : La durée des bons de caisse est encadrée. Le Code monétaire et financier (article L. 223-3) prévoit qu’ils ne peuvent être souscrits pour une durée inférieure à un mois ni supérieure à cinq ans. Une ordonnance de 2019 avait pu ouvrir la voie à une échéance allant jusqu’à sept ans dans certains contextes liés à la loi PACTE, mais la référence légale actuelle semble maintenir le plafond de cinq ans. Le non-respect de ces durées peut entraîner des sanctions.
Quant au taux d’intérêt, il est en principe librement fixé par les parties lors de la souscription. Naturellement, ce taux ne doit pas être usuraire. Une restriction s’applique toutefois aux établissements de crédit émetteurs, qui sont soumis à la réglementation générale sur la rémunération des dépôts à terme.
Information et transparence : Depuis la réforme de 2016, l’anonymat qui pouvait entourer certains bons de caisse a disparu. La loi impose désormais des obligations de transparence pour protéger le souscripteur :
- Les bons de caisse doivent être inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l’émetteur.
- L’émetteur doit remettre au propriétaire un certificat d’inscription dans ce registre. Les mentions obligatoires de ce certificat sont précisées par décret.
- Lorsque l’émetteur est un commerçant (non établissement de crédit), il doit mettre à la disposition du souscripteur ses derniers comptes annuels certifiés sincères.
Le non-respect de ces conditions, notamment en cas d’offre au public (même si cette notion est moins pertinente depuis que les bons sont nominatifs), peut entraîner la nullité des bons émis et des sanctions pénales, par exemple en cas de fourniture d’un bilan inexact.
Comment circule un bon de caisse ?
Étant désormais exclusivement nominatifs et non négociables sur un marché, les bons de caisse ne circulent plus par simple remise matérielle (tradition) ou endossement comme les anciens titres au porteur ou à ordre.
Leur transmission obéit aux règles de la cession de créance prévues par le Code civil (articles 1321 et suivants, qui ont modernisé l’ancien article 1690). Concrètement, la cession d’un bon de caisse se fait par un écrit entre le cédant (propriétaire actuel) et le cessionnaire (nouveau propriétaire). Cette cession prend effet entre les parties dès la date de l’acte, mais pour être opposable à l’émetteur (le débiteur), elle doit lui être notifiée, ou il doit en avoir pris acte.
Au-delà de la cession classique, les bons de caisse peuvent être impliqués dans d’autres opérations :
- Don manuel : Un bon de caisse peut être donné. Cependant, comme pour tout don manuel, la preuve de l’intention libérale (la volonté de donner gratuitement) peut s’avérer délicate à établir en cas de litige, la simple possession ne suffisant pas toujours. La jurisprudence se montre souvent exigeante sur ce point.
- Nantissement : Un bon de caisse, représentant une créance, peut être donné en garantie d’une autre dette par le biais d’un nantissement de créance. Cette sûreté doit faire l’objet d’un écrit pour être valable et son opposabilité aux tiers (notamment à l’émetteur) dépend des règles propres au nantissement. Des questions spécifiques peuvent surgir, par exemple concernant le sort des intérêts produits par le bon nanti ou lorsque le nantissement porte sur des biens communs d’époux.
Des incidents peuvent également affecter la circulation ou la détention des bons :
- Procédures collectives : Si l’émetteur ou le souscripteur fait l’objet d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), le sort des bons de caisse peut être affecté. Par exemple, un créancier détenant un bon de caisse en nantissement bénéficie d’un droit de rétention puissant qui limite les pouvoirs du juge-commissaire sur ce bon. La revendication des bons par leur propriétaire légitime peut aussi soulever des questions complexes si l’émetteur est en difficulté.
- Perte ou vol : Le caractère nominatif simplifie la situation par rapport aux anciens titres au porteur. Le propriétaire inscrit au registre conserve ses droits même s’il perd le certificat d’inscription, bien que sa reconstitution puisse nécessiter des démarches.
Comment s’effectue le paiement d’un bon de caisse ?
Le paiement marque l’extinction de la dette de l’émetteur. Plusieurs aspects sont à considérer.
Qui paie (solvens) ? C’est logiquement l’émetteur du bon de caisse qui est tenu de rembourser le prêt à l’échéance convenue. Il faut toutefois être vigilant aux fraudes commises par des préposés (employés) d’établissements de crédit qui pourraient émettre de faux bons ou détourner les fonds. La responsabilité de l’établissement peut être engagée si le client a pu légitimement croire traiter avec la banque et si celle-ci a manqué de vigilance, mais elle peut être écartée si les irrégularités étaient manifestes ou si le préposé a agi manifestement en dehors de ses fonctions.
Qui reçoit le paiement (accipiens) ? Le paiement doit être fait au propriétaire légitime du bon, c’est-à-dire la personne dont le nom figure sur le registre de l’émetteur. La complexité qui existait avec les anciens « certificats de dépôt » anonymes, qui ne prouvaient pas nécessairement la propriété, est largement résolue par le caractère nominatif des bons actuels. L’émetteur se libère valablement en payant le créancier inscrit.
Modalités de paiement : Le remboursement se fait normalement en numéraire à l’échéance. Un paiement anticipé est possible si le contrat d’émission le prévoit. Un remboursement par échange contre d’autres titres pourrait aussi être envisagé contractuellement.
Preuve du paiement : Bien que la remise du titre original au débiteur fasse présumer la libération de celui-ci (conformément à l’article 1342-8 du Code civil), le droit commercial admet la liberté de la preuve (article L. 110-3 du Code de commerce). Le paiement peut donc être prouvé par tous moyens (écritures comptables, témoignages, etc.), ce qui était particulièrement utile à l’époque des bons anonymes.
Prescription de l’action en paiement : L’action du souscripteur pour obtenir le remboursement du bon de caisse se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Ce délai est actuellement de cinq ans (article L. 110-4 du Code de commerce), à compter de la date d’échéance du bon. Il ne faut pas le confondre avec la prescription triennale spécifique aux effets de commerce (dite « prescription cambiaire »), qui n’est pas applicable ici. La Cour de cassation a confirmé cette approche, considérant le bon de caisse comme une reconnaissance de dette relevant du droit commun. Il est possible pour les parties de convenir d’un délai de prescription plus court dans le contrat d’émission, à condition que cette clause soit claire et portée à la connaissance du souscripteur. En revanche, des événements comme une citation en justice peuvent interrompre la prescription, tandis que seule une impossibilité absolue d’agir pourrait la suspendre.
Quelle fiscalité s’applique aux bons de caisse ?
La fiscalité des bons de caisse concerne principalement les intérêts perçus et les éventuelles plus-values de cession. Le régime peut varier légèrement selon la nature de l’émetteur (banque ou autre entreprise) et surtout celle du bénéficiaire.
Régime des intérêts (produits) :
- Pour les particuliers résidents fiscaux français : les intérêts sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Le contribuable a généralement le choix entre l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou « flat tax ») ou l’option pour l’intégration de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu, si cela est plus avantageux pour lui. Pour éviter une taxation d’office sur des revenus considérés comme non déclarés, il est essentiel que l’identité du bénéficiaire soit connue de l’administration fiscale.
- Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : les intérêts perçus sont inclus dans leur bénéfice imposable et taxés à l’IS dans les conditions de droit commun.
- Pour certains organismes sans but lucratif : un régime spécifique avec une perception à la source à un taux réduit (le document source mentionne 10%) peut s’appliquer.
Régime des plus-values de cession : Si un particulier cède son bon de caisse avant l’échéance et réalise une plus-value (différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition), cette plus-value est imposable dans les mêmes conditions que les intérêts (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux, avec option PFU/barème). Les moins-values éventuelles sont imputables sur les gains de même nature de l’année et des années suivantes, sous certaines conditions. Des obligations déclaratives spécifiques s’appliquent.
Primes de remboursement : Les éventuelles primes versées au moment du remboursement du bon (différence entre la somme remboursée et la somme prêtée, hors intérêts) sont également imposables.
Lutte contre le blanchiment : Enfin, il faut rappeler que les établissements financiers émetteurs de bons de caisse sont soumis aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils doivent notamment s’assurer de l’identité de leurs clients. De plus, les transferts transfrontaliers de bons de caisse (même s’ils sont nominatifs) d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent faire l’objet d’une déclaration.
Le bon de caisse peut être un outil de gestion financière pertinent dans certaines situations. Si vous envisagez d’émettre ou de souscrire des bons de caisse, ou si vous rencontrez des difficultés liées à ces titres, notre cabinet peut vous apporter un conseil juridique adapté. Contactez-nous pour une analyse de votre situation.
Sources
- Code monétaire et financier (notamment art. L. 223-1 et s., L. 152-1 et s., L. 511-6, L. 511-7, L. 621-15)
- Code civil (notamment art. 1321 et s., 1342-3, 1342-8, 1415)
- Code de commerce (notamment art. L. 110-3, L. 110-4)