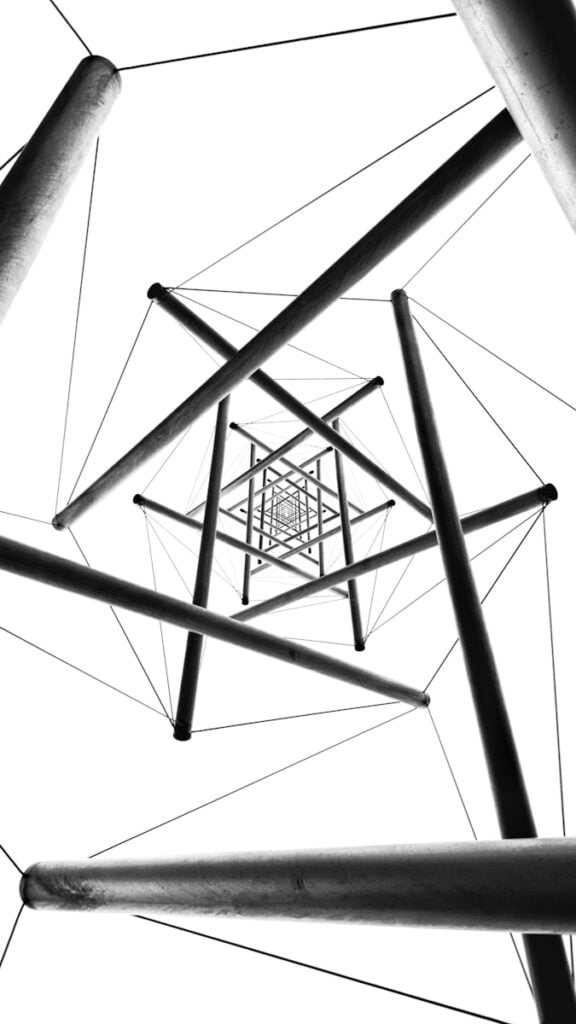L’État français, acteur majeur de la vie juridique, se retrouve régulièrement impliqué dans des contentieux. Pour une compréhension approfondie de l’origine et des missions essentielles de l’Agent judiciaire de l’État, il est crucial de savoir qui peut le représenter devant les tribunaux. La réponse n’est pas laissée au hasard : l’Agent judiciaire de l’État (AJE) détient un monopole légal de représentation, institué par l’article 38 de la loi du 3 avril 1955. Ce mécanisme juridique spécifique mérite d’être compris tant par les praticiens que par les justiciables confrontés à un litige avec l’État.
Un monopole exclusif de représentation
Le mandat légal confère à l’AJE un monopole exclusif pour représenter l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La jurisprudence l’a clairement consacré : « l’État n’a pu, dans une instance tendant à le faire déclarer débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, être légalement représenté par un autre fonctionnaire que l’agent judiciaire du Trésor, seul habilité à cet effet » (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 94-11.930, Bull. civ. II, n° 267).
Ce monopole, d’ordre public, est sanctionné par la nullité de toute procédure ne respectant pas cette règle. Il convient de ne pas le confondre avec les règles spécifiques régissant la responsabilité des juges et magistrats. Aucune administration ne peut donc se substituer à l’AJE pour représenter l’État devant les tribunaux judiciaires.
En pratique, cela implique qu’un justiciable souhaitant assigner l’État doit impérativement diriger son action contre l’AJE et non contre le ministère concerné ou l’administration en cause.
Moment et modalités d’intervention
L’intervention de l’AJE obéit à des règles distinctes selon la nature de la procédure :
En matière civile
L’AJE bénéficie d’une souplesse remarquable puisqu’il peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en cause d’appel ou en cassation. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt de 1966 concernant un litige sur le droit au capital décès d’un fonctionnaire (Civ. 2e, 7 juill. 1966, Bull. civ. II, n° 749).
Cette flexibilité permet de régulariser une procédure initialement mal dirigée sans obliger le demandeur à réassigner le représentant légal de l’État.
En matière pénale
La situation diffère radicalement. L’AJE est soumis aux règles communes de l’action civile devant les tribunaux répressifs. Sa constitution de partie civile doit intervenir « au plus tard avant les réquisitions du ministère public sur le fond » (Crim. 1er mars 1990, n° 88-86.692). Aucun traitement de faveur ne lui est accordé.
Les voies de recours et leurs particularités
L’exercice des voies de recours par l’AJE présente plusieurs spécificités :
- Les délais de recours ne courent contre l’AJE que si la notification lui a été personnellement adressée. Une notification au ministère concerné est inopérante (Soc. 31 mars 2003, n° 02-30.765, Bull. civ. V, n° 123).
- L’AJE, même non partie à l’instance initiale, peut exercer des voies de recours s’il y a intérêt. La Cour de cassation a ainsi jugé recevable un pourvoi formé par l’AJE contre un arrêt mettant à la charge de l’État les conséquences d’une faute inexcusable sans qu’il ait pu être légalement représenté (Soc. 17 avr. 1996, n° 94-15.365, Bull. civ. V, n° 166).
- Seul l’AJE peut valablement renoncer à l’exercice d’une voie de recours, sans être tenu par l’engagement d’une autorité administrative (Aix-en-Provence, 25 mai 1988).
Un champ de compétence précisément délimité
Il est important de noter que des exceptions au mandat légal de l’Agent judiciaire de l’État existent, notamment en matière fiscale, domaniale ou douanière. Cela dit, le mandat légal de l’AJE s’applique uniquement aux actions portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine.
Deux conditions essentielles limitent donc sa compétence :
Une compétence exclusivement judiciaire
L’AJE n’intervient que devant les juridictions judiciaires, qu’il s’agisse des tribunaux judiciaires, des conseils de prud’hommes, des tribunaux de commerce ou encore des cours d’appel et de la Cour de cassation.
Cette compétence s’étend même aux juridictions étrangères selon la jurisprudence, dès lors que le litige oppose des personnes privées à l’État français pour des actes de droit privé.
Une action à caractère pécuniaire
L’AJE n’est compétent que pour les actions tendant, à titre principal, à faire déclarer l’État créancier ou débiteur. Cette condition exclut :
- Les demandes d’expertise seules, sans provision (Civ. 1re, 27 févr. 1990, n° 87-15.335)
- Les demandes d’astreintes formulées isolément (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 91-11.813)
- Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérées comme accessoires (Civ. 2e, 25 févr. 2010, n° 08-21.474)
- Les mesures conservatoires (Civ. 2e, 14 avr. 1983, n° 79-14.008)
Cette restriction explique pourquoi la Cour de cassation a jugé que l’AJE n’avait pas à être mis en cause dans une procédure de référé visant exclusivement à solliciter une expertise (Rennes, 5 juin 2006, RG n° 06/00641).
Que retenir pour le justiciable ?
Pour tout litige avec l’État devant une juridiction judiciaire impliquant une demande pécuniaire principale :
- L’assignation doit viser l’Agent judiciaire de l’État, domicilié à Paris (13e)
- Afin d’éviter l’irrecevabilité de votre action, il est crucial de savoir que toute procédure qui méconnaîtrait ce monopole serait frappée de nullité
- L’AJE ne représente pas l’État dans les contentieux fiscaux, douaniers ou domaniaux
- Sa compétence ne s’étend pas aux litiges devant les juridictions administratives
Dans ces circonstances complexes, l’expertise d’un avocat est indispensable pour éviter les écueils procéduraux et sécuriser votre action. Notre cabinet peut vous accompagner dans votre démarche contentieuse contre l’État en veillant au respect scrupuleux de ces règles de compétence. N’hésitez pas à nous consulter avant d’engager toute procédure.
Sources
- Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances
- Civ. 2e, 25 octobre 1995, n° 94-11.930, Bull. civ. II, n° 267
- Civ. 2e, 6 janvier 1965, n° 59-60.611, Bull. civ. II, n° 5
- Crim. 1er mars 1990, n° 88-86.692
- Soc. 31 mars 2003, n° 02-30.765, Bull. civ. V, n° 123
- Civ. 1re, 27 février 1990, n° 87-15.335, Bull. civ. I, n° 56
- Civ. 2e, 16 juillet 1992, n° 91-11.813, Bull. civ. II, n° 207
- Civ. 2e, 10 décembre 1986, n° 85-16.359, JCP 1987. IV. 60
- Civ. 2e, 14 avril 1983, n° 79-14.008, Bull. civ. II, n° 91