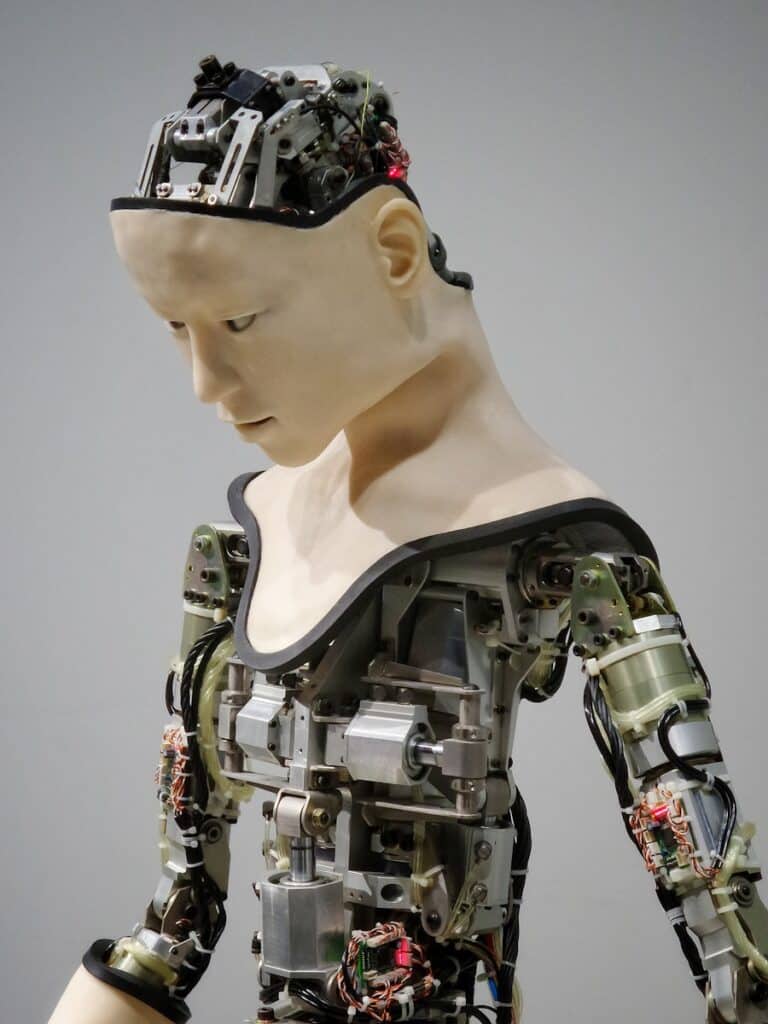En matière de justice, le temps n’est pas une notion abstraite. Il est encadré par des règles précises, des échéances impératives qu’on appelle les délais de procédure. Ignorer ou méconnaître ces délais, c’est prendre le risque considérable de voir ses droits s’évanouir, parfois de manière définitive. Une action non lancée à temps, une réponse non fournie dans les délais, un recours non exercé… et la porte de la justice peut se refermer, quels que soient le bien-fondé de votre demande ou la solidité de vos arguments. C’est une véritable course contre la montre dont il faut maîtriser les règles pour ne pas trébucher.
Ces délais, qui rythment chaque étape d’un procès civil, peuvent être fixés par la loi elle-même ou par le juge chargé d’organiser les échanges entre les parties. Comprendre comment ils fonctionnent, comment les calculer et quelles sont les conséquences d’un manquement est donc absolument essentiel. Cet article se propose de vous guider à travers les méandres des délais légaux, d’expliquer le rôle du juge dans la gestion du temps procédural et de mettre un accent particulier sur les délais en matière d’appel, un domaine où la rigueur est maximale.
Les délais fixés par la loi : règles de calcul et sanctions
La loi fixe de nombreux délais pour accomplir certains actes de procédure. Le plus connu est sans doute le délai pour faire appel d’une décision, mais il en existe bien d’autres (pour contester une décision administrative, pour agir en garantie…). Leur calcul obéit à des règles précises définies par le Code de procédure civile.
Savoir compter : la computation des délais
Le calcul d’un délai, ou « computation », peut sembler simple, mais quelques subtilités existent, définies principalement aux articles 640 à 642 du Code de procédure civile.
- Le point de départ (Dies a quo) : Le délai commence à courir à compter de la date de l’acte, de l’événement ou de la notification qui le déclenche (article 640). Par exemple, le délai d’appel d’un jugement commence le jour de sa signification (sa notification officielle par commissaire de justice).
- Calcul en jours : Lorsqu’un délai est exprimé en jours (par exemple, 15 jours pour répondre), le jour de l’événement déclencheur (le dies a quo) ne compte pas. Le délai commence à courir le lendemain, à zéro heure, et expire le dernier jour à minuit (article 641). Un délai de 15 jours commençant un lundi court donc jusqu’au lundi suivant minuit.
- Calcul en mois ou en années : Pour ces délais, le jour de départ compte implicitement. Le délai expire le jour du dernier mois (ou de la dernière année) qui porte le même numéro que le jour de départ. Par exemple, un délai d’un mois partant du 15 mars expire le 15 avril à minuit. Si le mois d’arrivée n’a pas de jour correspondant (par exemple, un délai d’un mois partant du 31 janvier), le délai expire le dernier jour de ce mois (le 28 ou 29 février).
- Week-ends et jours fériés : C’est un point essentiel. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (comme le 1er mai ou le 14 juillet), le délai est automatiquement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 642). Mais attention, cette règle ne s’applique que si c’est le dernier jour qui est concerné. Un jour férié tombant en plein milieu du délai est compté normalement. Mais alors, que se passe-t-il concrètement si le dernier jour tombe un dimanche ? Le délai ne s’arrêtera pas le dimanche à minuit, mais le lundi à minuit (sauf si ce lundi est aussi férié).
Maîtriser ces règles est fondamental, car une erreur de calcul d’un seul jour peut être fatale.
L’éloignement géographique : une rallonge pour certains
Conscient que la distance peut rendre l’accès à la justice plus difficile, le législateur a prévu une augmentation de certains délais importants (comparution, appel, opposition, cassation) pour les personnes résidant loin du tribunal concerné.
- Les articles 643 et 644 du Code de procédure civile prévoient ainsi une augmentation de :
- Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou une collectivité d’Outre-mer lorsqu’elles agissent ou sont attaquées devant une juridiction en métropole (et inversement).
- Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Ces délais supplémentaires s’ajoutent au délai de base. Par exemple, le délai d’appel d’un mois devient trois mois pour une personne résidant à l’étranger. Attention toutefois : l’article 647 précise que si une personne, bien que domiciliée à l’étranger ou en Outre-mer, reçoit la notification de l’acte en personne en France métropolitaine, elle ne bénéficie pas de cette augmentation.
La sanction du retard : déchéance, forclusion, caducité
Le non-respect d’un délai légal pour agir n’est pas une simple négligence, c’est une faute procédurale lourdement sanctionnée.
- La perte du droit d’agir (déchéance/forclusion/irrecevabilité) : Si vous ne réalisez pas l’acte requis (par exemple, faire appel) avant l’expiration du délai, vous êtes « forclos ». Votre action ou votre recours sera déclaré irrecevable. C’est une « fin de non-recevoir » que le juge peut, et souvent doit (notamment pour les délais de recours), soulever d’office, c’est-à-dire sans même que votre adversaire le demande (article 125 du Code de procédure civile). C’est la sanction la plus fréquente et la plus redoutable.
- La caducité : Dans certains cas, c’est l’acte initial qui perd toute valeur. Par exemple, une assignation (l’acte qui démarre le procès) doit être remise au greffe du tribunal dans un certain délai après avoir été délivrée à l’adversaire. Si ce délai n’est pas respecté, l’assignation devient « caduque » (article 406) : elle n’a plus aucun effet, comme si elle n’avait jamais existé, et n’a notamment pas interrompu la prescription.
- Le relevé de forclusion : une très mince seconde chance : L’article 540 du Code de procédure civile offre une possibilité, très encadrée, d’être « relevé » de la forclusion pour exercer un recours (appel, opposition) si un jugement a été rendu sans que vous ayez comparu. Il faut pour cela saisir le président de la juridiction compétente dans les deux mois suivant la connaissance effective du jugement (souvent via une mesure d’exécution) et prouver que vous n’avez pas eu connaissance de la décision à temps, ou que vous étiez dans l’impossibilité absolue d’agir, et ce, sans faute de votre part. Les conditions sont très strictes et rarement remplies.
Les délais fixés par le juge : l’organisation de la mise en état
Dans les procédures écrites, notamment devant le Tribunal Judiciaire ou la Cour d’appel, un magistrat est spécifiquement désigné pour organiser les échanges entre les parties avant l’audience de jugement : c’est le Juge de la mise en état (JME) ou le Conseiller de la mise en état (CME) en appel. Son rôle est crucial pour assurer un déroulement efficace et contradictoire de la procédure.
Le chef d’orchestre du procès : le Juge/Conseiller de la mise en état
Ce magistrat est le véritable maître du temps procédural pendant la phase d’instruction. Sa mission principale, définie à l’article 780 du Code de procédure civile, est de veiller « à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ». Pour cela, il dispose du pouvoir de fixer des délais aux parties (généralement représentées par leurs avocats) pour accomplir ces diligences.
La fixation des échéances : deux méthodes
Le JME ou le CME peut utiliser deux approches pour fixer ces délais (article 781 du Code de procédure civile) :
- La fixation « au fur et à mesure » : C’est la méthode la plus traditionnelle. Après chaque échange (par exemple, dépôt des conclusions du demandeur), le juge fixe un délai à l’adversaire pour répondre. Il peut ajuster les délais en fonction de la complexité de l’affaire et de l’avis (non liant) des avocats.
- Le « calendrier de procédure » : Inspiré par la pratique, ce système vise plus de prévisibilité. Le juge, après avoir recueilli l’avis des avocats, peut fixer dès le début ou en cours de procédure un calendrier prévisionnel indiquant les dates limites pour les échanges de conclusions, la date de clôture de l’instruction (après laquelle plus rien ne peut être ajouté), et même parfois la date de l’audience de plaidoirie. Cette méthode, si elle est respectée, permet d’avoir une meilleure visibilité sur la durée de la phase de mise en état.
Que se passe-t-il si on ne respecte pas les délais du juge ?
Contrairement aux délais légaux, le non-respect d’un délai fixé par le JME/CME n’entraîne pas automatiquement la perte du droit d’agir. Cependant, le magistrat dispose de sanctions pour inciter les parties à respecter le rythme qu’il a défini :
- La clôture de l’instruction (Art. 800) : C’est la sanction la plus fréquente et la plus efficace. Le juge peut décider de « clôturer » la mise en état. Passé cette date, sauf circonstances très exceptionnelles (« cause grave » révélée après la clôture), aucune conclusion ni aucune pièce nouvelle ne peut être déposée. Concrètement, cela signifie que si une partie n’a pas répondu à temps, elle risque de ne plus pouvoir le faire et le juge statuera sur la base des éléments déjà échangés. Le juge peut même prononcer une clôture « partielle » à l’égard d’une seule partie défaillante.
- La radiation (Art. 801) : Si toutes les parties sont inactives et ne respectent pas les délais, le juge peut décider de « radier » l’affaire. Cela signifie que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours. Elle n’est pas terminée, mais elle est mise en sommeil. L’instance est suspendue, mais le délai de péremption (généralement 2 ans d’inactivité totale) continue de courir. Pour réactiver l’affaire, il faudra justifier de l’accomplissement des diligences qui manquaient. C’est une sanction moins radicale que la clôture, souvent utilisée pour laisser une dernière chance aux parties négligentes.
Focus sur les délais d’appel : un parcours semé d’embûches
Si les délais sont importants en première instance, ils deviennent absolument critiques en appel. La procédure d’appel avec représentation obligatoire par avocat est marquée par des délais très stricts, souvent qualifiés de « couperets », dont le non-respect entraîne des sanctions automatiques et sévères. L’objectif affiché est d’accélérer le traitement des affaires en appel, mais cela crée un véritable parcours d’obstacles pour les justiciables et leurs avocats.
Des délais stricts imposés aux parties
Les articles 908, 909 et 910 du Code de procédure civile fixent les délais principaux :
- Pour l’appelant (celui qui fait appel) : Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa propre déclaration d’appel pour déposer ses premières conclusions au greffe de la cour. C’est dans ce document qu’il doit exposer les raisons de son appel et ses demandes.
- Pour l’intimé (celui contre qui l’appel est formé) : Il dispose également d’un délai de trois mois, mais ce délai court à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour déposer ses propres conclusions en réponse. C’est aussi dans ce délai qu’il doit, s’il le souhaite, former un « appel incident » (c’est-à-dire contester lui aussi d’autres aspects du jugement) ou un « appel provoqué » (mettre en cause une autre partie).
- Échanges ultérieurs : D’autres délais plus courts (deux mois en général, article 910) sont prévus pour les répliques éventuelles.
- Communication : Parallèlement au dépôt au greffe, les conclusions et les pièces doivent être notifiées aux avocats des autres parties (généralement via RPVA, article 906). Si une partie n’a pas encore d’avocat, les conclusions doivent lui être signifiées par commissaire de justice dans un délai spécifique (article 911).
Des sanctions automatiques et sévères
Le non-respect de ces délais entraîne des conséquences radicales, souvent relevées d’office par le Conseiller de la mise en état ou la Cour :
- Caducité de l’appel (Art. 908) : Si l’appelant ne dépose pas ses conclusions dans les trois mois suivant sa déclaration d’appel, son appel devient caduque. Cela signifie que l’appel est anéanti, comme s’il n’avait jamais existé. Le jugement de première instance devient alors définitif (sauf si l’intimé avait lui-même formé un appel principal). C’est la sanction la plus grave pour l’appelant.
- Irrecevabilité des conclusions (Art. 905-2, 909, 910) : Si l’intimé (ou l’appelant dans le cadre d’une réplique) dépose ses conclusions hors délai, celles-ci sont déclarées irrecevables. Le juge ne tiendra pas compte des arguments et demandes présentés tardivement. L’intimé se retrouve alors dans une position très difficile pour se défendre. Il en va de même pour les pièces communiquées en soutien de conclusions irrecevables (article 906).
Ces sanctions sont appliquées de manière très stricte par les cours d’appel et la Cour de cassation, qui considèrent que la célérité de la justice et la sécurité juridique l’exigent.
Quelques situations particulières modifiant les délais
Quelques exceptions ou modulations existent :
- Aide juridictionnelle : Si une partie demande l’aide juridictionnelle, les délais pour conclure sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à partir de la décision sur l’aide juridictionnelle ou de la désignation de l’avocat (article 43 du Décret n° 2020-1717).
- Radiation pour non-exécution : Si l’intimé demande la radiation de l’affaire parce que l’appelant n’exécute pas le jugement de première instance (quand il est exécutoire), les délais pour conclure sont suspendus pour l’intimé jusqu’à la décision sur la radiation (article 526).
- Délais de distance : Les augmentations de délais pour les résidents d’Outre-mer ou de l’étranger (+1 ou +2 mois) s’appliquent également aux délais de conclusion en appel (article 911-2).
Les délais de procédure sont une composante essentielle du droit à un procès équitable, mais leur complexité et leur rigueur, notamment en appel, en font un terrain miné pour le justiciable non averti. Manquer une échéance peut anéantir des mois, voire des années d’efforts et de procédure. Il est fondamental de les identifier dès le début, de les calculer avec précision et de les anticiper.
Face à ces enjeux, l’assistance d’un avocat est primordiale pour sécuriser votre parcours judiciaire, garantir le respect des délais et élaborer une stratégie procédurale adaptée. Si vous êtes engagé dans une procédure ou envisagez de le faire, et que la question des délais vous préoccupe, notre cabinet est à votre écoute pour vous apporter les conseils nécessaires.
Sources
- Code de procédure civile (notamment articles 125, 406, 540, 640 à 644, 647, 780, 781, 800, 801, 906, 908, 909, 910, 911, 911-2)
- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique