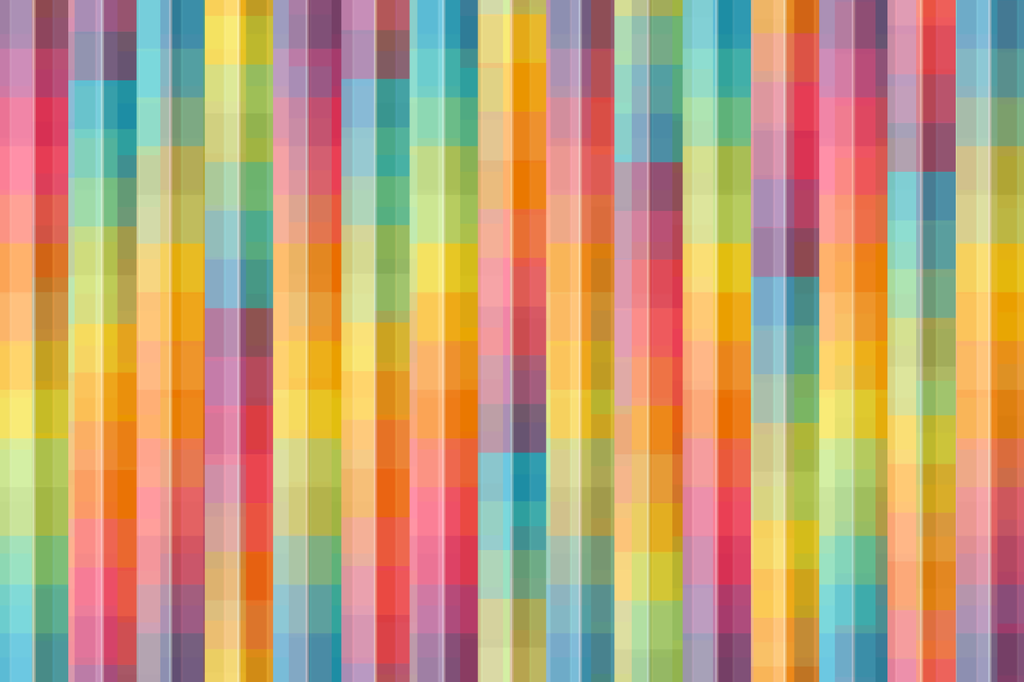Le financement des stocks représente un enjeu majeur pour de nombreuses entreprises, particulièrement celles qui manipulent des volumes importants de matières premières comme les produits pétroliers. Historiquement, le besoin de mobiliser la valeur de ces actifs pour obtenir des crédits, sans pour autant devoir les déplacer physiquement, a conduit à la création de mécanismes juridiques adaptés. Le warrant pétrolier fut l’un de ces outils.
Il s’agissait d’une forme de gage sans dépossession, permettant aux entreprises détenant des stocks de pétrole brut ou de produits dérivés de les donner en garantie pour leurs emprunts, tout en les conservant dans leurs propres installations. Ce système présentait la particularité de porter sur des biens fongibles, c’est-à-dire interchangeables. Bien que ce mécanisme ait été abrogé en 2021, comprendre son fonctionnement offre un éclairage intéressant sur l’évolution des sûretés mobilières en France. Ce parallèle peut également être fait avec l’histoire et les mécanismes du warrant hôtelier, une autre sûreté disparue. Cet article se propose de détailler les rouages du warrant pétrolier tel qu’il a existé.
Qu’était le warrant pétrolier ?
Le warrant pétrolier était donc fondamentalement un gage constitué sur des stocks de pétrole brut, de dérivés ou de résidus, sans que l’entreprise propriétaire (l’emprunteur) n’ait à s’en dessaisir matériellement. Il permettait de garantir une créance, le plus souvent un prêt bancaire. Sa particularité résidait dans son objet : des biens fongibles par nature. Contrairement à un gage classique sur un objet unique, le warrant portait sur une certaine quantité d’un produit défini par sa qualité, sans nécessiter d’isoler physiquement cette quantité du reste du stock détenu par l’entreprise.
Introduit par une loi du 21 avril 1932, son origine est liée au régime d’importation des produits pétroliers mis en place dans les années 1920 et 1930. Les entreprises importatrices étaient alors contraintes de constituer d’importants stocks de réserve, une obligation coûteuse. Pour leur permettre de financer ces stocks immobilisés, le législateur a créé ce warrant « à domicile », évitant le recours aux magasins généraux qui n’étaient pas équipés pour de tels volumes et types de produits. Les dispositions de cette loi ont été intégrées plus tard au Code de commerce, aux anciens articles L. 524-1 et suivants.
Juridiquement, le warrant pétrolier était considéré comme un acte de commerce par nature. Toute contestation relative à son application relevait ainsi de la compétence du tribunal de commerce.
Il est essentiel de noter que ce dispositif n’est plus en vigueur. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a en effet abrogé le régime du warrant pétrolier, le considérant comme tombé en désuétude. Pour découvrir une sûreté sur stocks toujours actuelle, vous pouvez consulter notre guide pratique sur le warrant de magasin général. Les explications qui suivent décrivent donc un droit qui n’est plus applicable.
Comment un warrant pétrolier était-il constitué ?
La mise en place d’un warrant pétrolier obéissait à des conditions précises, tant sur le fond que sur la forme.
Les conditions de fond
Initialement réservé aux titulaires d’autorisations spéciales d’importation, l’accès au warrant pétrolier a ensuite été élargi. Après la libéralisation de l’importation (notamment par la loi du 31 décembre 1992), tout « opérateur » détenant des stocks de pétrole brut, dérivés et résidus pouvait potentiellement y recourir, conformément à l’ancien article L. 524-1 du Code de commerce.
Le warrant pouvait donc porter sur ces différents types de produits pétroliers. Il était établi pour une quantité et une qualité spécifiées, sans qu’il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l’emprunteur. Un même stock pouvait même faire l’objet de plusieurs warrants successifs, au profit du même créancier ou de créanciers différents. Pour une analyse technique d’une sûreté sur stocks toujours pertinente aujourd’hui, vous pouvez consulter notre article sur le warrant de magasin général : définition, création et mentions essentielles.
Si la loi visait principalement la garantie d’emprunts, la doctrine considérait qu’un warrant pétrolier pouvait aussi garantir d’autres types de dettes contractuelles, comme le paiement du prix d’un achat à crédit.
Les conditions de forme et de publicité
La constitution du warrant nécessitait l’intervention du greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouvaient les stocks à warranter. Sur la base des déclarations de l’emprunteur, le greffier établissait le document. Celui-ci devait mentionner :
- La nature, la qualité, la quantité et la valeur des produits gagés.
- Leur lieu de situation précis.
- L’existence ou non d’une assurance (avec le nom et l’adresse de l’assureur le cas échéant).
- Le montant de la dette garantie.
- Les conditions particulières éventuellement convenues entre les parties.
- Les noms, professions et domiciles des parties.
Le warrant devait être signé par l’emprunteur (le débiteur). Sa durée de validité était fixée à trois ans, mais il pouvait être renouvelé.
Pour assurer l’information des tiers et rendre la garantie opposable, le greffier devait transcrire le warrant sur un registre spécial tenu au greffe. Cette transcription était mentionnée sur le warrant lui-même, avec l’indication éventuelle de warrants préexistants sur les mêmes stocks. C’est cette publicité qui conférait une date certaine au gage et le rendait efficace vis-à-vis des autres créanciers ou des acquéreurs potentiels du stock.
N’importe qui pouvait demander au greffe un état des warrants inscrits au nom d’un emprunteur (depuis moins de cinq ans) ou un certificat attestant de l’absence d’inscription. L’inscription restait active pendant trois ans, mais n’était radiée d’office qu’après cinq ans si elle n’avait pas été renouvelée avant l’expiration du délai initial de trois ans. Un renouvellement effectué dans les délais prolongeait les effets pour trois nouvelles années. En cas de remboursement de la dette ou d’accord entre les parties (mainlevée), l’inscription faisait l’objet d’une radiation mentionnée sur le registre.
Les sanctions prévues en cas d’irrégularité
Le non-respect des règles de constitution entraînait des sanctions.
- Une fausse déclaration de l’emprunteur ou la constitution d’un warrant sur des produits déjà warrantés sans en informer le nouveau prêteur exposait l’emprunteur à des poursuites pénales pour escroquerie (sur la base de l’article 313-1 du Code pénal).
- Un warrant portant sur des biens non éligibles (autres que pétrole brut, dérivés, résidus) n’avait pas la valeur d’un warrant pétrolier. Il pouvait éventuellement valoir comme billet à ordre ou simple reconnaissance de dette s’il en remplissait les conditions.
- L’absence de signature ou l’omission de mentions essentielles pour identifier les produits gagés rendait également le titre inefficace en tant que warrant.
- L’oubli des mentions relatives à l’assurance pouvait engager la responsabilité du signataire ou du greffier si cela causait un préjudice au porteur (par exemple, l’impossibilité de faire valoir ses droits sur l’indemnité d’assurance).
- Enfin, et c’est un point important, le défaut de transcription au greffe rendait le privilège du créancier gagiste inopposable aux tiers. La transcription était vue comme l’acte conférant une « possession fictive » au créancier.
La transmission du warrant pétrolier
Comme un effet de commerce, le warrant pétrolier était conçu pour circuler. L’ancien article L. 524-8 du Code de commerce prévoyait qu’il était « transmissible par voie d’endossement ». La présence d’une clause « à ordre » n’était donc pas nécessaire pour permettre sa transmission. En revanche, une mention « non à ordre » apposée par le débiteur aurait limité sa transmission aux formes d’une cession de créance civile (article 1690 du Code civil).
L’endossement devait respecter un certain formalisme : il devait être daté, signé et indiquer les noms, professions et domiciles de l’endosseur (celui qui transmet) et de l’endossataire (celui qui reçoit). La loi dérogeait ici au droit cambiaire classique en interdisant l’endossement « en blanc » (simple signature de l’endosseur sans nommer le bénéficiaire). Cette exigence était liée à une autre formalité.
En effet, tout acquéreur du warrant par endossement (escompteur) avait l’obligation d’aviser le greffier du tribunal de commerce de cette transmission dans les huit jours, par lettre recommandée ou déclaration verbale contre récépissé. Le but était de permettre à l’emprunteur initial de connaître à tout moment le porteur actuel du warrant, notamment pour pouvoir exercer sa faculté de remboursement anticipé. L’omission de cet avis pouvait engager la responsabilité de l’endossataire négligent s’il en résultait un préjudice pour l’emprunteur.
Toutefois, l’emprunteur pouvait, par une mention spéciale sur le warrant, dispenser les endossataires successifs de cette obligation de notification au greffe. Dans ce cas, comme nous le verrons, l’emprunteur perdait un avantage financier en cas de remboursement anticipé, mais conservait la faculté de le faire.
Quels étaient les effets juridiques de cet endossement ? Principalement, il emportait une garantie solidaire de tous les endosseurs successifs envers le porteur final. Si l’emprunteur ne payait pas à l’échéance, le porteur pouvait se retourner contre n’importe lequel des signataires précédents. De plus, en tant qu’effet de commerce, le warrant pétrolier bénéficiait du principe de l’inopposabilité des exceptions : un porteur de bonne foi n’avait pas à subir les contestations que l’emprunteur aurait pu avoir contre un porteur précédent (par exemple, sur la cause de la dette initiale). Pour faciliter son financement, la loi prévoyait aussi que certains établissements de crédit pouvaient accepter le warrant avec une seule signature d’endossement au lieu des deux habituellement requises par leurs statuts.
Quels étaient les droits et obligations des parties ?
Le warrant pétrolier créait un ensemble de droits et d’obligations tant pour l’emprunteur, qui conservait les stocks, que pour le porteur du titre, titulaire de la garantie.
Les obligations et droits de l’emprunteur
La première obligation de l’emprunteur était la conservation des produits warrantés. Il en restait le gardien et était responsable de leur maintien en quantité et qualité, sans pouvoir réclamer d’indemnité pour cette garde au porteur du warrant.
En cas de disparition ou de diminution significative du stock gagé, le porteur pouvait mettre l’emprunteur en demeure, par lettre recommandée, soit de reconstituer la garantie dans les 48 heures, soit de rembourser immédiatement tout ou partie de la somme due. Faute de réponse satisfaisante, le porteur pouvait exiger le remboursement total de la créance, considérée comme immédiatement exigible. Dans ce cas, l’emprunteur devait payer la totalité des intérêts prévus jusqu’à l’échéance initiale, même s’il remboursait plus tôt, en guise de sanction. Le détournement ou la détérioration volontaire des produits warrantés exposait l’emprunteur à des poursuites pour abus de confiance (article 314-1 du Code pénal). Toutefois, la simple vente des produits n’était pas en soi un détournement.
L’emprunteur conservait en effet le droit de vendre les produits warrantés, même avant l’échéance et sans l’accord du porteur. C’était une souplesse importante pour la gestion de ses stocks. Mais, et c’était la contrepartie essentielle pour le créancier, la livraison effective des produits vendus à l’acheteur ne pouvait intervenir qu’une fois que le porteur du warrant avait été intégralement payé (désintéressé), comme le précisait l’ancien article L. 524-6 du Code de commerce.
Enfin, l’emprunteur bénéficiait d’un droit au remboursement anticipé. Il pouvait décider de rembourser sa dette avant l’échéance prévue sur le warrant. Si le porteur refusait ce paiement anticipé, l’emprunteur pouvait se libérer en consignant la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en respectant la procédure prévue par le Code de procédure civile (anciens articles 1426 à 1429). L’offre devait être faite au dernier porteur connu grâce aux avis d’endossement donnés au greffe. Une fois la consignation effectuée, le président du tribunal de commerce pouvait ordonner le transfert du gage sur la somme consignée. L’avantage pour l’emprunteur était qu’en cas de remboursement anticipé (sauf s’il avait dispensé les endosseurs de l’avis au greffe), il ne payait que les intérêts courus jusqu’à la date du remboursement effectif, plus une période forfaitaire de dix jours. Il économisait donc les intérêts restants jusqu’à l’échéance initiale.
Les droits et protections du porteur
Le porteur du warrant bénéficiait de plusieurs protections pour sécuriser sa créance.
D’abord, il était protégé contre la dépréciation des produits warrantés. Les cours du pétrole pouvant fluctuer fortement, si la valeur des stocks gagés baissait de 10% ou plus par rapport à leur valeur initiale, le porteur pouvait exiger de l’emprunteur, par lettre recommandée, soit qu’il augmente le gage (en ajoutant d’autres produits ou une autre garantie), soit qu’il rembourse une partie de la somme prêtée proportionnelle à la baisse de valeur. Si l’emprunteur optait pour le remboursement partiel, il bénéficiait de la réduction des intérêts futurs (comme pour un remboursement anticipé classique). Si l’emprunteur ne s’exécutait pas dans les huit jours suivant la mise en demeure, le porteur pouvait exiger le remboursement total immédiat de sa créance.
Ensuite, le porteur avait des droits sur l’assurance couvrant les produits. Si un sinistre survenait (incendie, etc.), ses droits (privilège) se reportaient automatiquement sur l’indemnité versée par l’assureur. Bien que l’assurance ne fût pas obligatoire (contrairement aux marchandises en magasin général), si l’emprunteur avait assuré les stocks, le porteur en bénéficiait. Si l’assurance venait à cesser, le porteur avait même la faculté de la continuer à ses frais (sauf accord contraire) jusqu’au paiement de sa créance.
À l’échéance, si l’emprunteur ne payait pas volontairement, le porteur devait réclamer le paiement, puis réitérer sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Sans paiement dans les cinq jours suivant l’envoi de cette lettre, le porteur devait, pour conserver ses recours contre les endosseurs, dénoncer ce défaut de paiement dans les quinze jours suivant l’échéance. Cette dénonciation se faisait par un avertissement spécial remis au greffier, qui le transmettait à chaque endosseur. Cette procédure remplaçait le protêt, formalité plus lourde du droit cambiaire.
Face à un défaut de paiement, le porteur avait le choix des voies d’exécution. Il pouvait soit chercher à faire vendre le gage (les stocks de pétrole), soit agir directement contre l’emprunteur ou les endosseurs en vertu de leur garantie solidaire. S’il choisissait de commencer par la vente du gage, la loi précisait qu’il devait aller jusqu’au bout de cette procédure avant d’exercer ses recours contre les garants. Cela suggère qu’il pouvait aussi choisir d’agir d’abord contre les garants.
S’il optait pour la réalisation du gage, le porteur pouvait, quinze jours après la lettre recommandée restée sans effet, faire procéder à la vente publique des marchandises. Cette vente nécessitait une ordonnance du président du tribunal de commerce, obtenue sur requête, qui fixait les modalités (jour, heure, lieu, publicité). Une publicité minimale (affichage 8 jours avant) était requise, pouvant être complétée ou remplacée par des annonces presse ou à son de trompe sur autorisation du président. L’emprunteur et les endosseurs devaient être prévenus 8 jours à l’avance. Il était aussi possible, si l’emprunteur y avait consenti par une mention spéciale sur le warrant, que la vente ait lieu à l’amiable, mais toujours sur autorisation judiciaire. Enfin, le porteur pouvait aussi demander en justice l’attribution du gage en paiement, c’est-à-dire de devenir propriétaire de la quantité de pétrole warrantée, sur la base d’une estimation par expert (conformément à l’article 2347 du Code civil).
Un droit de rétention était généralement reconnu au porteur du warrant. Bien qu’il n’ait pas la détention matérielle des stocks, la publicité au greffe créait une « possession fictive » à son profit. Ce droit lui permettait, en théorie, de s’opposer à la livraison des produits à un acheteur tant qu’il n’était pas payé. L’article 2286, 4° du Code civil consacre aujourd’hui ce type de rétention pour les gages sans dépossession inscrits. Son efficacité pratique, notamment en cas de procédure collective, a pu être discutée par le passé mais semblait admise.
Le porteur bénéficiait également d’un droit de préférence sur le prix de vente des produits warrantés (ancien article L. 524-13 C. com.). Il devait être payé avant les autres créanciers de l’emprunteur. Toutefois, ce droit n’était pas absolu. Il passait après les frais de justice engagés pour la vente, le « superprivilège » des salaires, et les frais engagés pour la conservation des produits après la constitution du warrant. Sa primauté par rapport au privilège du Trésor public (fisc) ou à celui du bailleur des locaux où étaient stockés les produits était débattue en doctrine.
Quant à un éventuel droit de suite, permettant au créancier de suivre le bien gagé en quelques mains qu’il passe, son existence pour le warrant pétrolier était très controversée. La nature fongible des biens (une quantité de pétrole indifférenciée) rendait difficile l’exercice d’un tel droit. S’il avait été admis, il aurait de toute façon été limité par la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » (article 2276 du Code civil) protégeant l’acquéreur de bonne foi.
Le warrant pétrolier face aux procédures collectives
Que devenait le warrant si l’entreprise emprunteuse faisait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ?
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles s’appliquait. Le porteur du warrant ne pouvait plus réclamer paiement ni engager la vente forcée du stock. De plus, son droit de rétention (même fictif) était rendu inopposable pendant la période d’observation et l’exécution éventuelle d’un plan, sauf cas particulier de cession d’activité incluant le bien gagé (application de l’article L. 622-7 du Code de commerce).
- Si un plan de continuation était adopté, le porteur subissait les délais de paiement imposés par le plan. Cependant, si l’entreprise avait besoin de disposer du stock warranté pour son activité, elle pouvait être amenée à payer le porteur plus tôt que prévu par le plan pour obtenir la levée du gage. Si le paiement intervenait seulement aux échéances du plan, le porteur était primé par les créances nées après le jugement d’ouverture et par le superprivilège des salaires.
- Si un plan de cession était décidé, le stock warranté pouvait être inclus dans la cession. Dans ce cas, la charge du warrant (la garantie) était transmise au repreneur, qui devait en assumer le paiement pour libérer le bien. Si le stock n’était pas compris dans la cession, il devait être vendu séparément.
En cas de liquidation judiciaire, la situation du porteur était un peu plus favorable. Son droit de rétention redevenait pleinement opposable. Si le liquidateur décidait de vendre le stock, le droit de rétention du porteur se reportait sur le prix de vente, lui donnant une priorité (après paiement des créances prioritaires comme les salaires ou certains frais de justice). Si le porteur prenait l’initiative de la vente (ou obtenait l’attribution judiciaire), son droit de rétention lui donnait la primauté même sur les créances nées pendant la procédure après le jugement d’ouverture (application de l’article L. 622-17, II du Code de commerce). Il pouvait également toujours demander l’attribution judiciaire du gage.
Bien que le warrant pétrolier appartienne au passé, les enjeux liés aux garanties sur stocks demeurent d’actualité. Si vous avez des questions sur les sûretés mobilières ou le financement de votre activité, notre cabinet peut vous apporter des conseils adaptés en droit commercial. Contactez-nous pour discuter de votre situation.
Sources
- Code de commerce (anciennes dispositions L. 524-1 et s.)
- Code civil (notamment articles 1690, 2276, 2286, 2347)
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code pénal (articles relatifs à l’escroquerie et l’abus de confiance)
- Loi du 21 avril 1932 (abrogée)
- Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (portant abrogation)