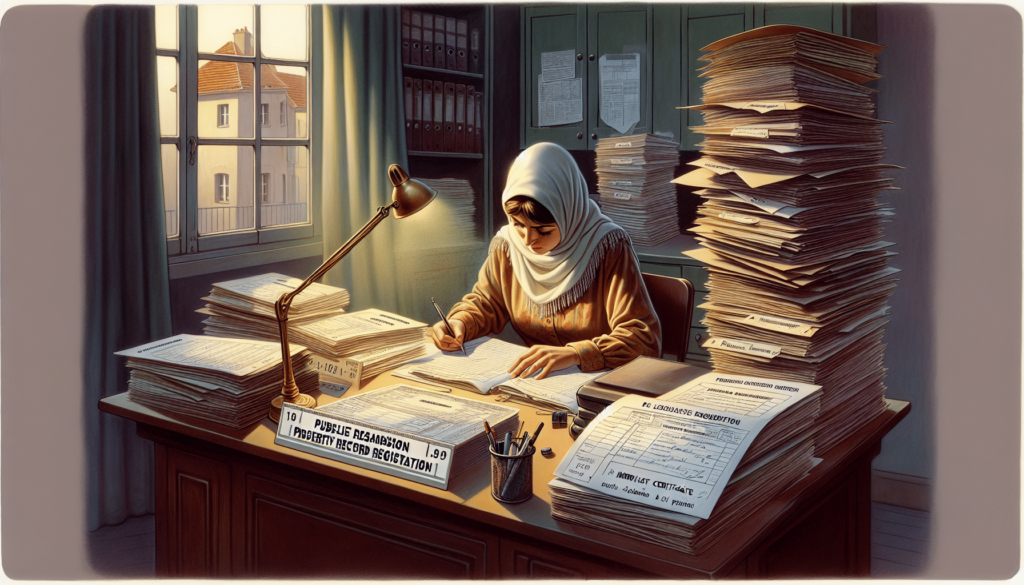En procédure civile, l’acquiescement est un acte juridique aux conséquences souvent radicales. Il consiste à reconnaître le bien-fondé des prétentions de son adversaire ou à se soumettre à une décision de justice, fermant ainsi la porte à de futures contestations. Commis par erreur ou par manque d’information, cet acte unilatéral peut se transformer en un véritable piège procédural, éteignant une action civile ou rendant un recours impossible. Comprendre ses implications est donc essentiel pour tout justiciable souhaitant préserver ses droits. Pour une définition claire et les principes essentiels de l’acquiescement en droit civil, notre article dédié pose les bases fondamentales.
1. Le caractère irrévocable de l’acquiescement et ses limites
L’acquiescement est un acte unilatéral qui n’exige pas l’acceptation de la partie adverse pour produire ses effets. Une fois valablement donné, il devient en principe irrévocable, comme le rappelle une jurisprudence constante (Civ. 2e, 22 juin 1977, Bull. civ. II, n° 158). Cette irrévocabilité signifie qu’il n’est plus possible de revenir en arrière pour contester ce qui a été accepté. Pour être valable, il doit émaner d’une personne ayant la libre disposition de ses droits et respecter des conditions strictes de validité.
Le Code de procédure civile prévoit toutefois une exception majeure à cette règle. L’article 409, alinéa 2, dispose que si l’adversaire forme lui-même un recours après l’acquiescement, la partie qui avait acquiescé retrouve son droit d’exercer une voie de recours. Cette disposition permet de rétablir un équilibre lorsque la partie initialement victorieuse cherche à obtenir davantage en appel, rouvrant ainsi un débat que l’acquiescement semblait avoir clos.
2. Les formes de l’acquiescement : de l’acte exprès à la reconnaissance tacite
La manifestation de la volonté d’acquiescer peut prendre différentes formes. L’article 410 du Code de procédure civile précise qu’il peut être exprès ou implicite, une distinction dont les conséquences pratiques sont déterminantes pour la suite de la procédure.
L’acquiescement exprès : une manifestation de volonté sans équivoque
L’acquiescement est dit « exprès » lorsqu’il résulte d’un acte qui manifeste clairement et sans la moindre ambiguïté l’intention de son auteur de reconnaître les prétentions de l’adversaire ou de se soumettre au jugement. Il peut être donné expressément par des conclusions écrites déposées par l’avocat, un acte séparé avec la signature de la partie ou son mandataire, ou une déclaration actée par le juge lors d’une audience. L’essentiel est que la volonté de renoncer à la contestation soit exprimée de manière positive et indubitable.
L’acquiescement tacite et le piège de l’exécution d’un jugement non exécutoire
L’acquiescement peut également être « tacite » ou « implicite ». Il se déduit alors d’actes ou de comportements qui impliquent nécessairement l’intention d’accepter la situation juridique. Le cas le plus courant est celui visé par l’article 410, alinéa 2, du Code de procédure civile : « L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement ». Cette forme d’acquiescement légal ou volontaire a des implications directes sur la renonciation aux voies de recours.
Concrètement, si vous décidez d’exécuter volontairement et de payer les sommes auxquelles vous avez été condamné par un jugement de première instance non assorti de l’exécution provisoire, vous perdez le droit de faire appel. La Cour de cassation applique cette règle avec rigueur, considérant que cet acte d’exécution démontre une intention non équivoque de se soumettre à la décision (Civ. 2e, 15 novembre 1995, n° 93-20.093, Bull. civ. II, n° 281). L’actualité jurisprudentielle tend toutefois à se montrer plus prudente, exigeant de rechercher si les actes d’exécution manifestent une volonté certaine et non équivoque d’acquiescer, ce qui alimente un débat juridique sur la portée réelle de l’acquiescement tacite aujourd’hui.
3. Effets de l’acquiescement à la demande : reconnaissance et renonciation
L’acquiescement à la demande, prévu par l’article 408 du Code de procédure civile, produit un double effet particulièrement puissant. D’une part, il emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire. Il s’agit d’un aveu sur le fond du droit : la partie qui acquiesce admet que la demande dirigée contre elle est justifiée.
D’autre part, et c’est là sa conséquence la plus radicale, il emporte renonciation à l’action. Cela signifie que non seulement l’instance en cours s’éteint, mais qu’il devient impossible d’engager une nouvelle instance pour le même objet et pour la même cause. Toute nouvelle tentative se heurterait à une fin de non-recevoir, l’acquiescement conférant une finalité équivalent à la force de chose jugée sur le droit.
4. Effets de l’acquiescement au jugement : soumission et perte des voies de recours
L’acquiescement au jugement, régi par l’article 409 du Code de procédure civile, se distingue du précédent. Il n’emporte pas renonciation à l’action, mais soumission aux chefs du jugement et renonciation aux voies de recours. La partie accepte la décision rendue.
Cette soumission est en principe divisible. Acquiescer à un chef du jugement (par exemple, la condamnation principale dans une affaire commerciale, ou la prestation compensatoire dans un jugement de divorce) n’emporte pas automatiquement acquiescement aux autres chefs (comme les dommages-intérêts), sauf si chaque chef est indivisible ou interdépendant. L’effet le plus important est la perte de l’ensemble des voies de recours, qu’elles soient ordinaires (appel, opposition) ou extraordinaires (pourvoi en cassation devant une chambre civile ou commerciale). Tout recours exercé par la partie ayant acquiescé serait déclaré irrecevable.
5. Portée de l’acquiescement : un acte aux effets relatifs
L’acquiescement est un acte personnel. Ses effets sont en principe strictement limités à celui qui l’accomplit. Cette portée relative soulève toutefois des questions complexes en présence de plusieurs parties (codébiteurs, cautions, etc.) ou dans des contextes procéduraux spécifiques.
Le principe : un effet limité à la partie qui acquiesce
En cas de pluralité de défendeurs, l’acquiescement de l’un n’engage pas les autres. Chacun conserve son droit de contester la demande ou le jugement. La seule exception à ce principe est le cas où l’objet du litige est indivisible, c’est-à-dire lorsque l’exécution de la décision ne peut être que collective. Dans cette situation, l’acte de l’un peut affecter les autres tiers au litige.
La solidarité passive à l’épreuve de l’acquiescement
La solidarité passive est un mécanisme de garantie pour le créancier, mais elle n’implique pas une représentation mutuelle des codébiteurs pour les actes qui leur sont purement personnels. L’acquiescement est considéré comme une « exception personnelle » au sens du droit des obligations. En conséquence, l’acquiescement donné par un débiteur solidaire ne lie pas les autres. Ces derniers conservent le droit de se défendre et d’opposer au créancier toutes les exceptions communes (par exemple, la nullité du contrat) qui n’ont pas été abandonnées par l’acquiescement de leur codébiteur, qui ne peut être tenu pour responsable.
Acquiescement et procédures collectives : le sort de la caution et des créances
Dans le cadre d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ouverte par le tribunal de commerce, le principe de la discipline collective prime, visant la protection de l’ensemble des créanciers. L’acquiescement du débiteur (une société par exemple) à une créance non déclarée ou contestée est inopposable à la procédure. Il ne peut pas, de sa seule initiative, admettre une dette qui affecterait l’ensemble des créanciers.
De plus, cet acquiescement est également inopposable à la caution (qui peut être une compagnie d’assurance). La caution conserve son droit de contester l’existence ou le montant de la créance garantie, même si le débiteur principal l’a reconnue. L’acquiescement est un acte personnel au débiteur qui ne peut aggraver la situation de celui qui s’est porté garant pour lui.
6. L’acquiescement au sein des incidents d’instance : une analyse comparative
Pour saisir pleinement la nature de l’acquiescement, il est utile de le comparer aux autres incidents qui peuvent mettre fin à une instance. L’acquiescement se distingue fondamentalement du désistement, de la péremption ou de la caducité par son objet : il porte sur le droit substantiel lui-même, et pas seulement sur la procédure.
- Acquiescement vs Désistement : Le désistement d’instance (art. 394 CPC) met fin à la procédure en cours mais laisse subsister le droit d’agir, sauf si le défendeur l’accepte sous condition de ne pas réintroduire l’instance. Le désistement d’action (art. 384 CPC) est plus proche de l’acquiescement à la demande, car il emporte renonciation au droit lui-même. La différence majeure est que l’acquiescement est un acte de reconnaissance du droit de l’adversaire, tandis que le désistement est un acte d’abandon de son propre droit.
- Acquiescement vs Péremption : La péremption d’instance (art. 386 CPC) sanctionne l’inaction des parties pendant le délai de péremption de deux ans. Elle éteint la procédure mais pas l’action. Elle résulte d’une négligence procédurale, non d’un acte de volonté sur le fond du droit.
- Acquiescement vs Caducité : La caducité sanctionne le non-accomplissement d’un acte de procédure dans le délai imparti. C’est une sanction purement procédurale, comme la caducité de la citation, sans rapport avec la reconnaissance du bien-fondé de la demande.
Cette distinction est fondamentale en matière de stratégie procédurale. Alors que péremption et caducité sont des sanctions qui peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état durant la mise en état d’une affaire au tribunal judiciaire, l’acquiescement touche au fond. Il ne s’agit pas d’une simple exception de procédure, mais d’un acte de disposition qui, sauf s’il concerne des matières intéressant l’ordre public (comme la filiation entre époux), lie définitivement son auteur.
7. Cas pratiques et jurisprudence récente : l’acquiescement en action
Les principes théoriques de l’acquiescement trouvent des applications concrètes dans de nombreuses procédures, dont certaines sont particulièrement révélatrices de ses enjeux pratiques.
Acquiescement et injonction de payer : leçons de la jurisprudence récente
La procédure d’injonction de payer est conçue pour être rapide. Le créancier obtient une ordonnance qui, si elle n’est pas contestée par le débiteur via une « opposition », devient exécutoire. La question se pose de savoir si le paiement de la somme visée par l’ordonnance vaut acquiescement.
La jurisprudence est claire : le paiement volontaire de l’ordonnance vaut acquiescement et ferme la voie de l’opposition. Cependant, une subtilité de taille existe. L’ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les six mois de sa date, faute de quoi elle est « non avenue » (art. 1411 CPC). La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt jugeant que l’exécution volontaire d’une ordonnance non avenue car signifiée tardivement ne constitue pas un acquiescement (Civ. 2e, 17 octobre 2019, n° 18-18.759). L’ordonnance étant privée d’effet juridique, son exécution ne peut produire les conséquences d’un acquiescement. De même, le créancier doit demander l’apposition de la formule exécutoire dans le mois suivant l’expiration du délai d’opposition, sous peine que l’ordonnance soit également non avenue. Cette politique jurisprudentielle (voir aussi CA Versailles, 12 avril 2021, n° 20/01234), qui vise à la protection des justiciables, fait l’objet d’une publicité accrue dans les revues spécialisées (JCP G 2021, 112 ; RTD civ. 2020. 455). Ces délais sont cruciaux et conditionnent les effets d’une éventuelle exécution.
L’acquiescement est un outil procédural puissant mais à double tranchant. Ses effets, souvent irrévocables, exigent une analyse stratégique avant toute décision. Qu’il s’agisse de reconnaître une demande, d’exécuter un jugement rendu ou de naviguer dans une action en justice complexe, les conséquences peuvent être définitives. Pour sécuriser vos démarches et faire les choix les plus adaptés à votre situation, notamment en sollicitant une aide pour évaluer une offre transactionnelle, notre expertise en droit processuel est à votre disposition.
Si vous êtes confronté à une décision de justice ou à une demande en justice et que vous vous interrogez sur l’opportunité d’un acquiescement, n’hésitez pas à contacter notre cabinet pour un conseil avisé.
Sources
- Code de procédure civile, articles 408 à 410
- Code civil (dispositions relatives à la solidarité passive)
- Code de commerce (dispositions relatives aux procédures collectives)
- Répertoire de Droit Civil Dalloz – Obligations
- Répertoire de Droit Commercial Dalloz – Entreprise en difficulté : situation des créanciers
- Répertoire de Droit Commercial Dalloz – Solidarité
- Répertoire de Droit Commercial Dalloz – Injonction de payer
- JurisClasseur Procédure Civile (JCP)
- Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.)