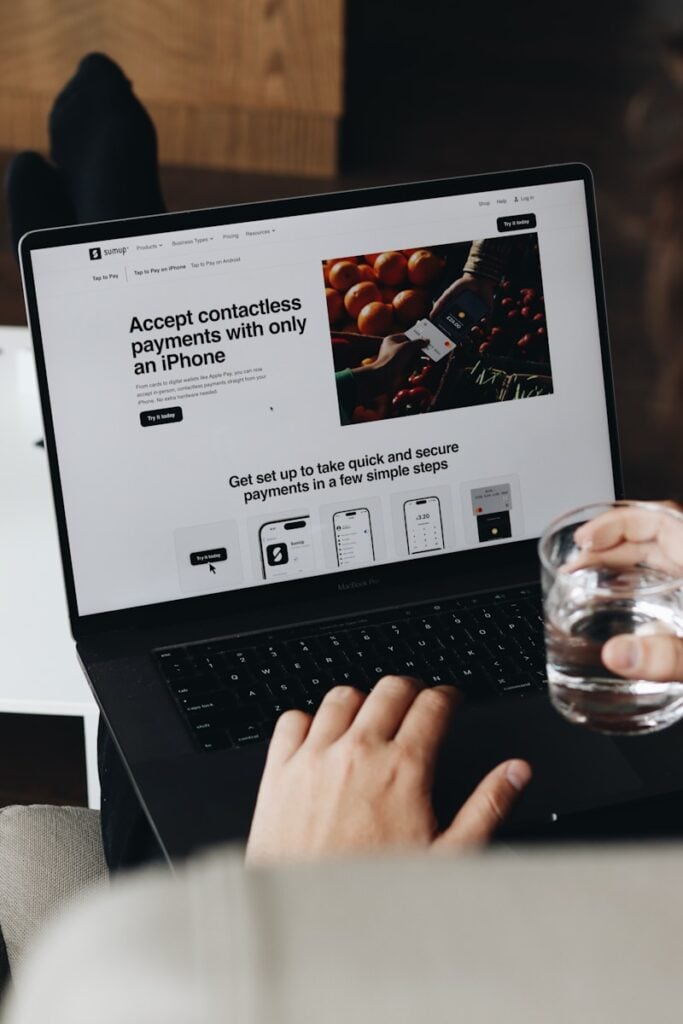La mise en demeure constitue une étape charnière dans la vie d’une obligation. Elle marque le passage d’une phase amiable à une phase précontentieuse. Au-delà de son apparente simplicité, cet acte juridique déploie des effets considérables qui méritent attention.
Les effets principaux de la mise en demeure
L’interpellation officielle du débiteur
La mise en demeure interpelle le débiteur sur son retard. Elle officialise l’impatience du créancier. Comme le précise l’article 1344 du Code civil, elle peut prendre la forme d’une sommation ou d’un acte portant « interpellation suffisante ».
Cette interpellation doit être claire, précise et sans équivoque. La jurisprudence exige que la mise en demeure exprime « nettement la volonté du créancier d’obtenir satisfaction » (Cass. civ. 1re, 24 juin 1975, n° 74-10.644).
Le déclenchement des dommages-intérêts moratoires
Effet central : la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires. L’article 1344-1 du Code civil dispose qu’en cas d’obligation de payer, elle déclenche l’intérêt au taux légal sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation a confirmé que « les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure » (Cass. civ. 1re, 14 oct. 2010, n° 09-12.921).
Attention : ceci ne concerne que les dommages-intérêts moratoires. Pour les dommages-intérêts compensatoires, la jurisprudence a adopté une position différente.
Le transfert des risques vers le débiteur
L’article 1344-2 du Code civil organise un transfert des risques. Lorsque l’obligation porte sur la délivrance d’une chose, la mise en demeure place les risques à la charge du débiteur défaillant.
Ce mécanisme protège le créancier. Si la chose périt après la mise en demeure, le débiteur ne pourra pas invoquer la force majeure pour s’exonérer.
Applications spécifiques dans divers domaines
Responsabilité contractuelle : une condition préalable
En matière contractuelle, l’article 1231 du Code civil énonce : « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure ».
Cette règle s’inscrit dans une logique de loyauté. Le débiteur doit avoir une chance de s’exécuter avant d’encourir des sanctions.
Toutefois, la Cour de cassation a nuancé cette exigence. Dans un arrêt de la chambre mixte du 6 juillet 2007, elle a jugé que « la mise en demeure est inutile dès lors que l’inexécution d’un contrat est acquise et cause un préjudice » (Cass. ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13.823).
Clause résolutoire : précautions nécessaires
Pour les clauses résolutoires, les articles 1225 et 1226 du Code civil imposent une mise en demeure préalable. Celle-ci doit mentionner expressément la clause résolutoire et avertir le débiteur des conséquences de son inexécution.
Pour qu’elle soit valable, la mise en demeure doit :
- Se référer explicitement à la clause résolutoire
- Mentionner que le créancier sera en droit de résoudre le contrat
- Accorder un délai raisonnable au débiteur
Un oubli de ces mentions peut entraîner l’inopposabilité de la clause.
Contrats d’assurance : un régime spécifique
En matière d’assurance, le Code des assurances impose un formalisme particulier. L’article L.113-3 prévoit que la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après une mise en demeure par lettre recommandée.
La jurisprudence a précisé que l’assureur n’a pas à prouver la réception de cette lettre (Cass. crim., 14 déc. 2010, n° 09-88.616). L’envoi suffit.
Cette mise en demeure doit indiquer précisément le montant de la prime exigible (Cass. civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-21.019).
Recouvrement des créances sociales : un préalable obligatoire
Pour les cotisations sociales, les articles L.244-1 et L.244-2 du Code de la sécurité sociale imposent une mise en demeure préalable à toute contrainte.
Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité. Elle doit permettre au cotisant de connaître « la nature, la cause et l’étendue de son obligation » (Cass. civ. 2e, 7 avr. 2022, n° 20-19.959).
Un formalisme strict s’applique. La jurisprudence vérifie que le débiteur a reçu une information suffisante pour pouvoir régler sa situation ou la contester.
Limites et exceptions
Situations où la mise en demeure s’avère inutile
La jurisprudence a identifié plusieurs cas où la mise en demeure n’est pas nécessaire. Comprendre ces situations de dispense permet de saisir comment ses effets peuvent se produire même en l’absence de cet acte formel.
- Quand l’inexécution est définitive et irréversible (Cass. ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13.823)
- Quand le débiteur a expressément déclaré refuser d’exécuter (Cass. civ. 3e, 3 avr. 1973, n° 72-10.247)
- En cas de gravité du comportement justifiant une résolution unilatérale (Cass. com., 9 juill. 2019, n° 18-14.029)
- Lors d’une cessation d’activité ou d’une liquidation judiciaire (Cass. civ. 1re, 3 mars 1998, n° 95-10.293)
Conséquences des irrégularités formelles
Les conséquences d’une mise en demeure irrégulière varient selon les domaines. Pour garantir sa validité et la pleine production de ses effets, il est crucial de maîtriser les techniques de rédaction et de notification.
Pour le crédit, la jurisprudence est stricte. La déchéance du terme d’un prêt ne peut être prononcée sans mise en demeure valable (Cass. civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386).
Pour les cotisations sociales, une mise en demeure insuffisamment motivée entraîne l’invalidité de la contrainte qui suit (Cass. civ. 2e, 18 mars 2021, n° 19-23.477).
En revanche, certains vices de forme peuvent être tolérés. L’omission de certaines mentions administratives n’affecte pas nécessairement la validité de l’acte (Cass. civ. 2e, 5 juill. 2005, n° 04-30.196).
En cas de pluralité de débiteurs, attention : la mise en demeure adressée à un seul n’a d’effet à l’égard des autres qu’en cas de solidarité (Cass. civ. 1re, 20 déc. 2017, n° 16-12.129).
Sources
- Articles 1231, 1344 à 1345-3 du Code civil
- Articles L.113-3 et R.113-1 du Code des assurances
- Articles L.244-1, L.244-2 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale
- Cass. ch. mixte, 6 juill. 2007, n° 06-13.823
- Cass. civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24.386
- Cass. civ. 2e, 7 avr. 2022, n° 20-19.959
- Deharo G., « La contrainte : de l’acte unilatéral à la contradiction », RJC juill.-août 2022, n° 4
- Répertoire de procédure civile, « Mise en demeure », Dalloz, 2022