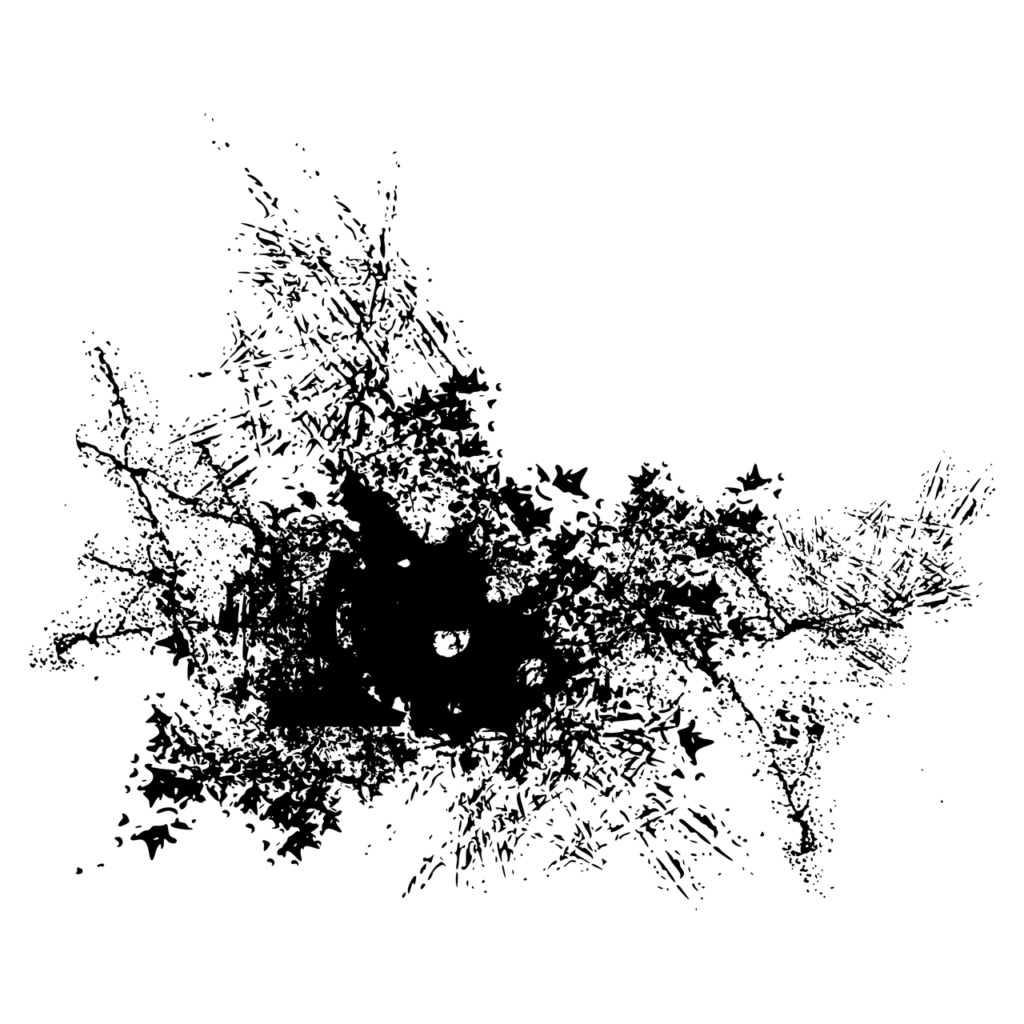Le droit n’est jamais figé, et le domaine des baux commerciaux, essentiel à la vie économique, n’échappe pas à cette règle. Ces dernières années, plusieurs textes législatifs majeurs, ainsi que des situations exceptionnelles comme la crise sanitaire, ont modifié ou précisé certains aspects importants du statut des baux commerciaux. La loi Pinel de 2014 a notamment cherché à rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires, tandis que la pandémie de COVID-19 a soulevé des questions inédites sur l’exécution des contrats. Pour les entrepreneurs, commerçants et artisans, comme pour les propriétaires de locaux commerciaux, il est important de comprendre ces évolutions pour mieux appréhender leurs droits et obligations actuels. Cet article décrypte les principaux changements récents et leurs conséquences pratiques.
La loi Pinel (2014) : des changements structurants
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a introduit une série de modifications significatives dans le statut des baux commerciaux. Voici les plus marquantes pour votre quotidien :
Plafonnement du déplafonnement et lissage de la hausse du loyer
Auparavant, lorsque le loyer du bail renouvelé était « déplafonné » (c’est-à-dire fixé à la valeur locative de marché, souvent bien supérieure au loyer précédent indexé), l’augmentation pouvait être brutale pour le locataire. La loi Pinel a instauré un mécanisme de « lissage » (article L. 145-34 du Code de commerce) : si le déplafonnement entraîne une augmentation supérieure à 10% du loyer payé l’année précédente, cette hausse est étalée dans le temps. Chaque année, l’augmentation ne peut excéder 10% du loyer de l’année précédente, jusqu’à atteindre progressivement le nouveau montant fixé.
- Impact pratique : Pour les locataires, cela amortit le choc financier d’un déplafonnement. Pour les bailleurs, cela signifie que le retour à la pleine valeur locative sera progressif.
Nouveaux indices de référence pour l’indexation
La loi Pinel a officialisé le remplacement de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) comme indice unique de référence pour l’indexation annuelle (clause d’échelle mobile) et le calcul du plafond de renouvellement. Désormais, les indices légaux sont :
- L’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) pour les activités commerciales et artisanales.
- L’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) pour les activités de bureau, logistiques et professions libérales. Ces indices (ILC et ILAT) sont réputés mieux refléter l’évolution économique des secteurs concernés que l’ICC, basé sur les coûts de construction. Les articles L. 145-34 et L. 145-38 du Code de commerce intègrent désormais ces indices.
- Impact pratique : L’évolution des loyers indexés est potentiellement plus corrélée à la performance économique du secteur d’activité du locataire. Les anciens baux peuvent continuer à utiliser l’ICC s’il était stipulé, mais les nouveaux contrats ou renouvellements utilisent ILC ou ILAT.
Répartition des charges, impôts et taxes plus encadrée
Pour améliorer la transparence, la loi Pinel a renforcé l’encadrement des charges imputables au locataire (article L. 145-40-2 C. com.) :
- Le contrat de bail doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec leur répartition.
- Un décret (n° 2014-1317 du 3 novembre 2014) liste les charges qui ne peuvent plus être imputées au locataire, notamment : les grosses réparations (art. 606 C. civ.), les honoraires de gestion des loyers par le bailleur, ou encore les impôts (comme la CET, sauf la taxe foncière et ses taxes additionnelles qui peuvent toujours être refacturées).
- Le bailleur doit fournir un récapitulatif annuel des charges au locataire.
- Impact pratique : Meilleure visibilité pour le locataire sur les coûts réels de la location et limitation des charges refacturables, notamment les grosses réparations et certains frais de gestion.
Droit de préemption du locataire en cas de vente des locaux
C’est une nouveauté majeure introduite par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal (hors bureaux, locaux monovalents, industriels ou logistiques) envisage de le vendre, il doit d’abord en informer le locataire. Cette notification vaut offre de vente au profit du preneur, qui dispose alors d’un droit de préemption.
- Procédure : Le propriétaire notifie au locataire le prix et les conditions de la vente envisagée (cette offre ne peut inclure des honoraires de négociation). Le locataire a un mois pour accepter. S’il accepte, il a ensuite deux mois (ou quatre s’il recourt à un prêt) pour réaliser la vente. Si le propriétaire décide finalement de vendre à des conditions ou un prix plus avantageux pour l’acquéreur, il doit re-notifier au locataire.
- Exceptions : Ce droit ne s’applique pas en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ou de cession à un proche parent du bailleur.
- Impact pratique : Véritable opportunité pour le locataire d’acquérir les murs de son entreprise. Pour le bailleur, c’est une formalité impérative à respecter sous peine de nullité de la vente.
Durée limitée de la garantie solidaire du cédant
Lorsqu’un locataire cède son bail (généralement avec son fonds de commerce), il était très fréquent que le bailleur exige qu’il reste « garant solidaire » du paiement des loyers par le nouveau locataire (le cessionnaire), et ce, parfois pour toute la durée restante du bail, voire ses renouvellements. L’article L. 145-16-2 du Code de commerce limite désormais la durée pendant laquelle le bailleur peut invoquer cette garantie solidaire à trois ans à compter de la cession.
- Impact pratique : Réduction significative du risque à long terme pour le cédant d’un fonds de commerce, facilitant ainsi les transmissions d’entreprises.
Encadrement des baux dérogatoires
La durée maximale des baux dérogatoires (qui échappent au statut) est passée de deux à trois ans au total (article L. 145-5 C. com.). Surtout, il n’est plus possible d’enchaîner indéfiniment ces baux courts pour le même fonds dans les mêmes locaux. Si le locataire est laissé en possession à l’issue des trois ans, un bail commercial de neuf ans soumis au statut s’applique automatiquement.
- Impact pratique : Limite les situations de précarité prolongée pour les locataires et clarifie le passage au statut protecteur.
État des lieux obligatoire
Un état des lieux contradictoire (ou établi par huissier si désaccord, frais partagés) est désormais obligatoire lors de l’entrée du locataire dans les locaux et lors de leur restitution (article L. 145-40-1 C. com.).
- Impact pratique : Vise à réduire les litiges fréquents en fin de bail concernant l’état des locaux et l’imputation des éventuelles dégradations.
L’impact de la crise sanitaire (COVID-19) : des mesures temporaires aux leçons durables
La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement ou de fermeture administrative ont bouleversé l’exécution de nombreux contrats, dont les baux commerciaux.
Suspension temporaire des sanctions pour non-paiement
Face aux difficultés économiques engendrées par les fermetures administratives, des ordonnances prises en 2020 (notamment l’ordonnance n° 2020-316) ont temporairement neutralisé les sanctions pour les entreprises éligibles qui ne pouvaient payer leurs loyers et charges pendant les périodes dites « protégées ». Étaient ainsi interdits les pénalités de retard, les intérêts, la mise en œuvre des clauses résolutoires, l’activation des garanties, ou encore les expulsions.
- Impact pratique : Ces mesures ont offert un répit temporaire mais n’ont pas annulé la dette de loyer. Elles ne sont plus en vigueur aujourd’hui (avril 2025).
L’échec des arguments « force majeure » et « exception d’inexécution »
De nombreux locataires ont tenté de soutenir que la fermeture administrative constituait un cas de force majeure ou justifiait une exception d’inexécution (suspension du paiement du loyer car le bailleur ne pouvait plus assurer une jouissance paisible) pour échapper au paiement des loyers durant les confinements. Cependant, la Cour de cassation a, dans une série de décisions rendues notamment en 2022 et 2023, majoritairement rejeté ces arguments. Elle a considéré que :
- La force majeure n’était généralement pas caractérisée car l’impossibilité de payer n’était pas absolue pour le débiteur (difficulté n’est pas impossibilité) et l’obligation de payer une somme d’argent n’est pas rendue impossible par un événement extérieur.
- L’obligation de délivrance du bailleur (mettre à disposition le local) avait été remplie, même si l’exploitation était empêchée par une décision administrative extérieure au bailleur. Le bailleur n’est pas garant de la « commercialité » ou de la possibilité d’exploiter imposée par l’État.
- Le risque d’exploitation (y compris le risque lié à une décision administrative) pèse sur le locataire.
- Impact pratique : La jurisprudence a confirmé que, sauf cas très exceptionnels, les loyers commerciaux restaient dus pendant les périodes de fermeture administrative imposée par la crise sanitaire. L’obligation de payer n’était pas suspendue de plein droit.
La bonne foi et la renégociation
Malgré le maintien de l’obligation de payer, les tribunaux ont souvent souligné l’importance de la bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil). Ils ont encouragé les parties, dans ces circonstances exceptionnelles, à discuter et à chercher des solutions amiables (reports, remises partielles…). L’absence de dialogue ou le refus systématique de négocier pouvait parfois être sanctionné.
- Impact pratique : La crise a rappelé que, même si le droit strict maintient les obligations, la négociation de bonne foi reste un outil essentiel pour gérer les imprévus dans une relation contractuelle de longue durée comme le bail commercial.
Le paysage juridique du bail commercial a donc connu des ajustements notables. La loi Pinel a apporté des clarifications et un certain rééquilibrage, tandis que la jurisprudence post-COVID a précisé l’étendue des obligations de chacun dans des circonstances exceptionnelles.
Ces évolutions législatives et jurisprudentielles modifient la gestion de votre bail commercial. Que vous soyez locataire ou bailleur, il est important de vérifier la conformité de votre contrat et de connaître vos droits et obligations à jour. Pour une assistance dans l’interprétation de votre bail ou pour vous accompagner dans vos négociations, notre cabinet d’avocats experts en baux commerciaux est à votre écoute.
Sources
- Code de commerce, articles L. 145-4, L. 145-5, L. 145-9, L. 145-14, L. 145-16-2, L. 145-34, L. 145-38, L. 145-40-1, L. 145-40-2, L. 145-41, L. 145-46-1.
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite loi Pinel).
- Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial.
- Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.
- Jurisprudence récente de la Cour de cassation (notamment concernant l’interprétation des mesures COVID).
- Code civil (principes généraux des obligations et des contrats).