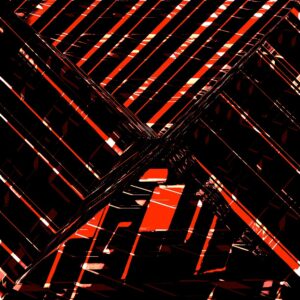Vous avez obtenu gain de cause. Le juge a tranché en votre faveur. Vous disposez d’un titre exécutoire. Pourtant, votre créance reste impayée car le débiteur bénéficie d’une immunité d’exécution. Cette situation paradoxale mérite qu’on s’y attarde.
Qu’est-ce que l’immunité d’exécution?
L’immunité d’exécution constitue un privilège qui permet à certaines personnes, en raison d’une qualité qui leur est propre, d’échapper à l’obligation d’exécuter les jugements et actes. Ce mécanisme, qui semble contradictoire avec le droit à l’exécution, trouve sa base légale à l’article L.111-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution : « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution ».
En pratique, cela signifie que malgré un titre exécutoire valide, vous ne pourrez pas saisir les biens du débiteur bénéficiant de cette immunité.
Les immunités en droit interne : la protection des personnes publiques
En droit français, les personnes morales de droit public bénéficient traditionnellement d’une immunité d’exécution. Ce principe, consacré par la jurisprudence, a été codifié à l’article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1er sont insaisissables ».
Cela concerne:
- L’État
- Les collectivités territoriales et leurs groupements
- Les établissements publics
- D’autres personnes publiques comme la Banque de France
Cette immunité est justifiée par plusieurs motifs:
- La certitude de solvabilité des personnes publiques
- Les règles de comptabilité publique
- La nécessité de continuité du service public
Si vous êtes créancier d’une personne publique, vous devrez utiliser d’autres voies que l’exécution forcée, comme les procédures d’ordonnancement et de mandatement d’office prévues par la loi du 16 juillet 1980.
L’immunité des États étrangers : une évolution en dents de scie
L’immunité d’exécution des États étrangers a connu une évolution jurisprudentielle importante, avant d’être consacrée par le législateur. Elle repose sur des fondements différents:
- La souveraineté étatique
- La courtoisie internationale
- Des considérations de politique internationale
La Cour de cassation avait posé un principe dans l’arrêt Eurodif (Civ. 1re, 14 mars 1984): l’immunité d’exécution des États étrangers est de principe, mais peut être écartée pour les biens affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé.
La jurisprudence a ensuite connu des fluctuations importantes, notamment sur la question de la renonciation à l’immunité par les États.
La loi Sapin 2 : un renforcement des immunités
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », est venue clarifier et durcir le régime des immunités d’exécution des États étrangers. Elle a introduit les articles L.111-1-1 à L.111-1-3 dans le code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions imposent:
- Une autorisation préalable du juge pour toute mesure d’exécution contre un État étranger
- Des conditions strictes pour obtenir cette autorisation
- Une protection renforcée pour les biens affectés aux missions diplomatiques
Comme l’a souligné la doctrine, cette réforme a constitué un véritable retour en arrière par rapport à l’évolution jurisprudentielle antérieure. D’après Bismuth (JDI 2018), « la loi Sapin 2 marque un retour à une conception extensive de l’immunité d’exécution ».
Les conditions d’exécution contre un État étranger
L’article L.111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit trois cas alternatifs permettant l’exécution contre un État étranger:
- Lorsque l’État a expressément consenti à l’application de la mesure
- Lorsque l’État a réservé ou affecté le bien à la satisfaction de la demande
- Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien est utilisé à des fins non publiques et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée
La troisième condition est assortie d’exceptions importantes. Sont notamment exclus:
- Les biens diplomatiques et consulaires
- Les biens militaires
- Les biens du patrimoine culturel
- Les biens des expositions scientifiques ou culturelles
- Les créances fiscales ou sociales
En pratique, il reste peu de biens saisissables.
La renonciation à l’immunité : deux conditions cumulatives
L’article L.111-1-3 du code ajoute une protection spécifique pour les biens diplomatiques. Pour ces derniers, l’exécution n’est possible qu’en cas de renonciation expresse ET spéciale des États concernés.
Cette exigence d’une double condition a été confirmée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 10 janvier 2018 (n°16-22.494), a jugé que « la renonciation d’un État à son immunité d’exécution doit être non seulement expresse mais aussi spéciale, en visant des biens ou une catégorie de biens déterminés sur lesquels il est envisagé de poursuivre l’exécution ».
Concrètement, une clause générale de renonciation à l’immunité dans un contrat commercial ne suffit pas.
Quels recours face aux immunités?
Quand on se heurte à une immunité d’exécution, le recouvrement direct devient impossible. Toutefois, des solutions alternatives existent:
Pour les personnes publiques françaises:
- Recours aux procédures d’ordonnancement et de mandatement d’office
- Demande d’astreinte administrative
- Saisine du préfet pour qu’il se substitue à la collectivité défaillante
Pour les États étrangers:
- Négociation diplomatique
- Action en responsabilité contre l’État français
Cette dernière option mérite un développement.
La responsabilité de l’État français: une échappatoire?
Lorsqu’un créancier ne peut obtenir paiement en raison d’une immunité d’exécution, il peut engager la responsabilité sans faute de l’État français pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Cette possibilité a été consacrée par l’arrêt du Conseil d’État du 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique. Elle suppose de démontrer un préjudice grave et spécial.
Historiquement, cette responsabilité était admise de façon très restrictive. Une évolution s’est produite avec les arrêts du Conseil d’État du 11 février 2011, Susilawati, et du 14 octobre 2011, qui ont assoupli les conditions d’engagement de cette responsabilité.
Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 2 juillet 2020, a confirmé cette tendance en admettant la responsabilité de l’État français du fait d’une immunité d’exécution qui faisait obstacle au recouvrement d’une créance.
Les enjeux sont substantiels pour les créanciers qui peuvent ainsi obtenir réparation du préjudice causé par l’impossibilité d’exécuter un titre exécutoire contre un État étranger.
Un cas typique? Un entrepreneur ayant conclu un contrat avec une ambassade étrangère, obtenant un jugement favorable puis se heurtant à l’immunité d’exécution. L’action en responsabilité contre l’État français pourrait constituer son ultime recours.
Le maniement des règles relatives aux immunités d’exécution requiert une expertise particulière, tant les subtilités jurisprudentielles et les évolutions législatives sont nombreuses. Un mauvais choix stratégique peut conduire à l’échec d’une procédure d’exécution et à des frais inutiles.
Avec l’internationalisation des échanges, ces situations deviennent plus fréquentes. Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse des possibilités d’exécution contre des débiteurs bénéficiant d’immunités et l’identification des stratégies optimales de recouvrement. Contactez-nous pour une première analyse de votre dossier.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L.111-1, L.111-1-1 à L.111-1-3
- Code général de la propriété des personnes publiques, article L.2311-1
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2)
- Cour de cassation, 1re civ., 14 mars 1984, Eurodif (Bull. civ. I, n°98)
- Cour de cassation, 1re civ., 10 janvier 2018, n°16-22.494
- Conseil d’État, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique
- Conseil d’État, 11 février 2011, Susilawati, req. n°325253
- BISMUTH R., « L’immunité d’exécution après la loi Sapin 2 », JDI 2018, Doctr. 4
- BOLLÉE S., « Les dispositions de la loi Sapin 2 relatives à l’immunité d’exécution », D. 2016, p. 2560
- RISSER J., « Retour à la stabilité pour le droit français de l’immunité d’exécution », Revue pratique du recouvrement, mars 2021, p. 3