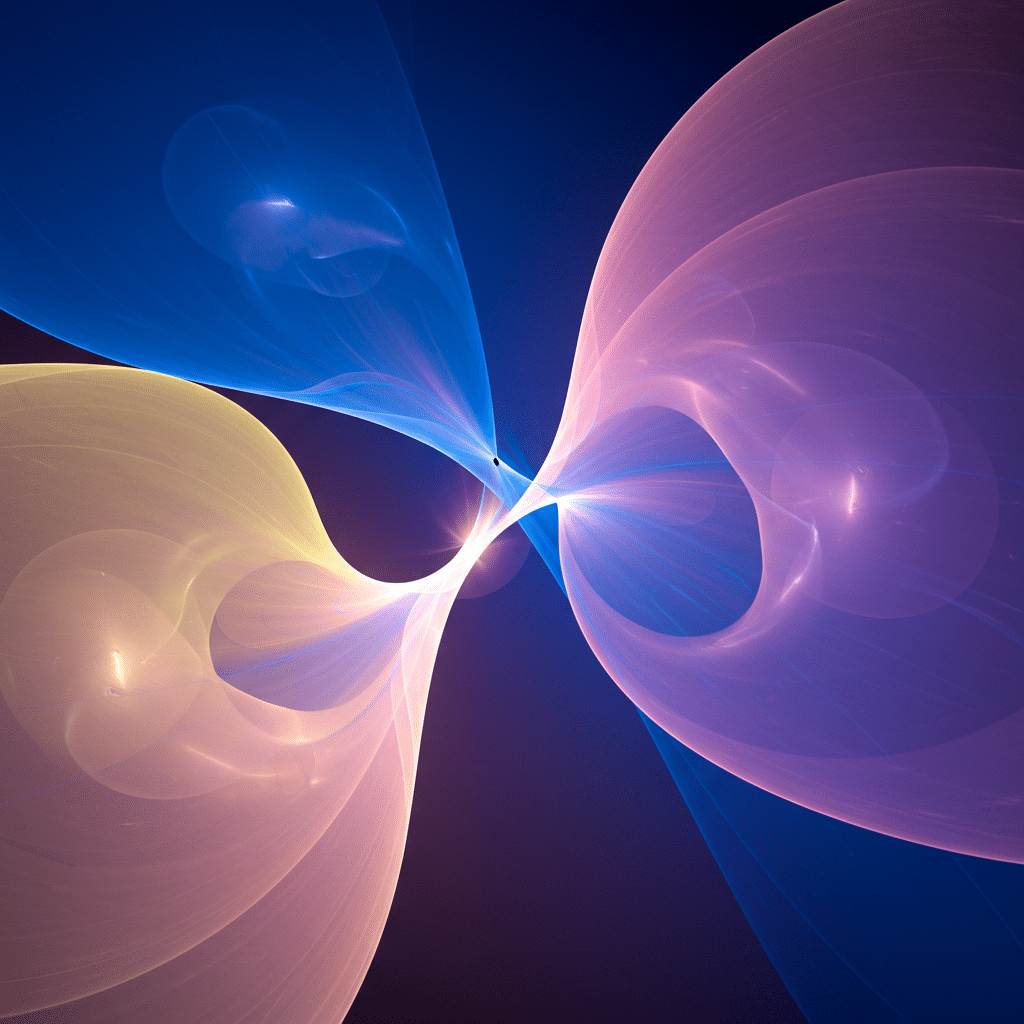Votre entreprise a livré des marchandises ou réalisé une prestation, mais votre client tarde à régler sa facture. Pire, vous apprenez qu’il semble vendre ses biens ou vider ses comptes professionnels pour échapper à ses obligations. Cette situation, malheureusement fréquente, peut mettre en péril la santé financière de votre activité. Face à cette angoisse légitime, le droit français offre des outils pour agir préventivement : les mesures conservatoires. Il s’agit de mécanismes juridiques permettant de « geler » certains biens de votre débiteur pour garantir le paiement futur de ce qu’il vous doit.
Comprendre ces outils est essentiel pour tout créancier, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un particulier, souhaitant sécuriser ses droits avant qu’il ne soit trop tard. Cet article vous présente ces mécanismes : que sont-ils exactement, pourquoi y recourir et, surtout, quelles conditions remplir pour pouvoir les utiliser ?
Qu’est-ce qu’une mesure conservatoire ?
Une mesure conservatoire, comme son nom l’indique, vise à conserver le patrimoine de votre débiteur. L’objectif fondamental, défini par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), est d’assurer la sauvegarde de vos droits en rendant indisponibles certains biens appartenant à celui qui vous doit de l’argent. Pensez à une sorte de « mise en attente » juridique sur ces biens, empêchant le débiteur d’organiser son insolvabilité pendant que vous faites valoir vos droits.
Le patrimoine de votre débiteur constitue en effet, selon le principe général du droit de gage énoncé à l’article 2284 du Code civil, la garantie de paiement pour ses créanciers. Les mesures conservatoires permettent de préserver cette garantie.
Il existe deux grandes familles de mesures conservatoires :
- Les saisies conservatoires, qui visent à bloquer matériellement des biens (meubles, argent sur un compte bancaire…).
- Les sûretés judiciaires (hypothèque ou nantissement), qui consistent à prendre une garantie spécifique sur un bien de valeur (immeuble, fonds de commerce…) pour obtenir une priorité en cas de vente.
Ces différentes mesures feront l’objet d’explications détaillées dans d’autres articles de notre blog. Ce qu’il faut retenir ici, c’est leur caractère provisoire. Elles sont prises dans l’attente soit d’une décision de justice définitive condamnant le débiteur à payer, soit de la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée (comme une saisie-vente). Ce ne sont pas des fins en soi, mais des étapes pour sécuriser une créance.
Pourquoi utiliser une mesure conservatoire ?
Recourir à une mesure conservatoire peut s’avérer judicieux dans plusieurs situations :
- L’urgence d’agir : Lorsque vous avez des raisons sérieuses de croire que votre débiteur tente de se rendre insolvable, une mesure conservatoire permet d’agir vite pour protéger ce qui peut encore l’être.
- L’effet de surprise : La procédure permettant d’obtenir l’autorisation de prendre une mesure conservatoire se déroule généralement sans que le débiteur en soit informé initialement. Cet effet de surprise est souvent déterminant pour empêcher la disparition des biens et peut aussi inciter le débiteur à régler sa dette volontairement pour obtenir la levée de la mesure.
- Sécuriser la créance pendant un procès : Un procès peut durer longtemps. Pendant ce temps, le débiteur pourrait vider ses comptes ou vendre ses biens. Une mesure conservatoire « gèle » une partie de son patrimoine, garantissant qu’il restera quelque chose à saisir si vous obtenez gain de cause.
- Prendre une garantie spécifique : Les sûretés judiciaires (hypothèque, nantissement) permettent d’obtenir un droit préférentiel sur un bien précis, vous donnant une priorité par rapport à d’autres créanciers sur le produit de la vente de ce bien.
Quelles sont les conditions indispensables pour agir ?
Prendre une mesure conservatoire est une action significative qui affecte les biens du débiteur. C’est pourquoi la loi encadre strictement son utilisation. Vous devez impérativement réunir deux conditions cumulatives, prévues par l’article L. 511-1 du CPCE : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. C’est à vous, créancier, qu’il appartient de prouver au juge que ces deux conditions sont remplies.
Une créance qui semble fondée (l’apparence de bon droit)
La première condition est de justifier d’une créance qui paraît fondée en son principe. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Le législateur emploie volontairement une formule souple. Contrairement aux mesures d’exécution forcée (comme une saisie-attribution après jugement définitif) qui exigent une créance certaine, liquide (chiffrée exactement) et exigible (arrivée à échéance), la mesure conservatoire peut être autorisée sur la base d’une créance qui semble juste, c’est-à-dire dont l’existence est suffisamment vraisemblable ou crédible aux yeux du juge.
Il n’est donc pas nécessaire que votre créance soit absolument incontestable à ce stade. Une simple apparence de droit suffit. Par exemple :
- Une facture impayée accompagnée d’un bon de commande signé et d’un bon de livraison.
- Un contrat écrit dont vous pouvez démontrer la violation par le débiteur (ex : non-respect d’une obligation de paiement).
- Une reconnaissance de dette signée par le débiteur.
- Un jugement de condamnation, même s’il n’est pas encore définitif car frappé d’appel.
De même, il n’est pas requis que le montant de la créance soit déterminé avec une précision absolue. Si votre créance n’est pas encore liquide (par exemple, une demande de dommages-intérêts dont le montant exact sera fixé par le juge du fond), vous devrez en fournir une évaluation provisoire. Le juge appréciera si cette évaluation est raisonnable au vu des éléments fournis.
Enfin, la créance n’a pas besoin d’être immédiatement exigible. Une mesure conservatoire peut être autorisée pour garantir une créance à terme (dont l’échéance n’est pas encore arrivée), si les autres conditions sont réunies.
Le rôle du juge saisi de la demande d’autorisation est essentiel : il doit apprécier la vraisemblance de votre créance, son « apparence de fondement ». Il ne tranche pas le litige sur le fond à ce stade, mais évalue si votre demande repose sur des éléments suffisamment sérieux pour justifier une mesure conservatoire. Son appréciation est souveraine, mais elle se fonde sur les pièces que vous lui soumettez. Une créance purement hypothétique ou manifestement contestable ne permettra pas d’obtenir l’autorisation.
Une menace réelle sur le recouvrement
La seconde condition, tout aussi importante, est de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de votre créance. Il ne suffit pas de dire « mon débiteur ne m’a pas payé à l’échéance ». Un simple retard de paiement, si le débiteur est par ailleurs solvable, ne caractérise pas en soi une menace suffisante.
Vous devez montrer qu’il y a un risque particulier que vous ne soyez jamais payé si rien n’est fait rapidement. Cette menace peut résulter de divers facteurs, appréciés au cas par cas par le juge. Voici quelques exemples tirés de situations réelles :
- La situation financière précaire du débiteur : Des pertes importantes récentes, un compte bancaire systématiquement débiteur, l’absence de publication des comptes annuels, des dettes accumulées auprès d’autres créanciers (Trésor public, organismes sociaux…).
- Le comportement du débiteur :
- Il vend précipitamment ses biens (voiture, immeuble…).
- Il déménage sans laisser d’adresse ou part s’installer à l’étranger.
- Il garde le silence face à vos relances et mises en demeure répétées, sans justifier son refus de payer.
- Il a déjà tenté par le passé d’organiser son insolvabilité.
- Il n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu connu (ce critère doit être manié avec précaution et combiné à d’autres).
- Le contexte juridique ou économique : D’autres créanciers ont déjà pris des inscriptions (privilèges, hypothèques) sur les biens du débiteur, réduisant d’autant vos chances d’être payé. L’absence d’assurance obligatoire pour couvrir sa responsabilité (dans certains secteurs comme la construction) peut aussi constituer une menace pour l’indemnisation future.
Attention, certains éléments ne suffisent généralement pas, à eux seuls, à prouver la menace :
- Le simple fait que le débiteur conteste la créance, s’il présente par ailleurs des garanties de solvabilité.
- Le seul fait que vous disposiez déjà d’un titre exécutoire (même si cela vous dispense de l’autorisation préalable, la menace doit quand même exister).
C’est bien au créancier de démontrer l’existence de ces circonstances menaçantes, en fournissant au juge des éléments concrets (bilans, lettres de relance sans réponse, preuves de ventes suspectes, etc.). Si le débiteur conteste ultérieurement la mesure, la charge de prouver que les conditions, y compris la menace, étaient bien réunies (et le sont toujours) pèsera toujours sur le créancier.
Ces deux conditions – créance paraissant fondée et menace sur le recouvrement – sont le socle indispensable pour envisager une mesure conservatoire. Leur réunion permet de justifier une atteinte provisoire aux biens du débiteur dans le but légitime de protéger les droits du créancier.
Les mesures conservatoires sont des outils puissants mais leur mise en œuvre nécessite une analyse précise de la situation et le respect de conditions strictes. Pour une analyse personnalisée de votre situation et déterminer si une mesure conservatoire est adaptée pour protéger votre créance, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil
- Code pénal
- Code de l’organisation judiciaire