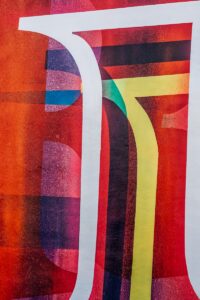La procédure civile française a connu une mutation profonde ces dernières années. La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a initié un bouleversement majeur. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a ensuite concrétisé cette refonte. Ces textes modifient la structure judiciaire et transforment les règles procédurales. Pour les justiciables comme pour les professionnels du droit, ces changements imposent une adaptation rapide.
La création du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire constitue l’innovation structurelle la plus visible. Né de la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance, il simplifie l’organisation judiciaire.
L’article 95, I, 1° de la loi n°2019-222 a créé cette juridiction unifiée. Le décret n°2019-965 du 18 septembre 2019 a ensuite substitué le tribunal judiciaire aux anciennes juridictions dans tous les textes réglementaires.
Cette fusion génère des conséquences concrètes :
- Un guichet unique pour les justiciables
- Une simplification du parcours judiciaire
- Une rationalisation des moyens
Un litige civil relève désormais d’une seule juridiction. Finie l’hésitation entre tribunal d’instance et tribunal de grande instance. Cette unification évite les erreurs d’orientation et les exceptions d’incompétence qui ralentissaient les procédures.
Les nouveaux modes de saisine
La réforme unifie les modes de saisine. Ne subsistent désormais que la requête et l’assignation.
Unification et simplification
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a supprimé certains modes de saisine spécifiques. Plus de déclaration au greffe ni de présentation volontaire des parties. Cette uniformisation facilite l’accès au juge.
L’assignation avec « prise de date »
La réforme généralise l’assignation avec « prise de date ». Ce mécanisme existait déjà devant certaines juridictions. Il s’étend maintenant à l’ensemble des tribunaux judiciaires.
L’huissier ou l’avocat doit obtenir une date d’audience avant de délivrer l’assignation. Cette procédure évite les renvois stériles et accélère le traitement des affaires. Elle suppose toutefois une coordination plus étroite entre les professionnels du droit et les greffes.
La procédure sans audience
Innovation majeure : la procédure sans audience. Les parties peuvent désormais consentir à ce que leur affaire soit jugée sans comparution.
Cette option s’inscrit dans une logique d’économie procédurale. Elle convient particulièrement aux dossiers simples ou documentés. Les parties transmettent leurs écritures et pièces. Le juge statue sur cette base.
Pour en bénéficier, l’accord explicite des parties reste indispensable. Le décret crée ainsi une justice « sur mesure » adaptée aux besoins des justiciables.
Le développement des modes amiables
La justice traditionnelle coûte cher. Elle prend du temps. La réforme valorise donc les modes alternatifs de résolution des différends.
Une tentative préalable obligatoire
Pour certains litiges, la tentative de règlement amiable devient un préalable obligatoire. Sans cette démarche, la demande en justice sera irrecevable.
Cette obligation concerne notamment les litiges de faible montant et certains conflits de voisinage. Elle vise à désengorger les tribunaux et à promouvoir des solutions consensuelles.
Les justiciables doivent donc tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de saisir le juge. Cette exigence suppose une anticipation et une stratégie processuelle repensée.
Un régime assoupli pour la convention participative
La procédure participative bénéficie d’un cadre juridique plus souple. Cette procédure permet aux parties assistées de leurs avocats de travailler ensemble à la résolution de leur litige.
Le décret facilite l’homologation des accords issus de cette démarche. Il simplifie également la mise en œuvre de mesures d’instruction dans ce cadre conventionnel.
Ces modifications visent à rendre la procédure participative plus attractive. Elles soulignent la volonté du législateur de promouvoir une justice négociée plutôt qu’imposée.
Les autres innovations procédurales
La réforme comporte d’autres mesures significatives qui transforment la physionomie du procès civil.
Des pouvoirs élargis pour le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état peut désormais statuer sur toutes les fins de non-recevoir. Cette extension de compétence accélère le traitement des incidents procéduraux.
Auparavant, certaines fins de non-recevoir relevaient de la formation collégiale. Ce transfert de compétence simplifie le parcours procédural et évite des lenteurs inutiles.
Une simplification des exceptions d’incompétence
Les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire se trouvent simplifiées. Un simple renvoi devant le juge compétent remplace désormais une procédure plus formelle.
Cette mesure pragmatique évite les débats chronophages sur la compétence interne. Elle accélère la résolution des litiges en évitant des incidents dilatoires.
Une extension de la représentation obligatoire par avocat
Le champ de la représentation obligatoire par avocat s’élargit considérablement. Cette obligation s’étend notamment :
- Aux procédures de référé
- Aux procédures d’expropriation
- Aux révisions de baux commerciaux
- À certaines procédures familiales
- Aux procédures devant le tribunal de commerce
Cette extension modifie l’équilibre économique de nombreux contentieux. Elle garantit une meilleure défense des justiciables mais renchérit le coût d’accès à la justice.
L’exécution provisoire de droit
La réforme consacre le principe de l’exécution provisoire de droit des décisions de justice. Les jugements deviennent immédiatement exécutoires, même en cas d’appel.
Seules certaines matières échappent à cette règle. Des dispositions législatives peuvent également prévoir une exécution provisoire facultative.
Cette nouveauté bouleverse la stratégie contentieuse. L’appel ne suspend plus automatiquement l’exécution. Les justiciables doivent anticiper cette conséquence lorsqu’ils contestent une décision défavorable.
Les enjeux pratiques s’avèrent considérables. Un justiciable condamné doit exécuter la décision même s’il la conteste. Il risque sinon des mesures d’exécution forcée. En cas d’infirmation en appel, il pourra certes obtenir restitution, mais après des délais parfois longs.
Ces réformes transforment la physionomie du procès civil français. Elles visent une justice plus rapide, plus accessible et plus efficace. Elles imposent cependant une vigilance accrue des justiciables et de leurs conseils.
Un avocat saura vous guider dans ce paysage juridique renouvelé. Il identifiera les opportunités et les risques liés à ces nouvelles procédures. Dans un contexte d’incertitude jurisprudentielle, son expertise technique constitue un atout décisif. Contactez notre cabinet pour une analyse personnalisée de votre situation.
Sources
- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JO 24 mars)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (JO 12 déc.)
- Décret n°2019-965 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire
- Code de procédure civile, articles 514 à 526 (exécution provisoire)
- Code de procédure civile, article 776 (juge de la mise en état)
- Opposition, Marie-Emma BOURSIER, Répertoire de procédure civile, Dalloz (2014)