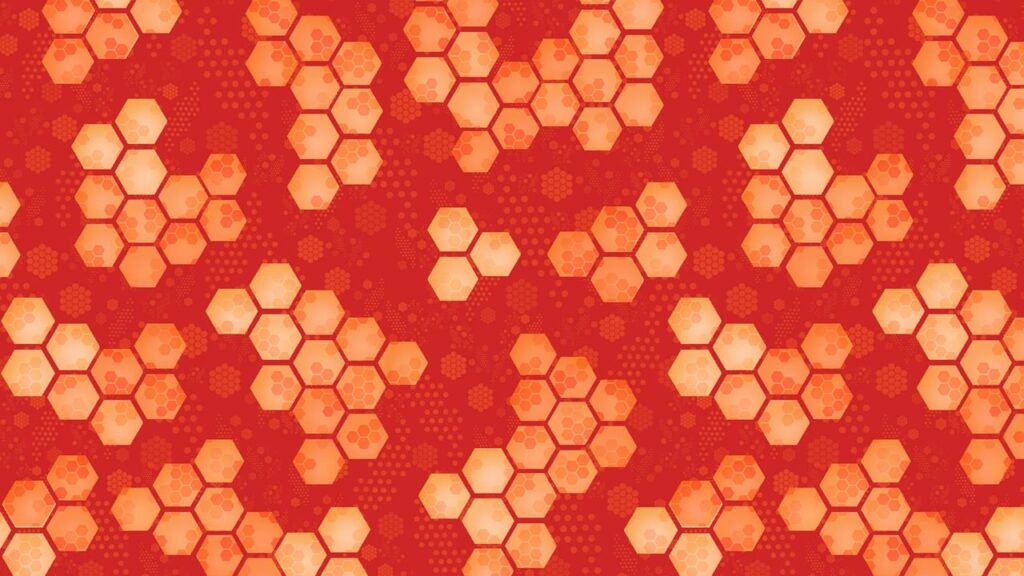« `html
Dans un environnement économique imprévisible, les créanciers cherchent à sécuriser leurs créances. Les sûretés réelles mobilières constituent un mécanisme efficace pour garantir le recouvrement d’une dette sans mobiliser de biens immobiliers. Ces instruments juridiques offrent une protection accrue aux créanciers qui souhaitent limiter les risques de non-paiement.
Les quatre types de sûretés mobilières selon l’article 2329 du Code civil
L’article 2329 du Code civil, issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, énumère quatre catégories de sûretés réelles mobilières, dont la définition, la classification et les règles de constitution ont été modernisées et simplifiées par l’ordonnance de 2021 :
Les privilèges mobiliers
Ces sûretés légales confèrent un droit de préférence à certains créanciers en raison de la qualité de leur créance. L’article 2330 du Code civil précise que les privilèges sont « accordés par la loi » – ils ne résultent jamais d’une convention entre les parties.
Les privilèges mobiliers se divisent en deux catégories :
- Les privilèges généraux qui portent sur l’ensemble des meubles du débiteur (frais de justice, frais funéraires, salaires…)
- Les privilèges spéciaux qui grèvent un bien déterminé (privilège du bailleur, du conservateur, du vendeur de meuble…)
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a réduit leur nombre de 9 à 4 pour les privilèges spéciaux, et de 8 à 4 pour les privilèges généraux.
Le gage des meubles corporels
Le gage est défini à l’article 2333 du Code civil comme « une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »
Il présente deux formes :
- Le gage avec dépossession : le débiteur remet le bien au créancier
- Le gage sans dépossession : le débiteur conserve l’usage du bien
Le gage est toujours conventionnel. Son efficacité tient notamment au droit de rétention qu’il confère au créancier gagiste. On notera que les régimes des gages et nantissements ont connu une simplification majeure, notamment via l’ordonnance de 2021.
Le nantissement des meubles incorporels
Le nantissement constitue l’équivalent du gage pour les biens incorporels. L’article 2355 du Code civil le définit comme « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. »
Le nantissement peut porter sur :
- Des créances
- Des parts sociales
- Des fonds de commerce
- Des brevets…
C’est la seule sûreté mobilière pouvant être soit conventionnelle, soit judiciaire.
La propriété retenue ou cédée à titre de garantie
Cette catégorie regroupe :
- La clause de réserve de propriété
- La fiducie-sûreté
- La cession de créance à titre de garantie
L’article 2372-1 du Code civil organise le régime juridique de la propriété retenue à titre de garantie. L’avantage principal de ces mécanismes : le créancier bénéficie d’un droit exclusif sur le bien, lui permettant d’échapper au concours avec les autres créanciers.
Le droit de rétention : une sûreté atypique
Bien que non mentionné à l’article 2329, le droit de rétention joue un rôle central en matière de sûretés mobilières. Il permet au créancier de retenir un bien jusqu’au paiement complet de sa créance.
La Cour de cassation refuse de le qualifier de sûreté (Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915), préférant y voir un droit réel opposable erga omnes (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.152).
Malgré cette controverse doctrinale, son efficacité est désormais consacrée par l’article L. 643-8 du Code de commerce, qui le place hors concours dans l’ordre des créanciers en cas de procédure collective.
Les caractéristiques des sûretés mobilières
Sûretés générales vs spéciales
Une sûreté mobilière est dite générale lorsqu’elle porte sur l’ensemble des meubles du débiteur. Elle est spéciale quand elle ne concerne que certains biens déterminés.
Seuls les privilèges mobiliers peuvent être généraux. Les autres sûretés (gage, nantissement, propriété-sûreté) sont nécessairement spéciales.
Sûretés avec ou sans dépossession
La question de la dépossession constitue un critère distinctif majeur. Comme le souligne N. Martial-Braz, « la distinction entre sûretés avec et sans dépossession revêt une importance particulière en matière mobilière » (RD bancaire et fin. 2014, dossier 35, n° 5).
Cette distinction influence :
- L’opposabilité de la sûreté aux tiers
- Les droits d’usage et de jouissance du bien grevé
- Les modalités de réalisation de la sûreté
Le gage peut être avec ou sans dépossession, tandis que le droit de rétention implique par nature une dépossession du débiteur.
Sûretés conférant un droit de préférence vs un droit exclusif
Les sûretés traditionnelles (privilèges, gage sans rétention, nantissement simple) confèrent un droit de préférence : le créancier est payé avant les créanciers chirographaires, mais reste soumis au concours avec d’autres créanciers privilégiés. Il est essentiel de comprendre la hiérarchie complexe des sûretés mobilières et l’ordre de priorité des créanciers pour sécuriser sa position, en particulier en cas de procédure collective.
En revanche, certaines sûretés offrent un droit exclusif sur le bien, permettant au créancier d’échapper totalement au concours :
- Le droit de rétention
- La propriété-sûreté
L’article L. 643-8 du Code de commerce reconnaît expressément cette exclusivité en cas de procédure collective, en plaçant ces droits « hors concours ».
La sûreté réelle constituée par un tiers
Longtemps qualifiée de « cautionnement réel », cette technique permet à un tiers de garantir la dette d’autrui en affectant un de ses biens en garantie.
Après une jurisprudence controversée (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005), l’ordonnance du 15 septembre 2021 a clarifié son régime juridique. Le nouvel article 2325 du Code civil dispose qu’ »une sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers » et rend applicables certaines règles du cautionnement.
Cette hybridation restaure le caractère mixte de cette garantie, même si le législateur n’a pas repris l’expression « cautionnement réel ».
Dans un environnement économique complexe et en constante évolution, le choix et la mise en œuvre des sûretés mobilières demandent une expertise juridique pointue. Pour maîtriser les stratégies de protection de vos créances professionnelles et bénéficier d’une expertise approfondie pour choisir les garanties adaptées, l’accompagnement d’un avocat est essentiel afin d’optimiser la sécurité de vos opérations et d’anticiper les risques de défaillance.
Sources
- Code civil, articles 2329 à 2375
- Code de commerce, article L. 643-8
- Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés
- Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915, JurisData n° 1997-002191
- Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.152, JurisData n° 2009-049541
- P. Simler, « Sûretés sur les meubles – Présentation générale et classement », JurisClasseur Civil Code, Art. 2329, Fasc. unique, 17 février 2023
- N. Martial-Braz, « Sûretés avec et sans dépossession, une summa divisio désuète ? », RD bancaire et fin. 2014, dossier 35, n° 5
- L. Bougerol, « Sûretés préférentielles et sûretés exclusives, une autre summa divisio ? », RD bancaire et fin. 2014, dossier 36, n° 5
« `