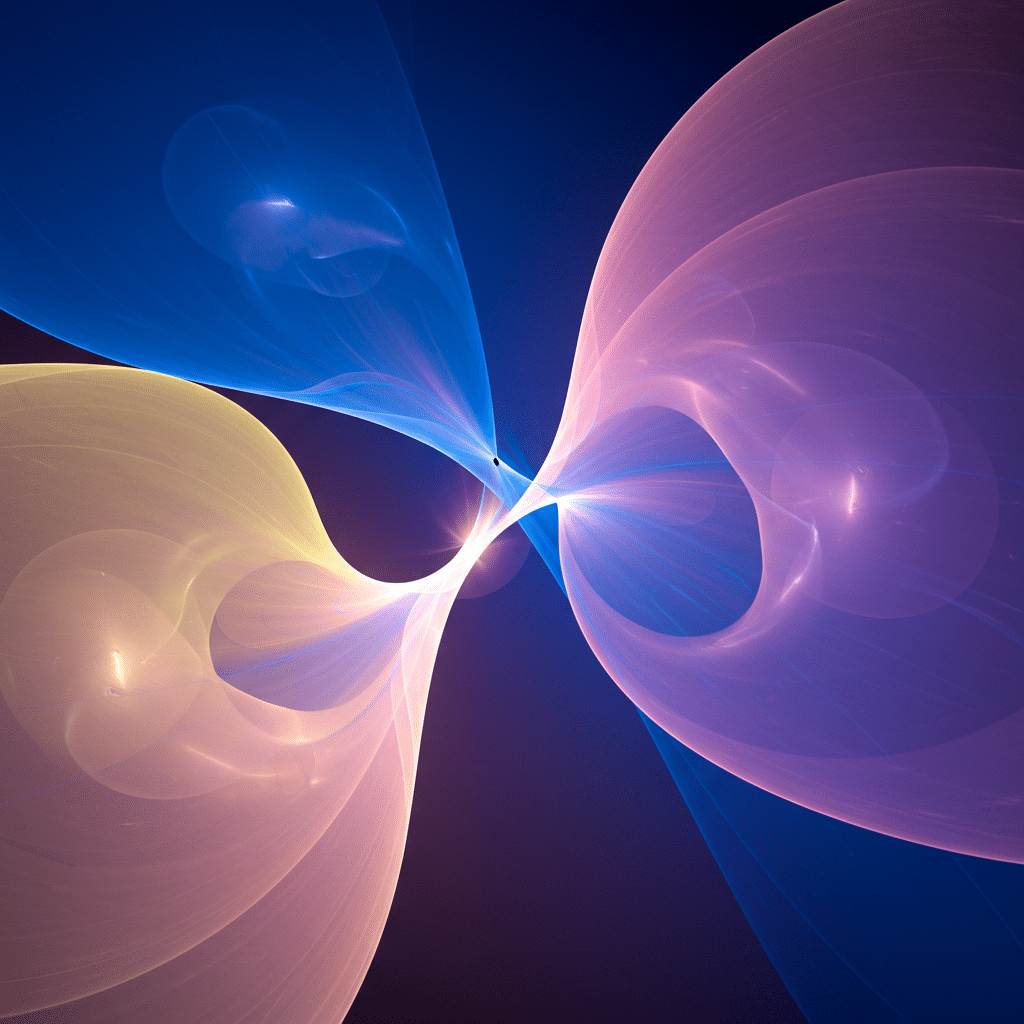Vous avez obtenu gain de cause devant la justice, mais la partie adverse reste silencieuse. C’est là qu’intervient l’exécution forcée, un ensemble de procédures permettant de contraindre un débiteur récalcitrant à respecter ses obligations. Voyons ensemble comment fonctionne ce mécanisme essentiel à l’effectivité de notre système judiciaire.
Qu’est-ce que l’exécution forcée ?
L’exécution forcée représente l’ensemble des procédures qui permettent à un créancier de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations, notamment lorsque ce dernier refuse de s’exécuter volontairement. Elle constitue le prolongement nécessaire du procès, car une décision de justice qui ne pourrait être mise en œuvre perdrait toute utilité.
Ce principe fondamental est posé par l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. »
Ce droit s’exerce dans le respect d’un équilibre entre l’intérêt légitime du créancier à recouvrer sa créance et la protection des droits fondamentaux du débiteur.
L’exécution forcée peut prendre différentes formes selon la nature de l’obligation concernée :
- Pour une obligation de payer : saisies sur compte bancaire, sur salaire, sur biens mobiliers ou immobiliers,
- Pour une obligation de faire ou de donner : astreintes, expulsions, remises forcées de biens.
L’exécution forcée n’est pas toujours précédée d’une démarche amiable ou d’un avertissement. En effet, le créancier doit pouvoir profiter d’un effet de surprise, pour empêcher le débiteur de s’organiser pour ne pas payer.
Quelles sont les conditions de l’exécution forcée ?
Pour mettre en œuvre une procédure d’exécution forcée, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies.
La créance liquide et exigible
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour procéder à une mesure d’exécution forcée, le créancier doit être muni :
- d’un titre exécutoire : la créance doit être fondée sur un titre valable qui établit clairement les droits du créancier.
- constatant une créance liquide : le montant de la créance doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable par un simple calcul mathématique sans nécessiter une nouvelle appréciation des parties ou du juge. L’article L111-6 précise qu’une « créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
- et exigible : la créance doit être arrivée à échéance, ce qui signifie que le délai de paiement est expiré. Une créance soumise à un terme ou une condition qui n’est pas encore réalisée ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
Par exemple, si vous avez obtenu un jugement vous accordant 10 000 euros de dommages et intérêts payables dans un délai de deux mois, votre créance ne deviendra exigible qu’à l’expiration de ce délai, et c’est seulement à partir de ce moment que vous pourrez engager des mesures d’exécution forcée.
La formule exécutoire
Pour procéder à une exécution forcée, le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dresse une liste limitative de ces titres :
- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif et les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
- Les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
- Les titres délivrés par les huissiers de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement
La formule exécutoire, apposée sur les décisions de justice et les actes notariés, est ce qui leur confère la force contraignante nécessaire à l’exécution forcée. Son contenu est déterminé par la loi : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution… »
Cette formule n’est pas une simple formalité : elle traduit la délégation par l’État de son pouvoir de contrainte à un officier ministériel (le commissaire de justice) pour faire respecter les décisions de justice.
La signification
Dans la majorité des cas, avant toute mesure d’exécution forcée, le titre exécutoire doit être signifié au débiteur. La signification est la remise officielle d’un acte par un commissaire de justice au destinataire de cet acte.
Cette signification remplit plusieurs fonctions essentielles :
- Elle informe officiellement le débiteur de l’existence du titre exécutoire,
- Elle lui précise la nature et l’étendue de ses obligations,
- Elle lui indique les conséquences de son inexécution,
- Elle fait courir certains délais légaux.
Dans certains cas particuliers, notamment pour les saisies conservatoires, la mesure d’exécution peut avoir lieu avant que le titre exécutoire ne soit signifié.
Les horaires de l’exécution
L’exécution forcée, bien que légitime, doit respecter certaines limites temporelles pour préserver la dignité des personnes concernées et leur vie privée. L’article L. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution fixe des règles strictes :
« Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, à moins qu’elle ne soit autorisée par le juge en cas de nécessité.
Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant 6 heures et après 21 heures sans l’autorisation du juge de l’exécution, sauf en cas de nécessité lorsque l’exécution a été commencée pendant les heures légales et qu’elle n’a pas pris fin à 21 heures. »
Ces restrictions visent à concilier l’efficacité des procédures d’exécution avec le respect de la vie privée et familiale des débiteurs. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le juge de l’exécution dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’il existe un risque de disparition imminente des biens.
Qui sont les acteurs de l’exécution ?
L’exécution forcée met en jeu plusieurs intervenants dont les rôles sont strictement définis par la loi.
La République française
La référence à la République française dans la formule exécutoire n’est pas une simple tradition : elle symbolise que l’exécution forcée s’exerce au nom de la puissance publique. L’État délègue temporairement son pouvoir de contrainte au commissaire de justice pour faire respecter les décisions de justice.
Cette délégation implique que le commissaire de justice peut, si nécessaire, requérir le concours de la force publique (police ou gendarmerie) pour surmonter les éventuelles résistances. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose ainsi que « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. »
Le Ministère public
Le procureur de la République joue un rôle important dans le cadre de l’exécution forcée :
- Il peut requérir la force publique pour prêter main-forte au commissaire de justice,
- Il veille au respect des libertés individuelles dans le cadre des procédures d’exécution,
- Il intervient dans certaines procédures spécifiques, comme les saisies des rémunérations ou les expulsions.
Son intervention garantit que l’exécution forcée se déroule dans le respect des droits fondamentaux des parties concernées.
Le commissaire de justice
Le commissaire de justice (qui a remplacé l’huissier de justice depuis le 1er juillet 2022) est l’acteur central de l’exécution forcée. Officier ministériel et public, il est investi de prérogatives de puissance publique qui lui permettent de mettre en œuvre les mesures d’exécution.
Ses missions dans le cadre de l’exécution forcée sont multiples :
- Signifier les actes de procédure et les titres exécutoires,
- Mettre en œuvre les différentes mesures d’exécution (saisies, expulsions…),
- Dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire,
- Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de créances,
- Effectuer des constats à la demande des parties ou du juge.
Le commissaire de justice est soumis à un statut strict et à des règles déontologiques précises. Il doit agir avec impartialité, même s’il est mandaté par le créancier, et respecter la dignité du débiteur tout au long de la procédure.
L’immunité d’exécution
Certaines personnes ou entités bénéficient d’une immunité d’exécution, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas faire l’objet de mesures d’exécution forcée ou que ces mesures sont soumises à des restrictions particulières.
Les principales immunités d’exécution concernent :
- Les États étrangers : en vertu du principe de souveraineté, les biens d’un État étranger bénéficient d’une immunité d’exécution, sauf pour les biens affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé. Cette règle a été précisée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
- Les missions diplomatiques et consulaires : leurs biens bénéficient d’une protection particulière conformément aux conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
- Certaines organisations internationales : en fonction des accords de siège conclus avec la France.
- Les biens des collectivités publiques françaises : les biens appartenant au domaine public sont insaisissables, ainsi que les fonds publics destinés à des missions de service public.
- Certains biens des particuliers : par exemple, les biens déclarés insaisissables par la loi (comme le mobilier nécessaire à la vie quotidienne, les outils professionnels, etc.).
Ces immunités ne sont pas absolues et peuvent être levées dans certaines circonstances, notamment par renonciation expresse de leur bénéficiaire ou par décision judiciaire.
Foire aux questions
Est-ce que l’appel suspend l’exécution forcée d’une décision civile ?
En principe, non. L’article 514 du code de procédure civile pose le principe que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Cela signifie que l’appel n’a pas, en lui-même, d’effet suspensif.
Toutefois, ce principe connaît plusieurs exceptions :
- L’exécution provisoire : si le jugement n’a pas été assorti de l’exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel si celui-ci est formé.
- La suspension de l’exécution provisoire: même si le jugement bénéficie de l’exécution provisoire, celle-ci peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président de la cour d’appel si deux conditions sont réunies :
- L’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
- Il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
- Les cas particuliers : certaines décisions ne sont jamais assorties de l’exécution provisoire (comme les jugements qui modifient l’état des personnes), d’autres le sont toujours (comme les ordonnances de référé).
Il est donc essentiel de vérifier, au cas par cas, si la décision que l’on souhaite exécuter ou dont on fait l’objet est exécutoire malgré l’appel.
Y a-t-il une date limite pour faire exécuter une décision civile ?
Oui, l’exécution forcée est soumise à des délais de prescription au-delà desquels elle devient impossible.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution fixe ce délai de prescription à 10 ans pour les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 (décisions de justice, actes étrangers, procès-verbaux de conciliation).
Pour les titres exécutoires notariés, le délai de prescription qui s’applique dépend de l’obligation concernée. Par exemple, lorsque l’acte notarié constate un prêt entre un professionnel et un particulier, on applique le délai de prescription de 2 ans du code de la consommation.
- Un acte d’exécution forcée,
- La reconnaissance par le débiteur du droit du créancier,
- Une demande en justice.
L’interruption fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il est donc crucial pour le créancier de ne pas rester inactif trop longtemps après l’obtention d’un titre exécutoire, au risque de voir son droit à l’exécution forcée s’éteindre par l’effet de la prescription.
L’exécution forcée est un domaine technique qui nécessite souvent l’intervention de professionnels du droit. En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter un avocat ou un commissaire de justice qui pourra vous guider dans ces procédures complexes mais essentielles.