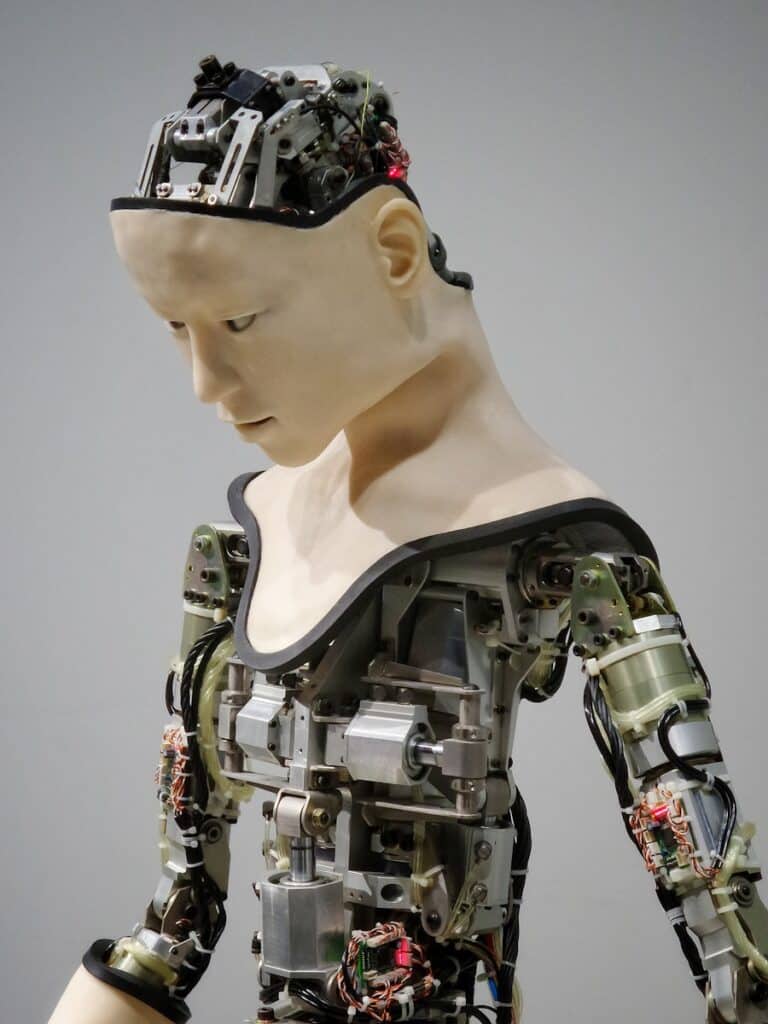Quand vous êtes confronté à un contractant qui refuse d’exécuter une obligation de faire (livraison d’un bien, réalisation de travaux, prestation de service), la procédure d’injonction de faire offre une alternative aux voies classiques. Cette procédure, moins connue que sa cousine l’injonction de payer, mérite pourtant l’attention de tout créancier d’une obligation inexécutée.
1. La phase non contradictoire : le lancement de la procédure
Dépôt de la requête
La procédure commence par le dépôt d’une requête au greffe de la juridiction compétente. Selon l’article 1425-3 du Code de procédure civile, la requête peut être « déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ». Le demandeur peut se faire représenter par un avocat, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré, ou encore par des personnes attachées à son service personnel ou à son entreprise.
Les collectivités territoriales et l’État peuvent recourir à un fonctionnaire pour les représenter, conformément à l’article 761 du Code de procédure civile.
Contenu et mentions obligatoires
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
- L’indication de la juridiction saisie
- L’objet précis de la demande
- Les coordonnées complètes du demandeur
- Les coordonnées du défendeur
L’article 1425-3 du Code de procédure civile impose également d’indiquer « précisément » la nature de l’obligation poursuivie et son fondement contractuel. Cette précision n’est pas optionnelle : le juge rejettera toute demande imprécise.
Par par exemple, pour des travaux de cuisine, mentionnez le lieu d’exécution, décrivez les meubles et référencez les appareils ménagers prévus.
Dommages et intérêts subsidiaires
Innovation du décret n°2004-836 du 20 août 2004, la requête peut désormais mentionner « les dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution de l’injonction ». Cette mention reste facultative mais stratégique. Elle renforce le caractère comminatoire de l’injonction et évite un second procès.
Documents justificatifs
La requête doit s’accompagner des documents justificatifs. Ces pièces permettent au juge d’apprécier le bien-fondé de la demande et de vérifier la valeur de la prestation. Sans constituer nécessairement un « titre » au sens juridique, ces documents doivent être probants.
En pratique, l’absence de pièces suffisantes constitue l’une des principales causes de rejet.
2. L’ordonnance du juge : un examen prima facie
Critères d’appréciation par le juge
Le juge examine la requête « au vu des documents produits ». Il vérifie que :
- L’obligation est née d’un contrat
- Les parties n’ont pas toutes qualité de commerçant
- La valeur de la prestation n’excède pas 10 000 euros
- La demande paraît fondée
Cette appréciation reste sommaire, le juge se livrant à ce que la doctrine qualifie de simple « vérification des apparences » (selon l’expression du professeur Perrot).
Prononcé de l’injonction
Si la demande paraît fondée, le juge rend une ordonnance qui fixe « l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée » (art. 1425-4 CPC).
L’ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’informe le greffe de l’exécution de l’obligation.
Cette ordonnance ne dispose ni de l’autorité de chose jugée, ni de force exécutoire. Elle s’apparente à une « citation sui generis à comparaître », selon la formule pertinente de V. Christianos.
Rejet de la requête
Le juge peut rejeter la requête s’il l’estime mal fondée ou insuffisamment documentée. Dans ce cas, les documents sont immédiatement restitués au requérant par le greffe (art. 1425-9 CPC).
L’ordonnance de rejet n’a pas à être motivée et ne dispose pas d’autorité de chose jugée. Le demandeur reste libre d’agir par les voies de droit commun.
Absence de recours contre l’ordonnance
L’article 1425-4 du Code de procédure civile précise que l’ordonnance, qu’elle prononce l’injonction ou rejette la requête, n’est « pas susceptible de recours ».
Cette particularité s’explique par la nature même de l’injonction de faire qui, dépourvue de force exécutoire, ouvre nécessairement à une phase ultérieure.
3. La phase contradictoire : le rétablissement du débat
Notification de l’ordonnance
L’article 1425-5 du Code de procédure civile confie au greffe la mission de notifier l’ordonnance aux parties « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Si l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire ou son mandataire, le demandeur doit procéder par voie de signification, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Exécution volontaire par le débiteur
L’effet psychologique de l’ordonnance ne doit pas être sous-estimé. En 1992, une étude d’InfoStat Justice révélait un taux d’exécution volontaire de 54% à la suite de la notification de l’ordonnance.
Dans ce cas, le demandeur doit en informer le greffe et l’affaire est « retirée du rôle » (art. 1425-7 CPC). Cette information est capitale car, à défaut, la procédure sera déclarée caduque si le demandeur ne se présente pas à l’audience.
Conséquences de l’inexécution
En cas d’inexécution, le demandeur doit se présenter à l’audience fixée. S’il ne comparaît pas « sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire » (art. 1425-7 CPC).
Cette caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas pu invoquer en temps utile.
Comparution à l’audience
La représentation par avocat n’est pas obligatoire à l’audience. Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter selon les conditions de l’article 762 du Code de procédure civile.
La procédure est orale et les demandes peuvent évoluer, sous réserve du respect du principe du contradictoire.
4. Le jugement et les voies de recours : l’aboutissement procédural
Tentative de conciliation
Avant toute décision, l’article 1425-8 du Code de procédure civile impose au juge de tenter « de concilier les parties ». Cette conciliation peut aboutir à un procès-verbal qui vaudra titre exécutoire sans avoir l’autorité de chose jugée.
Décision au fond
À défaut de conciliation, le juge statue sur le fond. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le juge peut ordonner l’exécution en nature de l’obligation, sauf impossibilité ou disproportion manifeste entre son coût et son intérêt (art. 1221 du Code civil).
Le jugement peut être contradictoire, réputé contradictoire ou par défaut, selon les règles classiques du Code de procédure civile.
Astreinte
Le juge peut assortir sa décision d’une astreinte provisoire. Contrairement à celle qui aurait pu accompagner l’ordonnance initiale, cette astreinte présente une efficacité réelle.
En cas d’inexécution, le créancier pourra saisir le juge de l’exécution pour la liquider, conformément à l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Voies de recours ordinaires et extraordinaires
Le jugement est soumis aux voies de recours ordinaires : opposition pour les jugements par défaut, appel pour les décisions rendues à charge d’appel.
L’appel est ouvert lorsque la demande excède 5 000 euros (art. R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire). Pour les demandes d’exécution en nature, la jurisprudence considère qu’elles constituent « par elles-mêmes » des demandes indéterminées (Civ. 2e, 6 juin 2013, n°12-20.062).
Les voies extraordinaires de recours (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) sont également ouvertes dans les conditions du droit commun.
L’injonction de faire reste sous-utilisée malgré son potentiel. Pour tirer pleinement parti de cette procédure, un accompagnement juridique devient souvent indispensable, particulièrement lors de la rédaction de la requête et de la préparation du dossier de pièces justificatives. Une expertise avisée peut faire la différence entre un rejet précoce et l’obtention d’une exécution rapide.
Sources
- Code de procédure civile, articles 1425-1 à 1425-9
- Code civil, article 1221 (issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016)
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 131-2
- Décret n°88-209 du 4 mars 1988 introduisant la procédure d’injonction de faire
- Décret n°2004-836 du 20 août 2004 modifiant l’article 1425-3 du CPC
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant les articles relatifs aux juridictions compétentes
- LAHER Rudy, Injonction de faire, Répertoire de procédure civile, Dalloz, décembre 2020
- MUNOZ PEREZ B. et alii, « L’injonction de faire : une procédure peu utilisée », Infostat Justice, février-mars 1992, n°28
- CHRISTIANOS V., « Injonction de faire et protection judiciaire du consommateur », D. 1990, Chron. 91
- Civ. 2e, 6 juin 2013, n°12-20.062, D. 2013, Actu. 1486