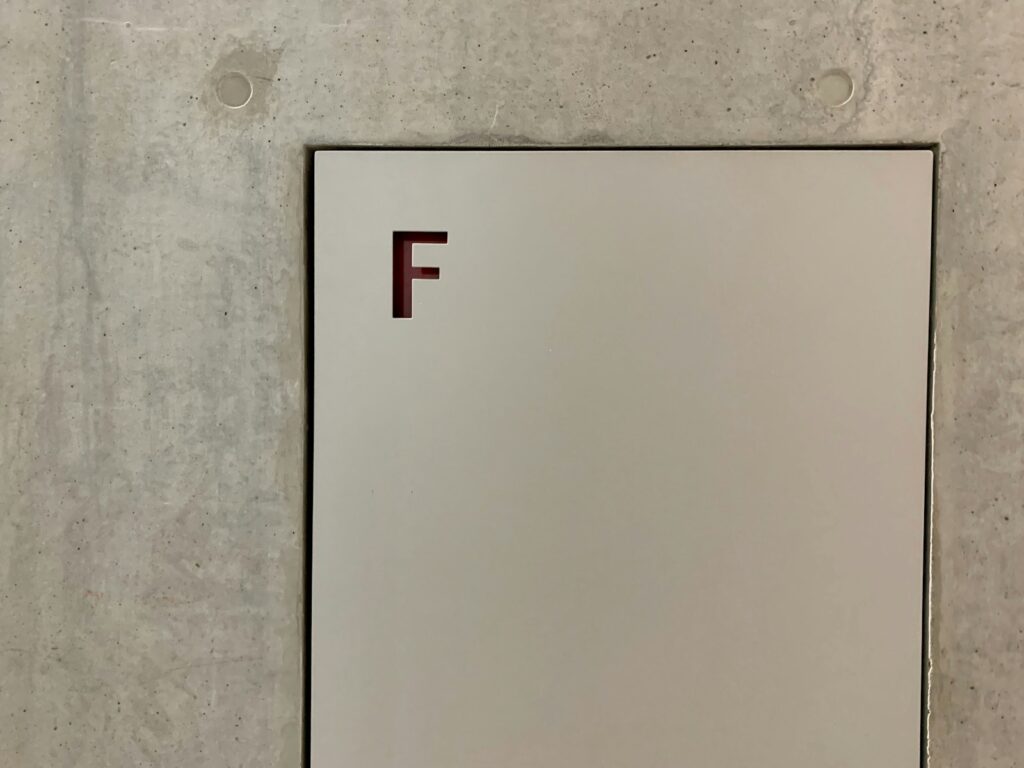Votre entreprise fait face à un conflit avec un fournisseur important ? Un associé remet en cause une décision stratégique ? Vous vous interrogez sur le tribunal compétent pour trancher ce différend ? Le tribunal de commerce est souvent la juridiction vers laquelle se tourner dans le monde des affaires, mais ses compétences sont définies de manière précise par la loi. Se tromper de tribunal peut entraîner une perte de temps et des frais inutiles.
Cette juridiction est spécifiquement dédiée aux affaires commerciales. Comprendre quand elle est compétente – ce que les juristes appellent sa compétence « matérielle » ou d’attribution – constitue la première étape essentielle pour faire valoir vos droits ou organiser votre défense efficacement. Cet article a pour but de clarifier les principaux domaines d’intervention du tribunal de commerce, en se concentrant sur les situations les plus courantes : les litiges entre professionnels, ceux qui touchent à la vie des sociétés commerciales, et son rôle irremplaçable lorsque les entreprises rencontrent des difficultés.
Le tribunal de commerce : une justice pour les affaires
Le tribunal de commerce occupe une place particulière dans le paysage judiciaire français. Sa mission principale est de juger les litiges qui naissent de l’activité économique et commerciale. Une de ses singularités tient à sa composition : les juges qui y siègent, appelés juges consulaires, ne sont pas des magistrats professionnels mais des commerçants ou dirigeants d’entreprise élus par leurs pairs. L’idée derrière cette composition est de faire juger les affaires commerciales par des personnes qui connaissent la réalité du terrain économique.
Ces tribunaux ne sont pas présents dans toutes les circonscriptions judiciaires du territoire. Dans les zones où il n’existe pas de tribunal de commerce dédié (notamment en Alsace et en Moselle, ou dans certaines zones moins denses), c’est le tribunal judiciaire (la juridiction civile de droit commun) qui remplit cette fonction. Il statue alors « commercialement », en appliquant les règles spécifiques au droit des affaires, mais selon ses propres procédures. Il est donc important de vérifier quelle juridiction est compétente localement.
Les litiges entre professionnels : le cœur de la compétence
Le domaine d’intervention principal du tribunal de commerce concerne sans conteste les relations entre professionnels. La loi, plus précisément l’article L. 721-3 du code de commerce, lui attribue compétence pour les « contestations relatives aux engagements » entre certaines catégories d’acteurs économiques.
La règle clé : les contestations relatives aux engagements entre commerçants
La situation la plus fréquente est celle d’un litige opposant deux commerçants. Mais qui est considéré comme « commerçant » aux yeux de la loi ? Il peut s’agir d’une personne physique, un entrepreneur individuel par exemple, qui exerce des actes de commerce de manière habituelle et en fait sa profession (comme le définit l’article L. 121-1 du code de commerce). Pensez au propriétaire d’un magasin, à un négociant, à un prestataire de services régulier agissant en son nom propre. Il peut aussi s’agir, et c’est le cas le plus fréquent, d’une personne morale, c’est-à-dire une société. Nous verrons plus loin quelles sociétés sont visées.
Les « engagements » concernés sont très variés. Cela couvre évidemment les contrats conclus dans le cadre de l’activité commerciale : un contrat de vente de marchandises entre deux entreprises (B2B), un contrat de prestation de services, un accord de partenariat, un prêt professionnel consenti par une banque à une entreprise… Mais la compétence du tribunal de commerce va au-delà des seuls contrats. Elle s’étend aussi aux litiges liés à la responsabilité qui peuvent naître entre commerçants dans le cadre de leur activité. Un exemple typique est l’action en concurrence déloyale : si une entreprise estime qu’un concurrent use de pratiques déloyales pour lui nuire (dénigrement, imitation prêtant à confusion, etc.), le litige sera porté devant le tribunal de commerce. De même, un désaccord sur l’exécution d’un contrat, comme une livraison non conforme ou un retard de paiement persistant, relève de cette juridiction.
Le cas des artisans : une compétence principalement pour les difficultés
Pendant longtemps, les artisans relevaient principalement des juridictions civiles pour leurs litiges généraux. Une loi de 2016 avait envisagé d’étendre la compétence générale du tribunal de commerce aux litiges les impliquant (entre artisans, ou entre artisans et commerçants), mais les textes d’application nécessaires n’ont pas été publiés pour rendre cette extension générale effective à ce jour (avril 2025). Toutefois, il est essentiel de noter que les artisans sont déjà soumis à la compétence du tribunal de commerce pour un domaine bien précis et important : les difficultés des entreprises. Comme nous le verrons plus loin, un artisan rencontrant des difficultés financières graves relève des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce, au même titre qu’un commerçant.
Et les banques ?
Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont également explicitement mentionnés par la loi. Les litiges qui les opposent entre eux, ou qui les opposent à des commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce. Cela couvre une vaste gamme de contentieux liés aux opérations bancaires et financières professionnelles.
La vie des sociétés commerciales sous le regard du tribunal de commerce
Un autre pan majeur de la compétence du tribunal de commerce concerne les sociétés commerciales. L’article L. 721-3 du code de commerce lui donne compétence pour les « contestations relatives aux sociétés commerciales ». Cette formule assez large recouvre de nombreuses situations.
Quelles sociétés sont concernées ?
La loi distingue deux catégories principales de sociétés commerciales :
- Les sociétés commerciales « par la forme » : Ce sont des sociétés qui sont considérées comme commerciales en raison de leur structure juridique même, et ce, quelle que soit leur activité réelle. L’article L. 210-1 du code de commerce liste ces formes : les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les Sociétés en Commandite Simple (SCS), les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL, EURL), et les Sociétés par Actions (SAS, SASU, SA, SCA). Ce point est très important et souvent méconnu : une société qui a choisi l’une de ces formes (par exemple, une SAS ou une SARL) sera soumise à la compétence du tribunal de commerce pour les litiges la concernant, même si son activité est purement civile ! C’est le cas, par exemple, d’une société de conseil constituée en SAS, d’une société holding gérant des participations sous forme de SAS, ou même d’une société civile immobilière (SCI) qui aurait opté pour la forme d’une SARL. Le choix de la forme juridique emporte donc des conséquences sur le tribunal compétent.
- Les sociétés commerciales « par l’objet » : Il s’agit de sociétés dont la forme juridique est civile (par exemple, une Société Civile Immobilière – SCI, une Société Civile de Moyens – SCM), mais dont l’activité réelle et habituelle est commerciale. Si une SCI, par exemple, ne se contente pas de gérer un patrimoine immobilier mais se livre de façon répétée à des opérations d’achat d’immeubles en vue de leur revente pour réaliser un profit, elle exerce une activité commerciale. Les litiges la concernant relèveront alors du tribunal de commerce en raison de son objet commercial effectif.
Quels litiges typiques ?
La compétence du tribunal de commerce couvre un large éventail de conflits liés à la vie d’une société commerciale :
- Conflits entre associés : Ils sont fréquents et peuvent porter sur l’interprétation ou la violation d’un pacte d’associés, des désaccords profonds sur la stratégie ou la gestion de l’entreprise, la répartition des bénéfices, une demande d’exclusion d’un associé (si les statuts ou un pacte le prévoient), etc.
- Conflits entre la société et un (ou plusieurs) de ses associés : Un associé peut, par exemple, agir contre la société pour obtenir communication de certains documents sociaux, contester la validité ou la régularité d’une décision prise en assemblée générale, ou demander réparation d’un préjudice que lui aurait causé la société. Inversement, la société peut agir contre un associé, par exemple pour obtenir la libération de son apport promis.
- Problèmes liés aux étapes clés de la vie sociale : Des litiges peuvent survenir dès la constitution de la société (ex: problème d’évaluation d’un apport en nature). Pendant son fonctionnement, des contestations peuvent naître autour de la nomination, de la révocation ou de la rémunération des dirigeants. Enfin, lors de la fin de la société, des différends peuvent éclater concernant la dissolution ou les opérations de liquidation et de partage entre associés.
- Responsabilité des dirigeants : Un dirigeant (gérant de SARL, président de SAS, administrateur de SA…) peut voir sa responsabilité engagée devant le tribunal de commerce s’il commet une faute de gestion préjudiciable à la société elle-même, aux associés (ex: décision prise dans son intérêt personnel au détriment de la société), voire dans certains cas à des tiers (ex: manœuvres frauduleuses ayant causé un préjudice à un créancier).
Un rôle central dans les difficultés des entreprises
Le tribunal de commerce n’intervient pas seulement pour trancher les conflits. Il joue aussi un rôle essentiel, et souvent préventif, lorsque les entreprises traversent des difficultés économiques ou financières.
Anticiper les problèmes : les procédures de prévention
Avant même qu’une entreprise ne soit en cessation des paiements, des mécanismes existent pour tenter de redresser la barre. Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures confidentielles, initiées à la demande du dirigeant, et menées sous l’égide du Président du tribunal de commerce. Un mandataire ou un conciliateur est désigné pour aider l’entreprise à négocier avec ses principaux créanciers (banques, fournisseurs, organismes sociaux et fiscaux) afin de trouver des solutions amiables (rééchelonnement de dettes, nouveaux financements…).
Gérer la crise : les procédures collectives
Lorsque les difficultés sont plus graves et que l’entreprise ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible (état de cessation des paiements), ou risque d’y parvenir très prochainement, les procédures collectives s’ouvrent. La sauvegarde (si l’entreprise n’est pas encore en cessation des paiements mais rencontre des difficultés insurmontables), le redressement judiciaire (si elle est en cessation des paiements mais qu’un redressement est possible) et la liquidation judiciaire (si le redressement est manifestement impossible) sont de la compétence quasi-exclusive du tribunal de commerce pour les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale. C’est donc bien devant cette juridiction qu’un artisan en difficulté devra se tourner. Pour les entreprises d’une taille significative (en termes de chiffre d’affaires et/ou de nombre de salariés) ou appartenant à des groupes importants, des tribunaux de commerce spécialisés, moins nombreux mais avec une compétence géographique élargie, ont été désignés pour traiter ces dossiers complexes.
Naviguer dans les méandres de la compétence judiciaire peut être complexe. Si votre entreprise fait face à un litige ou traverse une période difficile, une analyse juridique précise est indispensable. Notre cabinet est à votre écoute pour vous conseiller sur la juridiction compétente et la meilleure stratégie à adopter. Contactez-nous.
Sources
- Code de commerce, notamment les articles L. 121-1, L. 210-1, L. 721-3, et le Livre VI (Difficultés des entreprises).
- Code de procédure civile.
- Code de l’organisation judiciaire.