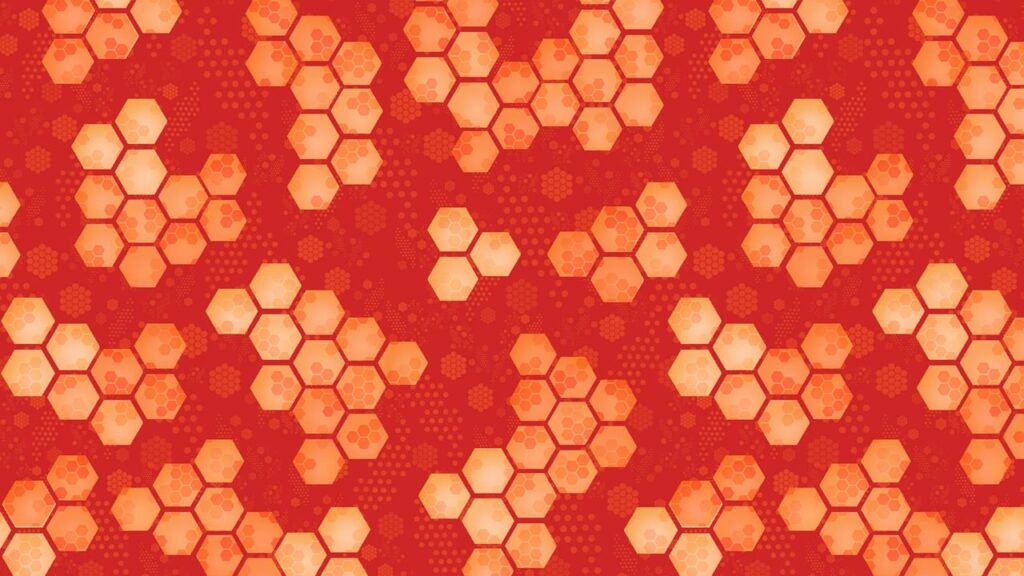Lorsqu’un créancier détient une créance qui semble légitime mais n’est pas encore reconnue par un titre exécutoire, il se trouve dans une situation précaire. Si son débiteur rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure collective, le risque est grand de voir ses chances de recouvrement s’évanouir. Face à ce péril, la saisie conservatoire apparaît comme une mesure de protection indispensable. Elle permet de « geler » ou bloquer des biens du débiteur en attendant une décision de justice. Cependant, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire déclenche une course contre la montre. Le créancier doit agir avec une célérité et une rigueur procédurale absolues pour transformer sa garantie provisoire en un droit de paiement effectif. Toute hésitation ou erreur peut anéantir les efforts déployés.
Cet article détaille l’interaction critique entre les mesures conservatoires et les procédures collectives. Il explore les mécanismes qui permettent de protéger une créance, les effets dévastateurs d’un jugement d’ouverture sur une saisie en cours, et les stratégies à adopter pour sécuriser ses droits. Nous aborderons également les impacts de réformes récentes, comme celle du statut de l’entrepreneur individuel, qui redéfinissent le périmètre des biens saisissables. Pour un conseil adapté à votre situation, notre cabinet se tient à votre disposition.
Comprendre la saisie conservatoire : une garantie essentielle pour le créancier
La saisie conservatoire est une mesure de sûreté judiciaire qui permet à un créancier de rendre indisponibles les biens mobiliers, corporels ou incorporels, de son débiteur. Son objectif n’est pas le paiement immédiat, mais la garantie du paiement futur. Elle assure que le débiteur ne pourra pas organiser son insolvabilité en dissipant son patrimoine pendant que le créancier accomplit les démarches pour obtenir un jugement de condamnation. La mise en œuvre de cette procédure est une pratique courante en matière de recouvrement.
Pour la mettre en œuvre, le créancier doit obtenir l’autorisation du juge de l’exécution, sauf s’il dispose déjà d’un titre exécutoire même non définitif (comme une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire) ou d’un document spécifique tel qu’une lettre de change acceptée. Le juge n’accordera cette autorisation que si deux conditions cumulatives sont réunies, comme le prévoit l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPC) : une créance qui paraît fondée en son principe et dans son montant, et l’existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement. Le créancier n’a pas à prouver sa créance de manière irréfutable à ce stade, mais seulement à démontrer sa vraisemblance. La menace, quant à elle, peut résulter de la situation financière précaire du débiteur ou de son comportement (dissimulation d’actifs, par exemple).
L’impact du jugement d’ouverture d’une procédure collective sur les saisies en cours
Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire produit un effet radical : il paralyse les prérogatives des créanciers antérieurs. Cette règle, dictée par la nécessité de traiter collectivement le passif de l’entreprise et de préserver ses chances de survie, a des conséquences directes et souvent dramatiques sur les mesures conservatoires déjà engagées.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles (art. L. 622-21 C. com.)
L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement. Ce principe d’ordre public met un terme immédiat à toutes les voies d’exécution individuelles, qu’elles visent les meubles ou les immeubles du débiteur. Un créancier ne peut plus, dès le prononcé du jugement, engager une nouvelle saisie pour obtenir le paiement de sa créance. Celles qui ont été initiées avant le jugement sont paralysées, leur sort dépendant de leur état d’avancement à cette date précise.
Le sort de la saisie non convertie avant le jugement : caducité et mainlevée
Le point de bascule est la conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution définitive. Si une saisie conservatoire pratiquée avant le jugement d’ouverture n’a pas encore été convertie en saisie-attribution par l’obtention d’un titre exécutoire définitif, elle devient caduque. La jurisprudence est constante sur ce point : la survenance de la procédure collective met fin à la saisie conservatoire et à son effet d’affectation spéciale. Les fonds qui avaient été rendus indisponibles retombent dans le patrimoine du débiteur et, par conséquent, dans le gage commun de tous les créanciers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que des sommes isolées sur un compte spécial par une banque à la suite d’une saisie conservatoire sont réputées figurer sur le compte global du débiteur au jour du jugement de liquidation si la conversion n’a pas eu lieu (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-16.178). Le saisissant perd alors le privilège de sa garantie et redevient un simple créancier chirographaire, contraint de déclarer sa créance au passif et d’attendre une éventuelle répartition au marc le franc, après paiement des frais de procédure.
De la saisie conservatoire à la saisie-attribution : une conversion procédurale décisive
Pour échapper à la caducité, le créancier doit impérativement convertir sa mesure conservatoire en une véritable mesure d’exécution : la saisie-attribution. Cette procédure, qui transfère la propriété de la créance saisie au créancier saisissant, doit être achevée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Pour une analyse complète des mécanismes d’exécution forcée tels que la saisie-attribution, notre guide dédié offre des informations détaillées. Sa validité repose sur un formalisme strict dont chaque étape est sanctionnée par la nullité ou la caducité.
L’acte de saisie-attribution et ses mentions obligatoires à peine de nullité
La conversion s’opère par la signification d’un acte de saisie-attribution au tiers (par exemple, la banque du débiteur). Cet acte, rédigé par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), doit contenir, sous peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires listées à l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Parmi celles-ci figurent l’énonciation du titre revêtu de la force exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêt et frais. L’omission ou l’inexactitude de ces mentions peut être invoquée par le débiteur pour demander l’annulation de toute la procédure.
La dénonciation au débiteur : un délai de 8 jours à peine de caducité
Une fois l’acte signifié au tiers saisi, le créancier dispose d’un délai de huit jours pour dénoncer la saisie au débiteur lui-même. Cette dénonciation, effectuée par acte de commissaire de justice, l’informe de la mesure et fait courir le délai d’un mois dont il dispose pour la contester. Le respect de ce délai de huit jours est une condition de validité fondamentale. L’article R. 211-3 du CPC est sans ambiguïté : le manquement est sanctionné par la caducité de la saisie. Un acte de dénonciation signifié le neuvième jour anéantit rétroactivement l’ensemble des effets de la procédure, y compris l’attribution immédiate de la créance au profit du saisissant.
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (EI) : quel impact sur le patrimoine saisissable ?
La loi du 14 février 2022 a profondément réformé le statut de l’entrepreneur individuel en instaurant une séparation de plein droit entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Cette mesure, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a des conséquences directes sur le périmètre des biens saisissables et redéfinit la stratégie de recouvrement des créanciers.
Désormais, l’entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines distincts sans qu’une déclaration soit nécessaire. Le droit de gage des créanciers est cantonné par nature : les créanciers dont la créance est née de l’activité professionnelle (une facture impayée, un loyer commercial non réglé) ne peuvent en principe poursuivre le recouvrement que sur le patrimoine professionnel. En revanche, les créanciers personnels (dettes non liées à l’activité) ne peuvent saisir que les biens du patrimoine personnel. Cette dualité de patrimoines impose au poursuivant, avant toute mesure conservatoire, d’identifier la nature de sa créance pour cibler le bon patrimoine. Cette distinction est au cœur de tout litige potentiel. La loi prévoit des exceptions, notamment la possibilité pour l’entrepreneur de renoncer à cette protection pour un engagement spécifique (un prêt bancaire, par exemple) ou pour les créanciers personnels en cas d’insuffisance du patrimoine personnel, qui peuvent alors saisir le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos.
Saisie des rémunérations : anticiper la réforme de 2025 et la déjudiciarisation
La procédure de saisie des rémunérations, qui permet de prélever une partie du salaire d’un débiteur directement auprès de son employeur, va connaître une transformation majeure à compter du 1er juillet 2025. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a prévu sa déjudiciarisation, transférant la compétence du juge vers l’officier ministériel. Il est essentiel pour les créanciers et les employeurs de comprendre les dernières évolutions de la saisie des rémunérations.
Cette réforme supprime la phase de conciliation préalable devant le juge. La procédure sera entièrement gérée par les commissaires de justice, de la délivrance du commandement de payer jusqu’à la répartition des fonds. Toute saisie devra être inscrite sur un registre numérique national, une innovation destinée à centraliser les informations, à assurer la traçabilité des procédures et à coordonner la répartition entre les créanciers en cas de pluralité de saisies sur un même débiteur.
Le rôle central du commissaire de justice et du registre numérique
Un commissaire de justice dit « répartiteur » sera désigné pour chaque procédure. Il sera l’interlocuteur unique de l’employeur (le tiers saisi), chargé de recevoir les fonds prélevés et de les verser aux créanciers. Le registre numérique jouera un rôle clé en prévenant les saisies concurrentes et en garantissant une répartition équitable. Pour les employeurs, cette centralisation devrait simplifier la gestion des saisies. Pour les créanciers, elle promet une procédure plus rapide et dématérialisée, mais qui exigera une parfaite maîtrise des nouvelles modalités procédurales pour rester efficace.
Les immunités d’exécution : quand la saisie devient impossible
L’immunité d’exécution est un principe qui fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée contre certaines entités, en raison de leur statut particulier. C’est un obstacle absolu qui paralyse la prérogative du créancier, même s’il est muni d’un titre exécutoire définitif. Il est important de connaître les conditions d’application de l’immunité d’exécution pour ne pas engager de vaines poursuites.
L’immunité des personnes publiques françaises et l’insaisissabilité de leurs biens
En droit français, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficient d’une immunité fondée sur le principe de la continuité du service public. Leurs biens sont insaisissables. Un poursuivant ne peut donc pas faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires d’une commune, par exemple. Il doit utiliser des voies d’exécution spécifiques du droit administratif, comme la procédure de mandatement d’office, pour obtenir le paiement.
L’immunité des États étrangers : le cadre strict de la renonciation (Loi Sapin 2)
L’immunité des États étrangers est un principe de droit international coutumier. Cependant, la loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 a encadré de manière très stricte les conditions de son contournement. Toute mesure d’exécution contre un État étranger nécessite une autorisation préalable du juge. De plus, pour les biens utilisés dans l’exercice de la mission diplomatique (comptes de l’ambassade, par exemple), l’article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d’exécution exige une renonciation de l’État qui doit être à la fois « expresse et spéciale ». Une renonciation générale à l’immunité dans un contrat ne suffit plus. La jurisprudence récente interprète cette condition très rigoureusement, distinguant par exemple les fonctions de la mission diplomatique de l’activité diplomatique d’un chef d’État (Civ. 1re, 13 mars 2024), ce qui rend la saisie de ces actifs particulièrement difficile.
Stratégies et réflexes pour le créancier face à un débiteur en difficulté
Face à un débiteur dont la solvabilité se dégrade, l’anticipation est la clé de la protection des droits du poursuivant. Voici une liste de réflexes essentiels :
- Agir sans attendre : Dès les premiers impayés, il faut engager les démarches pour recueillir un titre exécutoire. Chaque jour compte avant l’éventuelle ouverture d’une procédure collective.
- Prendre une mesure conservatoire : Dès que la créance paraît fondée et que son recouvrement est menacé, la saisie conservatoire est le premier bouclier. Elle prend date et rend les biens indisponibles.
- Convertir la saisie au plus vite : L’obtention du titre exécutoire doit être immédiatement suivie de l’acte de conversion en saisie-attribution. La procédure doit être menée avec une rigueur absolue, en particulier le respect du délai de dénonciation de huit jours, sous peine de caducité ou de mainlevée de la saisie.
- En cas de procédure collective ouverte : Si la conversion n’a pas pu être finalisée à temps, il est impératif de faire une demande de déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur dans les délais légaux (généralement deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC). Omettre cette déclaration éteint la créance, même si elle fait l’objet d’un litige en cours.
- Surveiller la période suspecte : Il faut être vigilant aux actes passés par le débiteur entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. Certains actes, comme des paiements anormaux ou des donations, pourraient être annulés par le tribunal de commerce, reconstituant ainsi l’actif du débiteur au profit de la collectivité des créanciers.
La confrontation entre une mesure conservatoire et une procédure collective est une véritable épreuve de vitesse et de technique juridique. La saisie conservatoire est un outil puissant, mais sa survie dépend de la capacité du créancier à finaliser sa conversion avant que le couperet de l’arrêt des poursuites individuelles ne tombe. Dans ce contexte, la maîtrise des subtilités procédurales et l’anticipation des difficultés du débiteur sont les meilleures garanties pour le recouvrement. Pour une analyse de votre situation et trouver la meilleure solution, l’accompagnement par un avocat est recommandé. N’hésitez pas à demander un accompagnement juridique sur mesure.
Sources
- Code de commerce : Articles L. 622-21 (Arrêt des poursuites individuelles)
- Code des procédures civiles d’exécution : Articles L. 511-1 (Conditions de la saisie conservatoire), R. 211-1 (Mentions de l’acte de saisie-attribution), R. 211-3 (Dénonciation de la saisie), L. 111-1-3 (Immunité d’exécution des États étrangers)
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Loi Sapin 2)
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (Déjudiciarisation de la saisie des rémunérations)