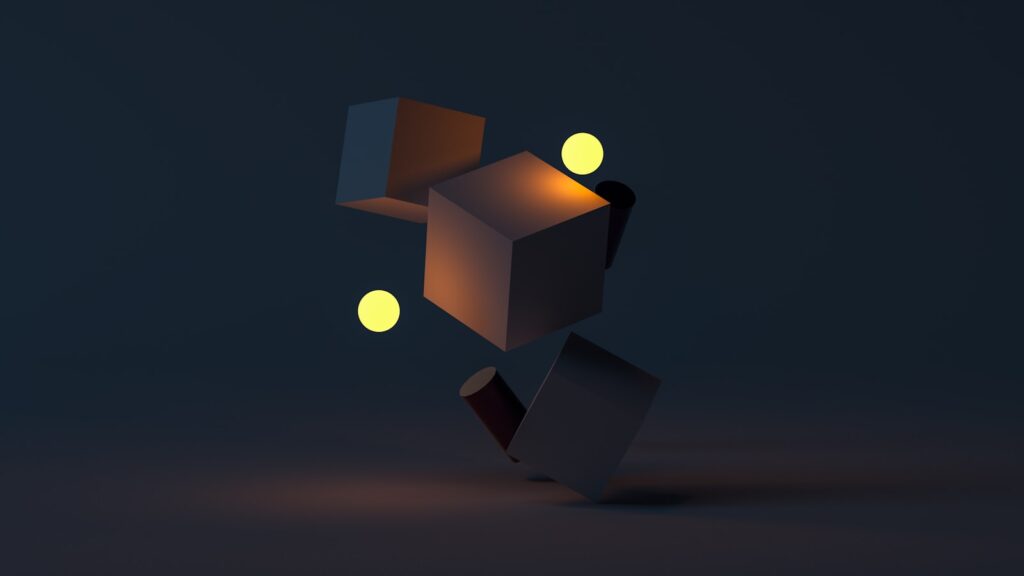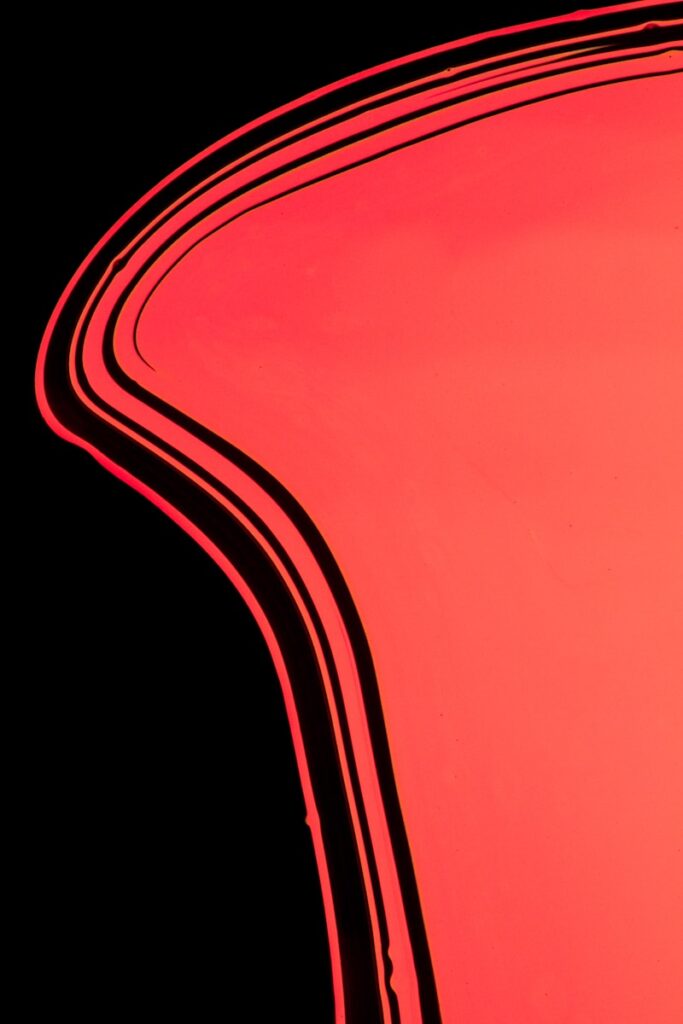Dans le labyrinthe des sanctions procédurales, trois notions se distinguent par leur complexité et leurs implications : la nullité, l’inexistence et l’irrecevabilité. Ces sanctions opèrent comme de véritables épées de Damoclès au-dessus des actes de procédure. Leur maîtrise est indispensable pour tout praticien.
L’inexistence en procédure civile : une théorie en déclin
Notion d’inexistence et sa distinction avec la nullité
L’inexistence constitue non pas une sanction mais un état de l’acte qui n’a pas réuni les éléments essentiels pour accéder à la qualification d’acte juridique. À la différence de la nullité qui frappe un acte juridique irrégulier, l’inexistence concerne un acte si défectueux qu’il n’a jamais eu d’existence juridique.
Cette distinction théorique s’avère cruciale : la nullité suppose un acte existant mais vicié, tandis que l’inexistence reflète l’absence même d’acte. L’inexistence échappe donc au régime des nullités, ce qui la rendait particulièrement attractive pour contourner les conditions restrictives des nullités pour vice de forme.
Comme le précise l’article 114 du Code de procédure civile : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Applications antérieures à l’arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2006
Avant 2006, la jurisprudence recourait fréquemment à la théorie de l’inexistence. Elle refusait d’appliquer le régime des nullités à des actes de procédure gravement déficients. Étaient ainsi qualifiés d’inexistants :
- La déclaration d’appel effectuée par téléphone (Soc. 8 juillet 1992, n° 89-40.559)
- Les conclusions non signées par l’avocat (Civ. 2e, 13 janvier 2000, n° 98-12.204)
- Une assignation indiquant une date d’audience correspondant à un jour férié (Com. 4 janvier 2005, n° 03-16.486)
Ces actes étaient considérés comme de simples ébauches, de pures apparences dépourvues d’existence juridique.
Quasi-disparition et résurgences sporadiques depuis 2006
L’arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2006 (n° 03-20.026) a marqué un coup d’arrêt spectaculaire à cette construction prétorienne. Par cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé que :
« Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile. »
Cette décision a relégué la théorie de l’inexistence aux oubliettes… presque. Car quelques résurgences sporadiques peuvent être observées. Par exemple, dans un arrêt du 24 septembre 2015 (n° 13-28.017), la Cour de cassation reconnaît qu’il y a bien « absence de conclusions remises au greffe » (et non nullité) lorsque celles-ci ont été transmises par RPVA alors que ce mode de transmission n’était pas encore autorisé.
De même, un arrêt du 2 juillet 2020 (n° 19-12.752) énonce que « la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification », ce qui évoque la théorie de l’inexistence.
Les irrecevabilités sanctionnant des irrégularités procédurales
Irrecevabilités expressément prévues par la loi
L’irrecevabilité constitue une sanction autonome qui frappe directement la demande et non l’acte. Certaines sont explicitement prévues par le législateur.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Parmi les irrecevabilités légales, on trouve notamment :
- Le défaut de motivation de l’appel du jugement sur la compétence (article 85 CPC)
- L’absence de mentions obligatoires dans les conclusions en défense (article 59 CPC)
- Le défaut de notification d’un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux (article R.145-27 du Code de commerce)
Irrecevabilités d’origine prétorienne
Les tribunaux ont étendu le domaine des irrecevabilités à des hypothèses non prévues par les textes. Ces « fins de non-recevoir artificielles » permettent d’échapper au régime des nullités.
La jurisprudence qualifie ainsi d’irrecevable :
- L’acte accompli par une personne décédée (Civ. 1re, 28 octobre 2009, n° 08-18.053)
- L’acte dirigé contre une société inexistante (Com. 7 juillet 2009, n° 08-19.827)
- L’appel formé auprès du greffe de la juridiction ayant rendu le jugement et non auprès de celui de la cour d’appel (Civ. 2e, 17 décembre 2009, n° 07-44.302)
Comme le résume un arrêt souvent cité (Civ. 2e, 6 janvier 2011, n° 09-72.506) : « le défaut de saisine régulière du tribunal ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief ».
Enjeux de la qualification en matière de prescription
La qualification retenue emporte des conséquences déterminantes, notamment en matière de prescription. Depuis la loi du 17 juin 2008, les articles 2241 et 2243 du Code civil établissent un traitement différencié :
- L’acte annulé pour vice de forme ou de fond conserve son effet interruptif de prescription (article 2241, alinéa 2)
- L’acte déclaré irrecevable perd son effet interruptif (article 2243)
Cette distinction a des implications pratiques majeures. Un plaideur confronté à une procédure entachée d’irrégularité verra sa situation radicalement différente selon la qualification retenue.
Traitement spécifique de certaines irrégularités procédurales
Défaut de saisine régulière des juridictions
Le défaut de saisine régulière illustre parfaitement les frontières floues entre ces sanctions. La jurisprudence a opéré des distinctions subtiles :
- L’utilisation d’un support formel différent de celui requis par la loi (lettre simple au lieu d’une LRAR, assignation au lieu d’une citation par le greffe) est sanctionnée par l’irrecevabilité
- La remise au greffe de conclusions d’appel par RPVA alors que ce mode de transmission n’était pas autorisé est traitée comme une inexistence de l’acte
- L’indication erronée d’une date d’audience dans une assignation est désormais un vice de forme
Ces distinctions confirment l’analyse de Loïc Cadiet qui évoque un véritable « clavier de sanctions procédurales » dont l’articulation est parfois discutable.
Atteintes au contradictoire
Les atteintes au principe du contradictoire reçoivent un traitement différencié selon leur gravité et leur contexte :
- L’absence de communication à une partie d’informations complémentaires adressées à l’expert est qualifiée de vice de forme (Civ. 1re, 30 avril 2014, n° 13-13.579)
- L’absence de remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance sur requête est traitée comme un vice de fond (Civ. 2e, 1er septembre 2016, n° 15-23.326)
- Le défaut de convocation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire entraîne une irrecevabilité (Com. 12 janvier 2016, n° 13-24.211)
Défaut de personnalité juridique
L’acte accompli par une personne inexistante (décédée, société dissoute) ou dirigé contre une telle personne pose des difficultés particulières. La jurisprudence oscille entre plusieurs qualifications :
- Vice de fond irréparable : l’acte accompli par une personne décédée (Civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-19.249)
- Fin de non-recevoir : l’action engagée par une personne décédée (Civ. 1re, 28 octobre 2009, n° 08-18.053)
- Inexistence : l’assignation adressée à un État étranger mais notifiée à un consulat sans personnalité juridique (Toulouse, 9 mai 2006)
Cette oscillation jurisprudentielle témoigne de la difficulté à maintenir des catégories étanches entre ces sanctions procédurales.
Finalement, les frontières entre nullité, inexistence et irrecevabilité demeurent poreuses malgré les efforts jurisprudentiels pour les clarifier. L’application concrète de ces sanctions dépend souvent de considérations pratiques plus que théoriques. Seul un professionnel aguerri peut naviguer entre ces écueils procéduraux qui menacent continuellement la validité des actes de procédure.
N’hésitez pas à nous consulter pour évaluer la régularité de vos actes de procédure. Notre cabinet vous accompagne dans la prévention et le traitement des incidents procéduraux avant qu’ils ne deviennent fatals à vos prétentions.
Sources
- Code de procédure civile, articles 112 à 121 (régime des nullités)
- Code civil, articles 2241 à 2243 (interruption de la prescription)
- Cass., ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026
- Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 13-28.017
- Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-12.752
- Civ. 2e, 6 janvier 2011, n° 09-72.506
- Civ. 1re, 30 avril 2014, n° 13-13.579
- Civ. 2e, 1er septembre 2016, n° 15-23.326
- Civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-19.249