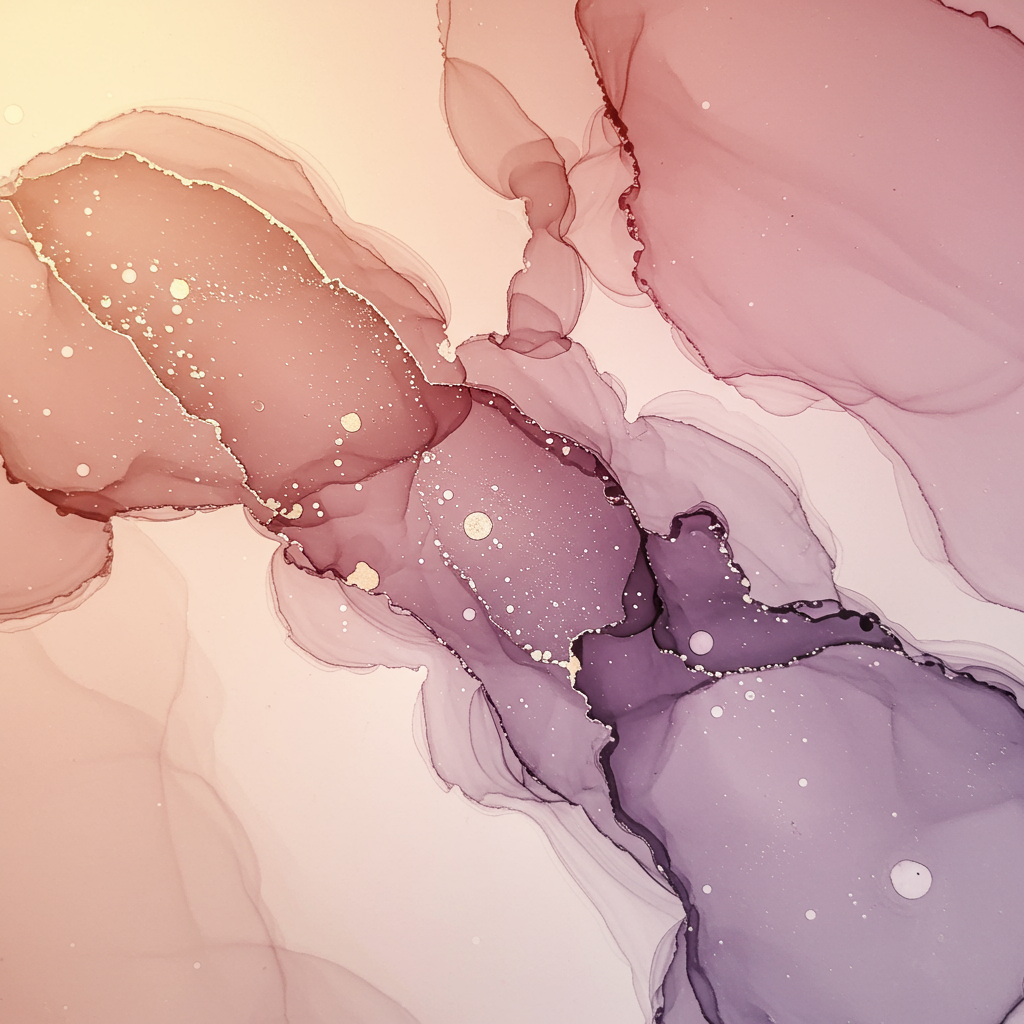Vous avez une créance qui semble fondée et son recouvrement est menacé, comme nous l’avons vu dans notre premier article. La question pratique se pose alors : comment initier concrètement une mesure conservatoire ? Faut-il systématiquement obtenir le feu vert d’un juge avant d’agir pour protéger vos intérêts ?
La réponse est nuancée. La règle générale est en effet l’autorisation judiciaire préalable. C’est une protection importante pour le débiteur. Cependant, pour des raisons d’efficacité et lorsque la créance présente des garanties particulières de sérieux, la loi a prévu des raccourcis permettant au créancier d’agir plus rapidement, sans passer par la case « juge » initialement. Comprendre cette distinction est important pour agir efficacement. Cet article détaille la procédure d’autorisation et les cas où vous pouvez vous en dispenser.
Le principe : l’autorisation du juge est nécessaire
Dans la majorité des cas, avant de pouvoir pratiquer une saisie conservatoire ou faire inscrire une sûreté judiciaire, vous devez obtenir l’autorisation d’un juge. Pourquoi ? Parce qu’une mesure conservatoire, même provisoire, porte atteinte aux biens et aux droits du débiteur. Ce contrôle judiciaire initial vise à vérifier que les conditions légales sont bien remplies – notamment l’apparence de fondement de votre créance et l’existence d’une menace réelle sur son recouvrement (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution – CPCE) – et à prévenir les actions abusives.
Quel juge saisir ?
En principe, le juge compétent est le Juge de l’Exécution (JEX). Il s’agit d’un magistrat du Tribunal Judiciaire spécialisé dans les questions d’exécution des décisions de justice et des mesures conservatoires (article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire – COJ). Territorialement, il faut saisir le JEX du lieu où demeure le débiteur (article R. 511-2 du CPCE). Cette règle de compétence est d’ordre public, ce qui signifie qu’on ne peut y déroger par contrat (article R. 511-3 du CPCE).
Il existe toutefois une exception importante : si votre créance est de nature commerciale et que vous agissez avant d’avoir engagé un procès sur le fond, vous pouvez également saisir le Président du Tribunal de Commerce du lieu où demeure le débiteur (article L. 511-3 du CPCE). Attention, cette compétence est concurrente (vous pouvez toujours choisir le JEX) et disparaît dès qu’un procès est engagé (même en référé) ; seul le JEX redevient alors compétent.
Comment saisir le juge ? La requête
La demande d’autorisation prend la forme d’une requête (article R. 511-1 du CPCE). C’est un écrit adressé au juge compétent, qui expose les faits, le fondement de votre créance (en joignant les pièces justificatives), les raisons pour lesquelles son recouvrement est menacé (preuves à l’appui), les biens que vous souhaitez saisir ou sur lesquels vous voulez inscrire une sûreté, et le montant de la créance (ou son évaluation provisoire).
Point essentiel : cette procédure se déroule sans que le débiteur en soit informé initialement (procédure dite « non contradictoire », régie par les articles 493 et suivants du Code de procédure civile). L’objectif est de préserver l’effet de surprise de la mesure conservatoire. Si le débiteur était averti, il pourrait accélérer la dissimulation de ses biens.
Devant le JEX ou le Président du Tribunal de Commerce, la représentation par avocat est souvent obligatoire, notamment si l’enjeu dépasse 10 000 euros (articles L. 121-4 et R. 121-6 du CPCE).
La décision du juge : l’ordonnance
Le juge examine votre requête et les pièces fournies. Il rend ensuite une décision appelée ordonnance sur requête.
- S’il estime les conditions remplies, il autorise la mesure conservatoire. Son ordonnance doit obligatoirement préciser les biens concernés et le montant maximum pour lequel la mesure est autorisée (article R. 511-4 du CPCE). Le non-respect de ces mentions peut entraîner la nullité de l’ordonnance. Le juge n’est pas lié par votre demande et peut autoriser une mesure pour un montant inférieur ou sur des biens plus limités.
- S’il estime les conditions insuffisantes, il refuse l’autorisation.
Dans tous les cas, l’ordonnance doit être motivée, c’est-à-dire expliquer les raisons de la décision (article 495 du Code de procédure civile).
Le délai pour agir après l’autorisation
Une fois l’ordonnance d’autorisation obtenue, attention : vous disposez d’un délai de trois mois pour mettre en œuvre la mesure conservatoire (faire pratiquer la saisie par l’huissier, déposer les bordereaux d’inscription pour une sûreté…). Passé ce délai, l’ordonnance devient caduque, elle perd toute validité (article R. 511-6 du CPCE).
Les exceptions : quand peut-on agir sans autorisation du juge ?
La procédure d’autorisation, bien que protectrice, prend nécessairement un peu de temps. Pour permettre une réaction plus immédiate dans des situations où la créance présente déjà un fort degré d’évidence, l’article L. 511-2 du CPCE prévoit quatre cas précis où le créancier est dispensé de solliciter l’autorisation préalable du juge.
Dans ces hypothèses, vous pouvez mandater directement un huissier pour pratiquer la saisie ou faire inscrire la sûreté provisoire. Mais attention : cela ne vous dispense pas de devoir justifier, a posteriori si le débiteur conteste, que les conditions de fond (créance fondée et menace sur le recouvrement) étaient bien réunies au moment où vous avez agi. La jurisprudence est constante sur ce point : la dispense ne concerne que l’autorisation préalable, pas les conditions de fond elles-mêmes. Agir sans autorisation, c’est agir plus vite, mais à vos risques et périls.
Voici les quatre cas de dispense :
1. Vous avez un titre exécutoire
Si vous disposez déjà d’un titre exécutoire, vous n’avez pas besoin d’autorisation pour une mesure conservatoire. Logique : un titre exécutoire vous permet déjà, en théorie, de procéder à une exécution forcée (saisie-vente, saisie-attribution…). Il est donc normal qu’il vous permette aussi de prendre une simple mesure de protection. Qu’est-ce qu’un titre exécutoire ? L’article L. 111-3 du CPCE en donne la liste. Les plus courants sont :
- Une décision de justice (jugement, arrêt) passée en force de chose jugée (non susceptible d’appel suspensif) ou bénéficiant de l’exécution provisoire.
- Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire (par exemple, un acte de prêt notarié).
- Un titre délivré par l’huissier en cas de non-paiement d’un chèque.
- Certains actes administratifs exécutoires.
2. Vous avez une décision de justice non (encore) exécutoire
Cette situation est proche de la précédente. Vous avez obtenu un jugement ou un arrêt qui reconnaît votre créance, mais il n’est pas encore exécutoire (par exemple, parce que le délai d’appel court toujours, ou parce qu’un appel a été interjeté mais sans exécution provisoire). Une sentence arbitrale, même non encore revêtue de l’exequatur (la formule la rendant exécutoire en France), est également considérée comme une décision de justice pour cette dispense, selon la jurisprudence. L’idée est qu’un juge ou un arbitre a déjà estimé votre créance fondée, justifiant une protection rapide.
3. Vous avez une lettre de change acceptée, un billet à ordre ou un chèque impayé
Ces instruments sont des engagements de paiement formels.
- Une lettre de change acceptée signifie que le débiteur (le tiré) a formellement reconnu devoir la somme.
- Un billet à ordre est une promesse écrite de payer une somme à une date donnée.
- Un chèque est un ordre de paiement immédiat.
Le fait que le paiement n’ait pas eu lieu à l’échéance (pour la lettre de change ou le billet à ordre) ou lors de la présentation (pour le chèque) constitue un indice fort de difficultés financières ou de mauvaise volonté du débiteur, justifiant une action conservatoire sans autorisation préalable.
4. Votre locataire ne paie pas son loyer (bail écrit)
C’est l’exception la plus spécifique, et parfois critiquée. Si vous êtes bailleur d’un immeuble (logement, local commercial…) et que votre locataire ne paie pas son loyer, vous pouvez pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation, à la condition impérative que le loyer impayé résulte d’un contrat de bail écrit.
La jurisprudence interprète cette exception de manière stricte : elle ne couvre en principe que le loyer stricto sensu et parfois les charges locatives si le bail le prévoit clairement, mais généralement pas les indemnités d’occupation, les frais de relance ou les clauses pénales. Surtout, cette dispense ne s’applique pas pour agir contre la personne qui s’est portée caution pour le locataire ; pour la caution, l’autorisation du juge reste nécessaire.
Agir sans autorisation : quels risques ?
Bénéficier d’une dispense d’autorisation permet d’agir très vite. C’est un avantage considérable lorsque le temps presse. Cependant, ce n’est pas un blanc-seing. Le créancier qui agit sans autorisation préalable le fait sous sa propre responsabilité.
Le débiteur conserve intact son droit de contester la mesure a posteriori (article L. 512-1 du CPCE). Il peut saisir le JEX (ou le Président du Tribunal de Commerce si applicable) après que la mesure a été pratiquée, pour en demander la mainlevée (l’annulation).
Sur quoi peut porter la contestation ?
- Sur le fait que les conditions de fond n’étaient pas réunies au moment de la mesure (absence de créance paraissant fondée, ou surtout, absence de circonstances menaçant le recouvrement).
- Sur le fait que le cas de dispense invoqué par le créancier n’était pas applicable (par exemple, le titre n’était pas réellement exécutoire, le bail n’était pas écrit, la somme réclamée n’était pas du loyer…).
Si le juge donne raison au débiteur et ordonne la mainlevée, les conséquences pour le créancier peuvent être importantes :
- La mesure conservatoire est anéantie.
- Plus grave, le créancier peut être condamné à verser des dommages-intérêts au débiteur pour réparer le préjudice causé par la mesure injustifiée (article L. 512-2 du CPCE). Il est important de noter que la jurisprudence considère que le débiteur n’a même pas besoin de prouver une faute du créancier pour obtenir cette indemnisation ; il lui suffit de montrer que la mesure était infondée et qu’elle lui a causé un tort (préjudice d’image, blocage de fonds inutile…).
Agir sans autorisation est donc une option à double tranchant : elle offre rapidité et surprise, mais expose le créancier à une responsabilité accrue si son action s’avère infondée.
La décision d’engager une mesure conservatoire, et de choisir la voie de l’autorisation judiciaire ou celle de la dispense lorsque c’est possible, doit être mûrement réfléchie en fonction des spécificités de chaque dossier. Pour une analyse personnalisée de votre cas et vous assurer que vous agissez dans le respect des règles applicables, que vous soyez créancier ou débiteur visé par une telle mesure, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution (CPCE)
- Code de l’organisation judiciaire (COJ)
- Code de procédure civile (C.pr.civ.)
- Code civil
- Code de commerce