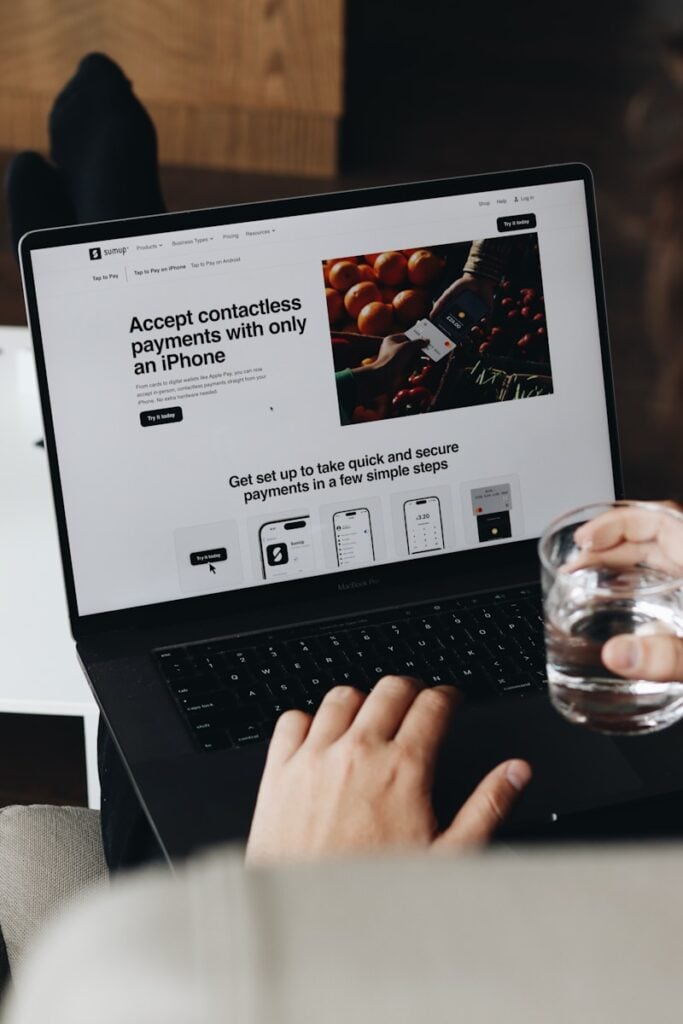La saisie d’un bien immobilier détenu en indivision est une situation juridique complexe qui suscite de nombreuses interrogations. Qu’un bien provienne d’une succession, d’un divorce ou d’un achat en commun, son droit de propriété est partagé entre plusieurs personnes, les coïndivisaires. Cette particularité a des conséquences directes sur les droits des créanciers. Face à la complexité de ces procédures, il est essentiel de faire appel à un avocat compétent pour défendre au mieux vos intérêts. Selon la nature de la dette, la loi impose des procédures au déroulement bien différent pour parvenir à la vente du bien et obtenir le paiement des sommes dues.
L’ensemble du régime repose sur une distinction fondamentale, celle qui oppose le créancier de l’indivision au créancier personnel de l’un des indivisaires. Cette différence détermine la voie procédurale à suivre : la saisie immobilière directe ou, de manière plus indirecte, la provocation d’une action en partage aboutissant à une vente forcée par licitation. Notre cabinet vous éclaire sur les points essentiels à maîtriser pour naviguer dans le cadre juridique de l’indivision.
Le principe : distinction cruciale des créanciers en indivision
Pour comprendre comment un bien indivis peut être saisi, il est impératif de se référer à l’article 815-17 du Code civil. Ce texte établit une différence fondamentale de traitement entre deux types de créanciers, chacun disposant de prérogatives propres. La nature de la créance, qu’elle soit commune à tous les indivisaires ou personnelle à un seul, dicte la procédure applicable.
Les créanciers de l’indivision : un droit de saisie sur le bien commun
La première catégorie de créanciers est celle dont la créance est issue de la conservation ou de la gestion du bien indivis. Il peut s’agir, par exemple, de dettes liées aux charges de copropriété, aux impôts fonciers impayés, à une dette administrative commune ou au financement de travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble ou de l’appartement. Ces créanciers sont considérés comme les créanciers de la masse indivise elle-même, leur créance étant liée à la bonne gestion des biens. À ce titre, l’article 815-17 du Code civil leur confère un droit d’action direct et puissant : ils peuvent poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis dans son intégralité, comme si celui-ci appartenait à un propriétaire unique. Les biens indivis constituent leur droit de gage commun, et ils peuvent agir contre l’ensemble des coïndivisaires, tenus solidairement de ces dettes.
Les créanciers personnels de l’indivisaire : un droit limité au partage
La seconde catégorie concerne les créanciers dont la créance est propre à un seul des coïndivisaires. Cette dette est étrangère à la gestion, à l’usage ou à la conservation du bien (un crédit à la consommation, une dette professionnelle, etc.). Dans ce cas, la loi protège les autres indivisaires et limite le droit de poursuite du créancier. Le créancier personnel ne peut ni saisir la totalité du bien, qui ne constitue pas son gage, ni même la quote-part abstraite de son débiteur. Son droit est plus limité : il doit provoquer le partage de l’indivision pour que la part de son débiteur se matérialise en une somme d’argent sur laquelle il pourra se payer. Pour ce faire, il utilise une procédure spécifique appelée l’action oblique, où il agit au nom de son débiteur pour exercer le droit de ce dernier de demander le partage.
Cas 1 : la saisie immobilière du bien indivis (créancier de l’indivision)
Lorsque la dette est commune à l’ensemble des indivisaires, la procédure applicable est celle de la saisie immobilière de droit commun. Il s’agit d’une mesure d’exécution forcée permettant de vendre un bien immobilier pour rembourser une créance. Cette voie est la plus directe, mais sa mise en œuvre est soumise à des conditions strictes.
Condition préalable : un titre exécutoire contre tous les indivisaires
Le créancier ne peut engager une saisie immobilière que s’il détient un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de tous les coïndivisaires. Un titre exécutoire est un acte juridique (le plus souvent un jugement ou un acte notarié) qui autorise le recours à l’exécution forcée. Sans ce titre valable contre chaque propriétaire indivis, la procédure de saisie directe est impossible. Cette exigence garantit que l’ensemble des propriétaires sont bien tenus par la même obligation de paiement.
Déroulement de la procédure : du commandement de payer à la vente
Une fois le titre exécutoire obtenu, la procédure de saisie immobilière se déroule en plusieurs étapes clés, supervisées par le juge de l’exécution :
- Le commandement de payer valant saisie : L’avocat du créancier fait signifier un commandement de payer à chaque indivisaire par un commissaire de justice. Cet acte a pour principal effet de rendre l’immeuble indisponible.
- La publication du commandement : Le commandement est publié au service de la publicité foncière pour être opposable aux tiers. Cette publication est une formalité essentielle qui assure la sécurité juridique de l’opération.
- L’assignation à l’audience d’orientation : Les indivisaires sont assignés à comparaître devant le juge de l’exécution. C’est lors de cette audience que sont tranchées les éventuelles contestations et que le juge décide de l’orientation de la procédure : soit vers une vente amiable si un accord est trouvé, soit vers une vente forcée.
- La vente : Si la vente forcée est ordonnée, le bien est vendu aux enchères publiques lors d’une audience d’adjudication. Le prix de vente est ensuite consigné pour être réparti entre les créanciers.
Cas 2 : la vente par licitation-partage (créancier personnel d’un indivisaire)
Lorsque la dette ne concerne qu’un seul indivisaire, le créancier doit emprunter une voie plus indirecte et souvent plus longue : la vente par licitation-partage. Il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution au sens strict, mais de l’exercice par le créancier d’un droit appartenant à son débiteur.
Le mécanisme de l’action oblique pour provoquer le partage judiciaire
Le fondement de cette procédure repose sur l’adage juridique selon lequel « nul n’est contraint à rester dans l’indivision ». Chaque indivisaire a la faculté de demander le partage à tout moment. Si un indivisaire néglige d’exercer ce droit, privant ainsi son créancier d’une possibilité de recouvrement, ce dernier peut se substituer à lui via l’action oblique, un mécanisme de procédure civile prévu par le droit français. Le créancier ne fait qu’exercer le droit au partage de son débiteur. Il ne s’agit donc pas de saisir un bien, mais de forcer sa vente pour que la situation d’indivision cesse et que les quotes-parts se transforment en capital.
Les étapes de la procédure jusqu’à la licitation
La procédure de licitation-partage est menée devant le tribunal judiciaire et comporte plusieurs phases distinctes :
- Obtention d’un titre exécutoire contre le seul débiteur : Le créancier doit d’abord obtenir un jugement condamnant son unique débiteur à lui payer la somme due.
- Assignation en partage-licitation : Muni de ce titre, le créancier, agissant en qualité d’intermédiaire de fait, assigne l’ensemble des coïndivisaires (et pas seulement son débiteur) devant le tribunal pour voir ordonner l’action en partage de l’indivision et, si le bien n’est pas partageable en nature, sa vente aux enchères (licitation).
- Jugement ordonnant la vente : Le tribunal statue sur la demande de partage. S’il l’accueille, il ordonne la licitation et désigne un notaire pour superviser les opérations et établir un cahier des charges.
- Vente aux enchères (licitation) : La vente a ensuite lieu aux enchères publiques, à la barre du tribunal. Le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas un droit nouveau mais constate la pleine propriété de chaque indivisaire sur les fonds qui lui sont attribués. C’est sur la part revenant à son débiteur que le créancier pourra finalement récupérer sa créance.
Le rôle central du juge de l’exécution (jex) dans la procédure
Dans les deux scénarios, un magistrat joue un rôle déterminant : le juge de l’exécution, ou JEX. Spécialisé dans le contentieux du recouvrement forcé, il est le garant du bon déroulement de la procédure de saisie immobilière et de la protection des droits de chaque partie, créancier comme débiteur.
Compétences exclusives et office du juge
Le JEX détient une compétence exclusive pour statuer sur toutes les difficultés qui ont pour objet les titres exécutoires et les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immobilière. Il peut se prononcer sur la validité de la procédure, la régularité du commandement de payer, ou encore le montant de la créance. Cependant, son office a des limites : il ne peut pas modifier le titre exécutoire sur le fond. Son rôle est de s’assurer que l’exécution se déroule dans le respect des règles légales, et non de réviser le jugement qui a condamné le débiteur.
L’audience d’orientation : une étape décisive pour le bien saisi
L’audience d’orientation est le moment clé de la procédure de saisie immobilière. C’est au cours de cette audience que le JEX, après avoir entendu les arguments et usé de son pouvoir d’appréciation, prend une décision fondamentale pour l’avenir du bien. Il vérifie la validité de l’ensemble des actes de procédure et s’assure que le créancier dispose bien d’un titre exécutoire valide. Il statue sur toutes les contestations soulevées par le débiteur. À l’issue des débats et au vu des arguments donnés, il a deux options principales : soit il autorise la vente amiable du bien par le débiteur lui-même, sous son contrôle et dans un délai fixé, soit il ordonne la vente forcée aux enchères publiques (adjudication).
Angles d’expertise : cas complexes et points de vigilance
La saisie d’un bien en indivision peut se heurter à des situations juridiques particulières qui viennent complexifier, voire paralyser, les procédures. Ces cas, souvent négligés, requièrent une analyse approfondie pour anticiper les obstacles et protéger les droits des parties.
Saisie en indivision et procédures collectives (sauvegarde, liquidation)
L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à l’encontre d’un indivisaire a un impact majeur. Le jugement d’ouverture entraîne la suspension des poursuites individuelles de la part des créanciers personnels. Ainsi, un créancier personnel ne peut plus engager une action en licitation-partage contre un débiteur, dirigeant d’entreprise par exemple, qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom de l’ensemble des créanciers. En revanche, les créanciers de l’indivision conservent leur droit de saisir le bien indivis, leur créance n’étant pas affectée par la procédure collective d’un seul des propriétaires. Pour une analyse plus poussée, consultez notre guide sur l’interaction des biens indivis avec les procédures collectives.
La protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel (insaisissabilité)
Depuis la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante du 14 février 2022, le patrimoine de l’entrepreneur individuel est scindé en deux. Un patrimoine professionnel, composé des biens utiles à son activité, et un patrimoine personnel. Par principe, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de droit pour ses dettes professionnelles. Cette protection du logement familial, qui est automatique, s’applique même si le bien est détenu en indivision. De plus, il existe des mécanismes de protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel qui peuvent rendre d’autres biens immobiliers non professionnels insaisissables sur déclaration. Ces dispositifs, qui nécessitent la constitution d’un patrimoine professionnel distinct ou la rédaction d’une déclaration notariée, sont opposables aux créanciers professionnels et doivent être pris en compte avant d’engager toute poursuite.
Prescription des créances : un point crucial souvent négligé
La détention d’un titre exécutoire n’est pas une garantie éternelle. Une créance, même constatée par un jugement, est soumise à un délai de prescription. Pour les créances issues de crédits immobiliers consentis à des consommateurs, par exemple, l’action en recouvrement se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai est souvent complexe à déterminer (date du premier incident de paiement non régularisé, déchéance du terme…) et fait l’objet d’une abondante jurisprudence, notamment de la Cour de cassation. Une analyse attentive des délais de prescription, à la lumière de l’actualité juridique, est donc une étape indispensable pour éviter d’engager des frais de procédure importants.
FAQ : questions fréquentes sur la saisie de biens indivis
La complexité des procédures de saisie sur des biens en indivision soulève des questions pratiques récurrentes. Voici des réponses claires à certaines d’entre elles.
Quelles sont les implications fiscales d’une saisie sur un bien indivis ?
Les conséquences fiscales varient selon que la vente est amiable ou forcée. En cas de vente, les droits de mutation sont dus par l’acquéreur. Si la vente met fin à l’indivision, elle peut être assimilée à un partage et bénéficier, sous conditions, d’un droit de partage au taux réduit de 1,10 % (à compter du 1er janvier 2022) sur l’actif net partagé, plutôt que des droits de vente classiques (environ 5,80 %). La question de la TVA peut également se poser pour certains biens. Enfin, la plus-value immobilière réalisée lors de la vente sera imposée pour chaque indivisaire en fonction de sa quote-part et de sa situation personnelle.
Quel est le rôle du notaire dans la vente amiable autorisée par le jex ?
Lorsque le Juge de l’Exécution autorise une vente amiable, le notaire intervient pour préparer et authentifier l’acte de vente. Son rôle est cependant encadré par la décision judiciaire. Il doit s’assurer que les conditions fixées par le juge (notamment le prix minimum) sont respectées. Sa responsabilité principale est de garantir la sécurité juridique de la transaction, de s’assurer de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de veiller à ce que la vente soit conforme au jugement d’orientation. En cas de litige entre les indivisaires, c’est au JEX de trancher, le notaire agissant comme un intermédiaire et un exécutant de la décision de justice.
Peut-on contester la mise à prix fixée pour la vente aux enchères ?
Oui, la mise à prix fixée par le créancier poursuivant peut être contestée par le débiteur. Cette contestation doit être soulevée lors de l’audience d’orientation devant le Juge de l’Exécution. Le débiteur doit démontrer que le montant proposé est « manifestement insuffisant » par rapport à la valeur vénale réelle de l’immeuble. S’il estime la contestation fondée, le JEX a le pouvoir de fixer lui-même une nouvelle mise à prix, plus en adéquation avec le marché. Cette démarche est essentielle pour protéger le débiteur et limiter le risque d’une vente à un prix dérisoire qui ne permettrait pas de désintéresser les créanciers tout en maximisant le reliquat éventuel.
Conclusion : saisir un bien en indivision, une action possible mais encadrée
Saisir un bien immobilier en indivision est donc possible, mais la procédure à suivre est strictement dictée par la nature de la dette. Le créancier de l’ensemble des indivisaires peut recourir à la saisie immobilière classique, tandis que le créancier d’un seul indivisaire doit engager une action en licitation-partage. Pour cette raison, la mise en œuvre de chaque procédure a ses propres étapes et complexités, supervisées par le juge. De plus, des situations particulières comme une procédure collective, l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur ou la prescription de la créance peuvent faire obstacle au recouvrement. L’intervention d’un auxiliaire de justice, au fait de l’actualité législative, garantit que la vente se déroule dans les meilleures conditions pour toutes les parties et dans le respect du cadre légal. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.
Sources
- Code civil (articles 815-17 et suivants)
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code de commerce (dispositions relatives aux procédures collectives et à l’entrepreneur individuel)